Pour une poétique écologique de la ville
Entretien de Ahmed Mahfoudh avec Thabette Ouali autour des Jalousies de la rue Andalouse
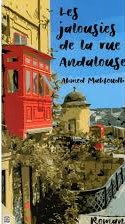
Romancier, Ahmed Mahfoudh est également chercheur en littérature francophone et journaliste spécialisé dans les rubriques littéraires. Plusieurs fois primé par des prix littéraires nationaux, cet auteur tunisien est surnommé « écrivain de la ville » du fait que toute son œuvre romanesque met en scène la ville de Tunis avec sa médina et ses quartiers européens.
Très sensible à la question écologique, plus particulièrement préoccupé par les constructions et les aménagements anarchiques de la ville, il prend part à divers sit-in et marches militantes en faveur de la sauvegarde de parcs et de monuments architecturaux menacés de destruction par une politique d’urbanisation irréfléchie. Cependant, c’est l’espace romanesque qui demeure pour lui le lieu premier de dénonciation et de sensibilisation à ces dégradations écologiques souvent sous-estimées aussi bien sur le plan politique que social.
Les Jalousies de la rue andalouse, son dernier roman qui vient de paraître aux Éditions Arabesques en Tunisie, est une fois encore l’occasion de faire se croiser des épisodes dramatiques de l’histoire de la Tunisie avec l’ambition individuelle pour une dénonciation du monde capitaliste qui mène l’ancien monde à sa perte, en cette ère de la globalisation.
Dans les débuts des années quatre-vingt, pour poursuivre ses études supérieures en droit à la capitale, un jeune provincial ambitieux est généreusement hébergé dans le logement de service d’un propriétaire terrien, descendant d’une grande famille tunisoise d’origine andalouse sur le déclin. Amoureux de la fille de son hôte qui le remarque à peine, frustré par un milieu bourgeois auquel il n’a pas accès et animé par un sentiment d’injustice, Aziz alias Azouz Bramli va entreprendre une stratégie de conquête, une véritable ascension professionnelle et sociale pour une affirmation identitaire.
Thabette Ouali : « A nous deux Tunis » (p. 32) : c’est ainsi qu’à son arrivée à la capitale, le personnage principal de votre roman défie cette ville qui lui est encore inaccessible rappelant indéniablement Rastignac, ce jeune arriviste de Balzac. Cependant, pour cette dernière publication vous avez opté pour un roman à suspense, un crime comme point de départ à ce roman social qui se fait une nouvelle observation critique de Tunis. Vous semblez privilégier la fiction romanesque sous toutes ses formes plutôt qu’une autre écriture comme l’essai ou encore le journalisme pour à la fois témoigner et partager un regard critique sur la société tunisienne du nouveau millénaire. Pensez-vous que l’écriture romanesque est apte à porter et à promouvoir cet engagement du fait qu’elle peut atteindre un public plus large?
Ahmed Mahfoudh : Alors que le journalisme informe et que l’essai interpelle l’esprit, l’écriture romanesque puise dans le vécu et mobilise le pathos. L’Histoire appréhendée dans une perspective littéraire n’en est que plus riche et plus intime car elle s’appuie sur le détail et les zones de la vie qui sont peu éclairées par les études historiques. Ainsi, les historiens parlent-ils des années quatre-vingt comme d’une période de désenchantement (par rapport aux années de construction du pays) et de l’avènement de nouvelles classes qui remplacent l’ancienne élite politico-culturelle par le règne de l’affairisme et de l’argent. Mais l’Histoire est attentive aux mécanismes visibles, tandis que le roman montre les dessous de cette transformation : à travers la saga d’un arriviste, un laissé pour compte qui se venge des oligarchies traditionnelles, un innocent qui recourt à des méthodes machiavéliques pour arriver, nous saisissons le fond du problème ; c’est un nouvel épisode de l’ancienne guerre entre le centre et la périphérie, entre les citadins sédentaires et les itinérants de la campagne ; c’est l’éternel retour du conflit entre le Makhzen –les élites de la Cité – et bled siba[1] : les « horizontains », les périphériques, les « derrière les panneaux », expression qui désigne chez nous les campagnards marginalisés. Bien avant moi, Faouzi Mellah a abordé le problème des Nouveaux Riches, mais du point de vue de la modernité, insistant sur le fait que leur enrichissement non suivi par une maturation culturelle a abouti à une modernisation anarchique et inadéquate : c’est « une modernité d’objets » selon les termes de Rachid Mimouni.
Voilà en quoi la littérature romanesque pourrait servir d’enrichissement au travail des historiens, surtout que le roman couvre un champ plus vulgarisé donc susceptible d’atteindre un large public.
T.O. : C’est par le biais de votre intérêt pour l’histoire, aussi bien celle de la ville que du pays, que ces récits de vie prennent forme pour imposer à nouveau aux regards des lecteurs ce Tunis et sa médina dévalorisés tout comme certaines de ses catégories sociales marginalisées. Dans tous vos romans d’ailleurs, les non-lieux se couvrent de poétique pour se faire dans un premier temps outils d’une reconquête littéraire et, dans un second temps, pour mettre en cause les principaux responsables de ces nuisances. Est-ce présomptueux de penser que cette écriture engagée permettra une prise de conscience capable de préserver les hommes des dangers liés à la dégradation de leur environnement naturel ? Comment replacer cet engagement à vocation écologique sur la scène littéraire tunisienne d’expression française ?
A.M.: Effectivement, vous avez mis le doigt sur un point sensible de mon œuvre, son lien à l’environnement, sa vocation à défendre le patrimoine architectural et urbanistique. Je suis né dans les faubourgs de la médina de Tunis du temps où un certain équilibre régnait, donc je ne suis pas insensible à la dégradation qu’avait connue la ville ancienne – j’entends par-là à la fois la médina, ses faubourgs et la ville européenne appelée Bab Bhar. Dès mon premier roman Brasilia Café, je travaillais à la réhabilitation du Centre-ville, avec ses cafés littéraires, ses salles de cinéma et ses espaces culturels, aujourd’hui disparus, remplacés par des banques et par des centres commerciaux. Dans mes autres romans, je dénonce la dégradation architecturale provoquée par le mauvais goût, au nom de l’intérêt matériel, et j de montrer le passé de ma ville, non d’un point de vue nostalgique et idyllique, mais le passé comme leçon au présent pour édifier la ville future.
Bien avant moi, des écrivains tunisiens et maghrébins de langue française ont recouru à la problématique de la dégradation environnementale comme symptôme d’un déclin culturel lié souvent à l’avènement de nouvelles classes affamées et sans foi ni loi. Faouzi Mellah dans Le Conclave des pleureuses, Hélé Béji dans L’Œil du jour dénoncent le mauvais goût des classes moyennes qui détruisent le traditionnel au profit d’une synthèse ratée de l’ancien et du moderne. Emna Belhaj Yahia, dans L’Etage invisible, dénonce l’arrivisme du cousin qui transforme la maison ancestrale en fonds de commerce pour marchands de fruits secs. Enfin plus grave, la destruction totale de la hara juive, la dégradation de la petite Sicile, que je dénonce à travers mes romans, met fin au cosmopolitisme. Le combat de la littérature tunisienne en faveur de l’environnement est une lutte pour la survie de la diversité culturelle.
T.O. : « Les matins de la rue andalouse sont une confusion de lumière, de rumeur et de senteurs » (p. 13), Tunis est « une cascade de blancheur qui se jette dans la mer, jamais si loin » (p. 13) mais bien qu’elle se transforme en « une ville fermée rendue encore plus exiguë par les nombreux barrages de police » (p. 67) suite aux événements politiques, la maison andalouse continue à fonctionner comme un espace clos, hors du temps, comme un bouclier contre toute atteinte de l’Histoire ou de son avancée même. Tunis renaît de ses cendres mais cette maison andalouse demeure malgré tout hors du temps. Comment définir les composantes de cette poétique de la ville ?
A.M. : Une poétique de la ville, cela suppose d’abord que celle-ci ne soit plus considérée seulement comme décor d’une action romanesque, mais également agent, la peinture de la ville devient une fin en soi non un élément au service de l’action. Dans la plupart de mes romans, la quête de la ville perdue devient une préoccupation principale. Bien plus, l’action n’est souvent qu’un prétexte menant vers des relais descriptifs producteurs de significations. La ville est un discours porteur de messages sinon du message principal du roman. Dès le premier texte, la ville définit le sens du récit et en oriente la lecture. Le lecteur est submergé par des bruits, des couleurs et des odeurs, auxquels s’ajoutent des détails, voire des scènes pittoresques pour fixer une atmosphère. Enfin, le sens de poétique glisse vers celui de poème : tableau évocateur d’un instant fugace à fixer dans l’éternel de l’art. Aussi le roman est-il balisé en épaisseur non en longueur. Le lecteur lit à travers l’épaisseur des signes que lui offre le spectacle de la ville. Quelquefois la durée d’un récit est le temps d’une déambulation comme dans les premiers romans d’Abdlawahab Meddeb : il n’y a qu’à lire « La Femme adultère » dans Jours d’automne à Tunis où tout se passe dans la tête, le temps d’une traversée de la ville.

Ahmed Mahfoudh
T.O. : Cette nostalgie du passé habite d’ailleurs toute votre œuvre romanesque et constitue un leitmotiv de votre écriture. En quoi cette connaissance du passé est-elle importante pour la construction de l’avenir ? Peut-on considérer cette nostalgie du passé comme une forme de militantisme ?
A.M. : Absolument ! Il y a deux types d’attitudes nostalgiques, la lamentation vaine sur un passé idéalisé qui ne reviendra plus et la méditation sur notre passé qui doit servir de leçon pour construire notre avenir. C’est le principe même de la modernité : construire un avenir débarrassé des blocages de la tradition, mais en continuité avec le passé, une émancipation originale et originelle (tournée vers l’origine). Ainsi quand je déplore la destruction du patrimoine architectural par les arrivistes, est-ce un appel à la sauvegarde de ce patrimoine, d’où le clin d’œil à l’adresse de l’ASM (Association de sauvegarde de la médina de Tunis) qui fait beaucoup d’efforts dans ce sens. Dans le postface de Terminus Place Barcelone, je lance un appel à la restauration de la Place de Halfaouine entourée de trois monuments grandioses. Écrire la ville, c’est transposer sur une ville réelle, une ville idéale qu’il faut impérativement reconstruire.
T.O. : Sans vouloir tomber dans une opposition simpliste entre ville et désert, il me semble toutefois que dans Les Jalousies de la rue andalouse l’attachement à la terre est exclusivement lié à l’espace citadin. Retrouver l’éden perdu semble pure utopie quand il n’est pas rattaché à la ville. La médina semble être l’origine du monde, serait-elle le seul lieu qui permette un retour sur soi ?
A.M. : J’insiste sur le fait que, pour moi, la Ville à reconquérir c’est toute la ville ancienne, qui comprend la médina et ses faubourgs, ainsi que la ville européenne, Bâb Bhar dans le prolongement de la ville arabe. Je suis à la recherche du centre perdu car autrefois les quartiers chics où il faisait bon vivre, c’était la médina pour la population autochtone – y compris les juifs résidant à la hara- et la ville européenne qui abritait les Français, mais également des Italiens, des Maltais, des Grecs, des Espagnols réfugiés de la guerre d’Espagne et des autochtones européanisés. Le boom urbanistique a déplacé le centre vers la périphérie, El Manazeh, puis Ennasr, puis vers le Lac : des quartiers huppés mais sans âme. Cette énucléation de la ville a consacré le triomphe de l’argent sur la culture car dans ces quartiers, on trouve surtout des centres commerciaux, des cafés et des restaurants chics alors que le centre était le temple de la culture et des loisirs grâce à ses cafés littéraires, ses maisons de la culture, ses salles de cinéma populaires et le fameux Théâtre Municipal de Tunis qui a vu le passage de grands acteurs arabes et européens. Heureusement, la Cité de la Culture aujourd’hui est en train de réhabiliter la ville ancienne, mais c’est insuffisant : la quête d’un centre est similaire à celle de l’omphalos chez les Grecs, ce noyau secret qui renferme les trésors enfouis et sur lequel repose l’équilibre et le bien-être de la Cité.
T.O. : Vous ne manquez pas de critiquer une fois de plus les constructions anarchiques dont est victime la ville. Ces constructions, une activité humaine qui semble sans le moindre danger, participent pourtant à l’altération de l’environnement. De quelle manière cette prise de possession de ce lieu se révèle-t-elle une menace pour l’environnement, l’avenir même des hommes ?
A.M. : La construction est une pulsion chez le Tunisien. Aucun Tunisien, s’il a un peu d’argent, ne peut résister à l’idée de construire sa maison, de la transformer ou de faire une extension. C’est profondément ancré dans la culture, lié peut-être à un sentiment d’insécurité. Mais avec la Révolution, vu la faiblesse de l’Etat, les choses se sont aggravées à cause des constructions anarchiques laissées dans l’impunité : on a grignoté sur des forêts, sur le littoral marin, on a construit sur des sites archéologiques, sur des lagons et tout près des oueds… Dans la médina, malgré la vigilance des autorités, de nombreuses maisons bourgeoises sont devenues des oukalas, sorte de pensions populaires à prix modiques, qui abritent donc une couche sociale miséreuse : c’est une véritable paupérisation de la médina qui était au début du siècle le centre culturel de Tunis avec ses médersas, ses lieux de culte, ses palais aristocratiques et les bâtiments relatifs aux différents ministères. Dans mon dernier roman, les héritiers de la maison andalouse voudraient en faire un dépôt pour stocker les marchandises, ce qui constituerait la pire des dégradations.
T.O. : On ne peut achever cette rencontre sans évoquer un précédent roman publié en 2011, Dernier voyage à Kyrannis qui donne l’aperçu d’un monde où l’existence même de l’homme est menacée. Vous pointez clairement du doigt ce système économique que vous jugez responsable de la perte du pays, de l’humanité entière. Pensez-vous que la destruction de la planète et l’extinction de l’espèce humaine sont plus probables et proches ?
A.M. : Je pointe du doigt surtout l’avènement de la civilisation numérique qui est en train de transformer la planète en un univers carcéral dans lequel tout le monde est surveillé. La fable de Dernier voyage à Kyrannis est plus ou moins caricaturale, mais nous ne sommes pas si loin de cette fiction. Aujourd’hui grâce à Facebook et aux calculs algorithmiques on peut avoir toutes les informations sur une personne donnée.
Quant à la fin du Monde, je pense qu’elle viendra avec l’accumulation des catastrophes écologiques : dérèglement climatique, déforestation, disparitions des espèces, poubellisation de la mer…et catastrophe nucléaire.
T.O. : Adam, le personnage principal du Dernier voyage à Kyrannis choisit de quitter la civilisation numérique et de vivre en sauvage. Vous inscrivez ainsi votre roman dans la tradition d’une littérature écologique militante ?
A.M. : Absolument ! car Adam est un Décroissant, il est à l’image de ces militants qui aujourd’hui boycottent la société de consommation en choisissant de vivre du minimum : pas de télé, pas de téléphone, pas de voiture, nourriture bio…l’écologie se transforme en un véritable culte mystique, c’est la religion des temps modernes.
En Tunisie, j’aurais voulu voir un mouvement écologique plus fort et radical, mais la Révolution a relégué les impératifs écologiques aux calendes grecques, soutenant que les gens ont surtout besoin de pain et de travail. Seulement, on oublie que la dégradation de l’environnement constitue la première source de difficultés économiques.
[1] Les étendus non contrôlées par l’Etat central (< siba, de l’arabe msayyeb : abandonné à lui-même)
To quote this article:
Ahmed Mahfoudh, Thabette Ouali, «Pour une poétique écologique de la ville. Entretien de Ahmed Mahfoudh avec Thabette Ouali autour des Jalousies de la rue Andalouse» in Literature.green, august2019, URL: https://www.literature.green/pour-une-poetique-ecologique-de-la-ville , page viewed on [date].
