Du marché Jean-Talon au littoral groenlandais : réflexions sur le paysage intérieur
Entretien d’Anne-Sophie Subilia avec Miruna Craciunescu
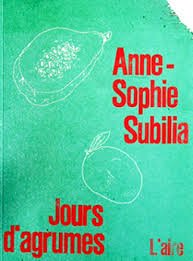

Récipiendaire du Prix de l’Association des Écrivains de Langue française et de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes académiques (ADELF-AMOPA 2014) pour son premier roman Jours d’agrumes (éd. de l’Aire, 2013), l’autrice belgo-suisse Anne-Sophie Subilia a séjourné à Berlin, Strasbourg et Montréal. Elle vit à Lausanne. Ses récits demeurent marqués par l’Atelier québécois de géopoétique La Traversée, qu’elle a intégré en 2010, et où elle s’est intéressée à l’écriture de l’expérience sensible et à l’imaginaire des lieux. Dans un deuxième roman Parti voir les bêtes (éd. Zoé, 2016, Arthaud poche 2018), un quarantenaire tente de renouer avec le monde de son enfance en retournant s’installer dans sa campagne natale, la Gloye, dont il observe avec douleur l’entrée tardive dans la modernité. Plus récemment, en janvier 2020, elle signe Neiges intérieures (éd. Zoé, 2020), un journal de bord de fiction qui relate quarante jours de navigation dans le cercle polaire arctique entre quatre architectes paysagistes

Miruna Craciunescu : Le marché Jean-Talon occupe une place de premier plan dans votre premier roman Jours d’agrumes. J’ai été très sensible à la description de cet endroit que je connais bien et à l’accent que vous avez mis sur l’abondance des couleurs sur les étalages de fruits où travaille Franca, la protagoniste. En lisant votre deuxième roman Parti voir les bêtes, j’étais convaincue que le paysage rural qui se trouve au centre de cette œuvre existait également, et j’ai été surprise de ne pas être en mesure de situer la Gloye sur une application comme Google maps. S’agit-il d’une campagne imaginaire? Et si tel est bien le cas, en quoi son absence de référentialité a-t-elle influencé la manière dont vous avez abordé l’écriture de ce lieu?
Anne-Sophie Subilia : Oui c’est une contrée imaginaire.
Lors de l’écriture de Parti voir les bêtes, je vivais à la périphérie de Lausanne, dans le Jorat, une région encore agricole et forestière, des paysages de collines et de cultures, dont on sent au quotidien la métamorphose liée au phénomène de rurbanisation. Mes promenades dans les bois et à travers champs ont précipité l’écriture de ce livre. Cela faisait longtemps que ce thème rôdait à l’intérieur de moi. J’ai grandi dans un village qui a subi à peu près le même sort. En Suisse, en Belgique comme en France, partout on assiste au même phénomène, que chaque pays tente d’absorber ou de réguler à sa façon. Avec la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, la Suisse cherche son équilibre pour préserver à peu près certaines terres. Il n’empêche que la pression est énorme sur les zones non bâties. Imaginer un village (« La Gloye »), c’était une façon de prendre mes libertés par rapport à une géographie précise et façonner un lieu qui puisse être ici, ici ou encore ici. Désigner le village dans lequel j’habitais aurait été réducteur par rapport au monde qui s’est élaboré par ou dans l’écriture, et qui englobait d’autres villages, d’autres campagnes et d’autres souvenirs.
M. C. : En travaillant à l’étal de fruits exotiques des sœurs Brassard, Franca cherche en entre autres à se purger de l’anxiété de performance qui l’avait amenée à abandonner ses études de médecine en Suisse, mais son nouveau métier n’est pas sans difficultés. Outre les longues heures et la paie très basse, la protagoniste de Jours d’agrumes comprend rapidement que la marchandise qu’elle doit écouler est « plutôt bas de gamme » (JA, p. 39), et que ses ventes dépendent donc davantage de la présentation matérielle des fruits que de leur qualité. La provenance des fruits elle-même est parfois cachée aux consommateurs, comme dans la scène où on demande à Franca de retirer les étiquettes des pêches américaines et de dire aux clients qu’elles viennent d’Ontario (ibid., p. 125). Diriez-vous qu’il était important pour vous de mettre en scène cette aliénation, en montrant que ce marché – qui représente pourtant le seul lien tangible entre le travail de la terre et les gens de la ville – ne transmet aux consommateurs pratiquement aucun souvenir des endroits où ont poussé les aliments dont ils se nourrissent?
A.-S. S. : En écrivant Jours d’agrumes, j’avais surtout à cœur de révéler le caractère composite d’un grand marché comme celui de Jean-Talon, à Montréal. On dit qu’il s’agit du plus important marché public à aire ouverte en Amérique du Nord. Je pense que la fonction – nourricière, sociale, populaire, économique – qu’il pouvait avoir il y a encore quelques décennies a évolué avec la présence massive des supermarchés et de nos mœurs. Aujourd’hui, sa survie dans la ville semble compromise.
Pour autant, la dimension aliénante était une facette parmi bien d’autres. C’est un phénomène que j’ai pu observer. J’avais vraiment à cœur de laisser parler ce marché, de l’entrevoir comme un microcosme. Un monde miniature, bien plus complexe et surprenant qu’on pourrait croire. Tout à la fois symboliquement fort et très concret, qui sans cesse nous tend des miroirs sur nos agissements en tant qu’individus et en tant que système. J’ai eu envie de déconstruire certaines illusions (la provenance des produits, par exemple) pour mettre en scène la complexité et le caractère insaisissable, parfois irrationnel de nos mœurs. Certes, c’est le théâtre d’actes parfois peu glorieux, mais où cohabitent d’innombrables nuances et une humanité. Je me suis servie de la relative naïveté avec laquelle j’y allais en tant que cliente, mais aussi de l’expérience que j’ai acquise en y travaillant. C’est ce qui a déclenché l’envie d’écrire.
M. C. : Vers la fin du roman, on découvre que la répétition des gestes à l’aide desquels Franca prend soin de la marchandise des sœurs Brassard a fait naître en elle des « évidences » qu’elle ne percevait pas à son arrivée à Montréal. J’ai l’impression qu’en modifiant le rapport qu’elle entretient avec son environnement immédiat, ces activités manuelles exercent malgré tout sur la protagoniste un rôle thérapeutique, en dépit du caractère quelque peu aliénant des techniques de marketing qu’on lui demande d’adopter pour écouler la marchandise avariée ou sur le point de l’être. « Elle le sait dans son corps que Jean-Talon était ce dont elle avait besoin […]. Le soleil est au zénith au-dessus des endives molles. Franca leur apporte un parasol. Personne n’a rien ordonné, c’est un geste évident » (JA, p. 138-139). Comment décririez-vous le lien qui se noue, dans Jours d’agrumes, entre le corps de la protagoniste et les aliments qui ont inspiré le nom de ce roman?
A.-S. S. : Franca, la protagoniste, travaille pour des revendeurs. Elle sait que ces fruits n’ont pas été cueillis à l’aube dans un verger bienheureux. On n’est pas au paradis. Elle ne sait pas d’où viennent ces denrées exotiques. Elles sont passées de main en main, comme des objets inanimés ou orphelins. Cette réalité a quelque chose de révoltant et de bouleversant pour Franca. De même, il faut la lucidité et la ruse pour écouler les stocks. Nombreuses sont les scènes où on la découvre, elle et ses collègues, en train d’installer les produits, les trier, les arranger, agir sur la matière. C’est un vrai travail de composition. On pourrait même y voir une quête plus existentielle de sens et d’harmonie. Pour Franca, ces gestes ont en tout cas pour effet de recréer le lien perdu et de se réinscrire elle-même en tant que femme, bien vivante.
M. C. : Le protagoniste de votre deuxième roman exerce également un métier manuel. Cependant, l’ébénisterie ne semble pas avoir un effet aussi thérapeutique sur lui, si l’on considère que sa fuite à la campagne ne l’a pas empêché de s’y faire prescrire un arrêt maladie. Bien que sa décision de déserter le bureau où il travaillait « huit heures au-dessus de documents qui ne levaient en [lui] aucune passion » (PVB, p. 89) s’apparente à celle de Franca qui préfère le marché Jean-Talon à ses études de médecine, il me semble que le potentiel rédempteur de ce déménagement n’est plus tout à fait le même. Diriez-vous que ce deuxième roman pose un regard plus désenchanté sur la possibilité dont nous disposons, en tant qu’individus, d’échapper aux caractéristiques les plus opprimantes de la vie moderne au moyen d’un « retour à la terre » (ibid., p. 146)?
A.-S. S. : Parti voir les bêtes est plus désenchanté, c’est vrai. Il se déroule dans une campagne défigurée. C’est tout un monde qui se délite, s’enlaidit, perd le contact. J’ai composé un personnage, un quarantenaire, dont l’extrême sensibilité ne l’aide pas à trouver son aire de survie. Il est plus mature que Franca dans Jours d’agrumes. Ils ont pourtant en commun une hypersensibilité, un penchant autodestructeur et une puissance vitale. Ils ont connu des états de détresse et d’épuisement. Tous deux sont en prise avec leurs idéaux. Ils recherchent éperdument un monde dont ils pressentent l’existence et s’accrochent aux moindres signes qui le révèlent.
Mais je dirais que c’est une question de caractère. Le personnage de Parti voir les bêtes est davantage nostalgique, alors que Franca s’expatrie, elle va voir ailleurs. C’est peut-être plus simple, pour elle. En faisant le choix d’un retour à la campagne, sa campagne, Simon s’expose jour après jour à ce qu’il considère comme un drame : la transformation et la domestication de la nature à des fins commerciales. S’il vivait en ville, il serait un peu plus épargné de la vue quotidienne. En restant, en faisant le pari de rester, il devient témoin et s’expose à sa douleur.

Anne-Sophie Subilia
M. C. : J’ai été sensible à la place que vous avez accordée dans ces deux œuvres à la transformation inévitable des choses. Vos protagonistes semblent avoir conscience non seulement de la fragilité du vivant, mais aussi de la difficulté qu’il y a à exprimer cette fragilité. Lorsque Simon assiste à la naissance d’un veau, le narrateur précise ainsi qu’il s’agit d’un événement « dont on ne parle pas quand on va en ville ou qu’on est avec une fille » (PVB, p. 102), avant même de nous apprendre que cet animal n’a pas survécu. Pourrait-on dire que ce passage exprime, de manière très brève, l’angoisse existentielle qu’éprouve le protagoniste dans l’ensemble du roman face aux « moments transitoires – apparitions, disparitions – qui modifient l’état des choses » (ibid., p. 147)?
A.-S. S. : La scène de l’étable conjugue plusieurs thèmes. Naissance et mort y sont intimement liées. Dans toute mise au monde, on côtoie de près la mort. Là, je souhaitais mettre en scène Simon et Adem, l’aide de ferme, qui ne se connaissent pas et qui se trouvent soudain amenés à agir ensemble pour sauver un veau qui vient de naître. Les voilà reliés fortuitement par une mission. Ce moment mène à une complicité fugace, mais marquante.
J’ai mis en scène leur pudeur et cet interdit qui plane quant aux émotions éprouvées par des hommes. De part en part, du moins c’était mon intention, ce livre aborde le thème du langage et des limites de l’expression. Mon protagoniste parle peu. Le choix de la narration en « tu » participe de cette espèce de défaillance de mon personnage à parler. Ça dit la difficulté de s’exprimer à la première personne, à plus forte raison pour approcher la source des angoisses. Le protagoniste est en effet hanté par l’angoisse de ce qui change. Si seulement il pouvait arrêter le temps! Son rêve conservateur (au sens non pas politique, mais existentiel) le mène à broyer du noir et parfois à se couper de la communauté de ses semblables.
M. C. : Le caractère tragique de cette fragilité ne se limite pas uniquement au règne animal. Dans Jours d’agrumes, on le retrouve également à travers la lutte incessante que livre Franca contre la pourriture qui « accomplit avec zèle son travail de propagation » (JA, p. 103). En dépit de tous les efforts de la protagoniste, elle assiste, impuissante, à une hécatombe de fruits et de légumes qui se perdent chaque jour en chemin entre le moment où ils sont récoltés dans les champs et celui où l’on tente d’écouler les stocks au marché. Diriez-vous que ces descriptions relèvent d’un engagement qui vise à faire prendre conscience aux lecteurs de la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire?
A.-S. S. : Je n’ai pas cherché à écrire un manifeste contre le gaspillage alimentaire, mais tant mieux si cela peut susciter le débat ou faire réfléchir les lecteurs. Non, j’ai simplement voulu montrer – au-delà de la valeur marchande que représente « un stock » – le lien sensible entre le soin accordé au vivant et une vision du monde. La « traite » des denrées alimentaires est un miroir qui renvoie l’humain à ses valeurs, à son éthique personnelle et, en fin de compte, à un rapport au monde. Le souci de Franca pour toute cette richesse vivante illustre peut-être son propre défi pour prendre soin d’elle-même et lutter contre l’anéantissement.
M. C. : Il me semble que la notion de transmission occupe un rôle central dans Parti voir les bêtes. Après s’être longtemps cru stérile, et après avoir noué des liens très étroits avec son neveu pour compenser cette perte, la fertilité recouvrée du protagoniste le contraint à faire un choix : il peut céder au désir de sa partenaire d’avoir un enfant, tout comme il peut s’abstenir d’engendrer une génération suivante. L’opération qui est mentionnée à plusieurs reprises à la fin du roman laisse entendre qu’il optera plutôt pour la deuxième option. Ce renoncement est-il lié, de manière symbolique, au choix particulier que vous avez fait de narrer cette œuvre à la deuxième personne du singulier, un peu comme si le narrateur s’adressait directement à Simon?
A.-S. S. : Le thème de la transmission et de la filiation est très présent dans Parti voir les bêtes. La relation au père, au grand-père, à l’enfant peut-être. Que veut-on transmettre ? Que peut-on transmettre ? À qui ? Et, plus complexe encore, comment transmettre l’immatériel ? Se pose aussi la question des personnes inspiratrices, celles dont on souhaite s’environner. Dans sa relative solitude, le protagoniste sera frappé par certains personnages qui viendront partager sa vie et qui l’illumineront. Au milieu de tout cela, il y a la question centrale de la procréation – largement thématisée à l’heure actuelle, dans une humanité qui semble vouée à sa propre extinction. Mon personnage hésite, il est torturé par la question. La narration au tu, tel qu’elle m’est apparue au fil de mes explorations (j’ai longtemps cherché le ton, la langue, la voix narrative justement) est un tutoiement de la confidence et du secret qu’on dirait à voix basse. C’est un tu du dedans; qui pourrait autant être le tu à soi-même que le tu d’un ami intime (invisible) capable d’observer le personnage et qui le connait si bien, mieux que lui-même. Par l’entremise du tu, il s’agissait d’entrer sous la peau, dans la tête, au plus près d’une conscience agissante. Comme un théâtre intérieur.
Quant à la décision finale (renoncer ou non à être père), elle demeure mystérieuse et je l’ai voulue ainsi. On ne sait pas ce que Simon choisira, moi-même je l’ignore.
M. C. : Pour finir, j’aimerais également aborder votre publication la plus récente, Neiges intérieures. Sur le plan formel, ce texte témoigne d’un éloignement important vis-à-vis de la narration romanesque qui permettait de se plonger quelques mois dans la vie de Franca à Montréal et de Simon à la Gloye. Bien qu’il s’agisse ici aussi d’un récit de voyage, celui-ci s’apparente moins à un roman qu’à un journal de bord et détaille le périple de la narratrice de manière plus éclatée, par l’entremise de fragments assez courts, qui s’apparentent parfois à des poèmes en prose. Dans l’ensemble, l’ouvrage semble accorder une place centrale à la relation qui se noue entre « l’intérieur » et « l’extérieur », soit aux effets psychologiques que produit la contemplation de paysages isolés sur une narratrice à propos de laquelle on ne dispose que très peu d’informations personnelles. Cette mise en récit s’est-elle imposée d’elle-même pour ce nouveau projet, ou résulte-t-elle d’une recherche formelle plus longue, liée à une écriture de l’espace?
A.-S. S. : Ce livre découle d’une navigation au Groenland, en été 2018. Pendant plus d’un mois, nous avons longé en voilier la côte ouest du Groenland, et mis pied à terre aussi souvent qu’il était possible. C’était dans le cadre d’une résidence artistique et, avec deux compagnons – l’artiste sonore Rudy Decelière et le metteur en scène/comédien Jean-Louis Johannides –, nous avions pour projet de créer ensemble une performance, dont j’écrirais le texte. À notre retour, j’ai mis trois mois avant de trouver ce ton, cette voix et à me décider qu’il s’agirait d’un journal fictif d’expédition écrit par une femme. Dans mon travail, les choses se font par expérimentations et beaucoup de brouillons, jusqu’à ce que je tienne ma première phrase.
Cette création scénique a été présentée dans quatre théâtres de Suisse romande en 2019 sous le nom de Hyperborée. Pour moi, cela a été la matrice de Neiges intérieures.
Je sentais que le texte écrit pour la performance était aussi le début de quelque chose d’autre que j’avais à explorer et approfondir. Je devinais au fil de l’écriture que le thème central en serait les relations humaines.
La forme déroute par son aspect fragmentaire et par le mélange des genres. Pourtant, à mes yeux, il s’agit bel et bien d’un roman. Une fiction nourrie d’une expérience personnelle. Plusieurs registres ou genres littéraires y sont à l’œuvre. Les rubriques sont effectivement très diversifiées ; des notes météorologiques côtoient des observations plus acides sur la vie à bord ou encore des paragraphes contemplatifs, plus poétiques. Ma diariste juxtapose ces matières. Moi-même, je ne peux pas nier l’intérêt que je porte aux liaisons entre corps et psyché. Aux mondes intimes dont les corps sont parfois le reflet. Pourquoi le corps serait-il relégué au second plan, lui qui se trouve le premier exposé par les conditions du quotidien (et ici, du voyage) ? Sur un bateau, de même qu’en altitude ou lors de certains voyages qui nous engagent physiquement, il y a une certaine prouesse du corps. Un récit de voyage à pied, par exemple, ne fera certainement pas l’impasse sur les altérations et les défis du corps au fil du chemin. Dans Neiges intérieures, le corps, l’esprit, le monde sensible et intime sont d’autant plus indissociables et solidaires qu’ils ont à faire avec un quotidien très peu familier, qui les mettent à mal. Leur mise à mal ne peut pas aller sans conséquences sur la pensée. Je voulais mettre en scène cette détresse.
M. C. : La narratrice de Neiges intérieures note dès le début du récit que l’immensité du paysage produit un contraste saisissant avec l’exiguïté du bateau. Alors même qu’elle se sent écrasée par l’immensité minérale de la toundra (qu’elle arpente régulièrement au pas de course aussitôt qu’elle en a l’occasion), à bord d’Artémis, son espace vital est envahi par des compagnons dont elle n’apprécie pas toujours la présence. « On vit les uns sur les autres comme dans une navette spatiale. Et le paradoxe, c’est cette immensité dans laquelle nous flottons. » (NI, p. 9). Ce huis clos permanent fait naître des tensions entre les membres de l’équipage, qui se traduisent par l’isolement ponctuel de ses membres les plus vulnérables, à l’instar de C., qui est la seule autre femme à bord du navire.
Si la narratrice vit parfois avec elle des moments de camaraderie – comme lorsqu’elles se lavent mutuellement les cheveux ou qu’elles ont leurs règles en même temps –, il m’a semblé que la présence de C. contribue surtout à exacerber certaines dynamiques de pouvoir, au point où il est parfois tentant d’établir un parallèle entre l’absence de présence humaine sur la toundra et l’absence d’humanité ou de tendresse qui s’installe progressivement entre les membres de l’équipage toujours en lutte les uns contre les autres. Cela m’a incitée à me demander dans quelle mesure le genre de la narratrice avait contribué à donner à Neiges intérieures sa forme actuelle. La protagoniste aurait-elle vécu sa relation avec les lieux qu’elle traverse de manière tout à fait différente s’il s’agissait d’un homme, comme dans Parti voir les bêtes?
A.-S. S. : Je ne sais pas. Il me semble que la relation à un paysage est davantage une question de sensibilité que de genre. On aurait pu imaginer que le journal soit écrit par un homme et qu’il souffre lui aussi largement de l’exiguïté et se fasse prendre dans l’engrenage des affects. Ce que je crois, c’est que notre état psychique et émotionnel affecte grandement la relation que l’on aura au paysage. C’est l’humain qui forge et anime le paysage. Ce dernier, fait de montagnes, de roches et de lumières, demeure comme un bouddha assis en tailleur. Mais notre état intérieur a des conséquences sur la façon dont on pourra appréhender un espace. La détresse, les tourments, l’intranquilité modifieront notre lien, subjectivement. De son côté, le paysage s’insinue dans chaque intimité et provoque quantité d’impressions, de souvenir, de projections… qui peuvent bien sûr altérer l’état. Plusieurs fragments de Neiges intérieures abordent cette question de la porosité et notre capacité à « gâcher » l’expérience de la rencontre avec un territoire parce que « quelque chose » en bloque l’accès.
Pour revenir au genre et au choix d’une diariste femme, c’est surtout par souhait d’aborder ce voyage à partir de mon propre sexe et genre. Les différences essentielles ont trait au corps (se soulager, se laver, souffrir du froid). Le groupe est composé de deux femmes et quatre hommes. Je voulais travailler sur les relations que la situation peut engendrer au sein d’un groupe d’individus (jalousies, rapports de force, attractions, rejets…). Les sentiments d’infériorité, les tentatives de domination. Il y a beaucoup de micro-cruautés entre eux, mais rien n’est fixé pour toujours. Comme dans un mobile suspendu, un courant d’air et l’axe se modifie. Cela parcourt le livre.
M. C. : Pourriez-vous commenter brièvement le choix du titre : « Neiges intérieures »? On découvre à la page 90 que cette expression fait référence à un élément du paysage montagneux qu’observe la narratrice à partir du voilier en longeant les côtes septentrionales. La « fine visière blanchâtre bordée de gris mauve » (p. 90) que forment les neiges intérieures permet de tracer une démarcation entre la terre et la mer, mais il me semble que cette frontière renvoie également, sur le plan psychologique, au refroidissement intérieur que ce paysage vécu dans l’exiguïté du navire provoque sur les passagers. Au début du récit, en évoquant le bonheur que fait naître en elle l’observation du plancton bioluminescent lorsqu’il entre en contact avec l’urine qu’ils rejettent à la mer, la narratrice se désole de ne pas parvenir à « partager et [à] démultiplier » (p. 30) de tels instants avec ses camarades, tout comme plus tard, elle sera irritée de ne pas être « capable [d’éprouver de la] gratitude » (NI, p. 132) à l’égard de C., lorsque celle-ci lui expose ses connaissances sur le lichen. Elle parle parfois de « carences affectives » (NI, p. 95) lorsqu’elle fait référence à ce type de comportements. Diriez-vous qu’ils sont en lien avec un phénomène qu’elle décrit sous la forme d’une interrogation, lorsqu’elle se demande à la dernière page de l’ouvrage si « les paysages nous reconfigurent quand nous évoluons dedans » (p. 146)?
A.-S. S. : Je pense que cela ramène à ce que je disais plus haut, d’un perpétuel mouvement, une dynamique sensible entre le dehors et le dedans. Ainsi, les paysages agissent sur nous.
Le titre ne m’est pas venu immédiatement. J’ai cherché dans le texte ce qui m’interpellait. « Les neiges intérieures » figurait parmi quelques autres choix. En enlevant le déterminant, je n’ai plus eu de doutes.
To quote this article :
Miruna Craciunescu, Anne-Sophie Subilia, «Du marché Jean-Talon au littoral groenlandais : réflexions sur le paysage intérieur. Entretien d’Anne-Sophie Subilia avec Miruna Craciunescu » in Literature.green, february 2020, URL: https://www.literature.green/du-marche-jean-talon-au-littoral-groenlandais-reflexions-sur-le-paysage-interieur, page vue le [date].
—
Entretien réalisé dans le cadre du projet La littérature environnementale en Suisse: écrire l’écologie, réalisé avec le soutien de la Mission Suisse auprès de l’Union Européenne. Une journée d’étude sur ce sujet aura lieu à l’Université de Gand le 24 février 2020: https://www.literature.green/je-ecrire-ecologie-suisse/
