« L’oiseau, cette évidence non domestiquée qui apporte toute la forêt sous nos yeux, dans nos oreilles »
Entretien de Fabienne Raphoz avec Laura Pauwels autour de Parce que l’oiseau
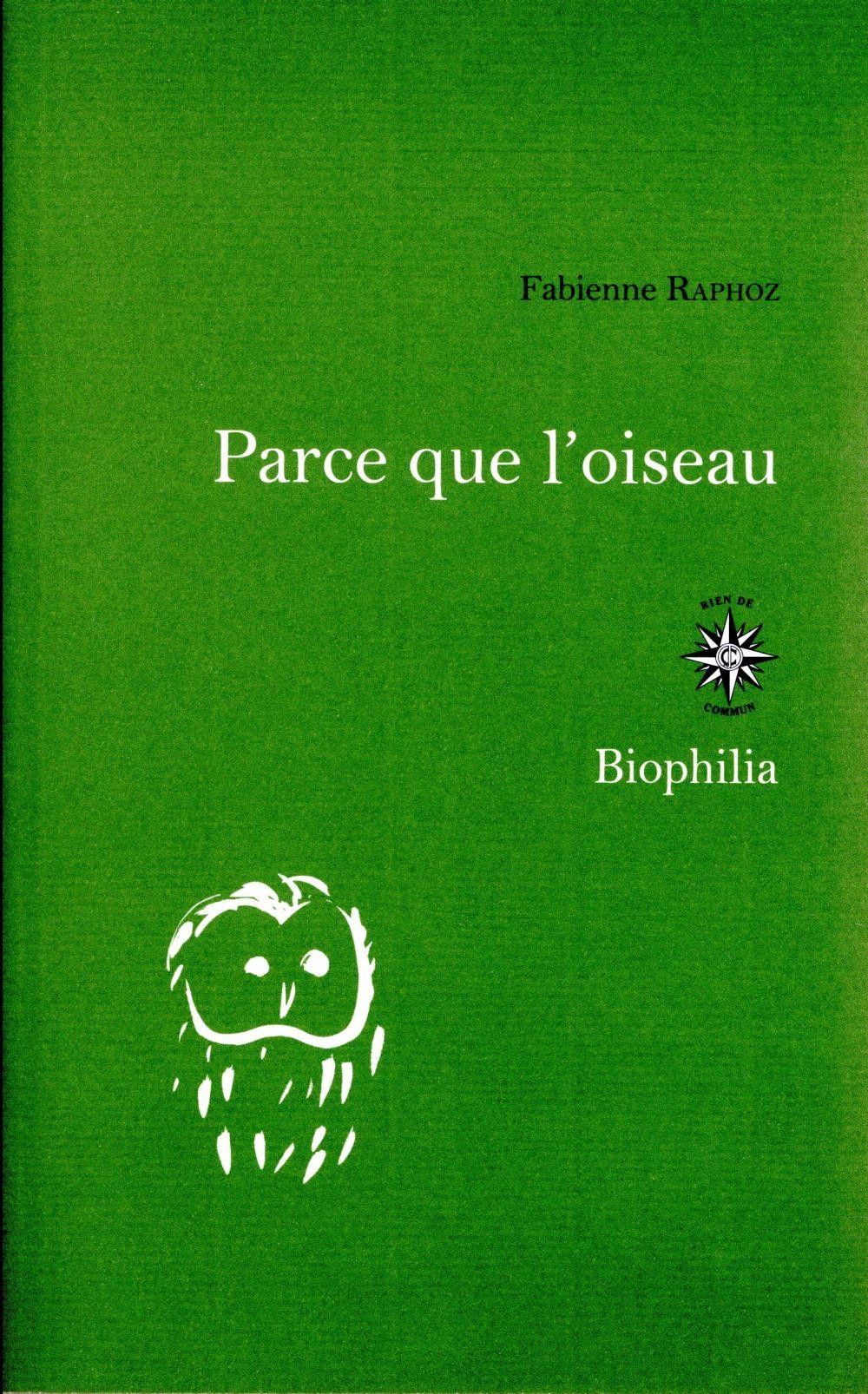
Fabienne Raphoz est écrivaine, poète et éditrice et joue un rôle fondamental dans le champ de la littérature environnementale française. Avec son mari, Bertrand Fillaudeau, elle dirige les Éditions Corti, où elle a créé trois collections : la « Collection Merveilleux », la « Série Americaine » et « Biophilia », une série de livres destinée à célébrer le vivant dans toutes ses formes. Son œuvre comporte de la poésie, des essais et des anthologies commentées et illustrées.
Dans son livre Parce que l’oiseau (Corti, 2018), elle combine ses deux passions : la littérature et l’ornithophilie.
Laura Pauwels : Comme le sous-titre « Carnets d’été d’une ornithophile » l’indique, Parce que l’oiseau est en partie basé sur vos propres expériences et observations. Par ce sous-titre, vous vous présentez comme ornithophile et non pas comme ornithologue, une distinction à laquelle vous revenez explicitement au début du livre (PO, p. 12-14). Vous approchez le monde naturel en premier lieu en tant qu’amateur ; même si vous possédez des connaissances approfondies, cet amour intuitif semble primordial. Le but du livre était-il d’abord de partager votre passion avec le lecteur, de l’enthousiasmer et d’attirer son attention vers le monde vivant autour de lui ? Ou est-ce que le livre est plutôt conçu comme une sorte d’hommage aux oiseaux ?
Fabienne Raphoz : C’est plutôt le livre de poésie Jeux d’oiseaux dans un ciel vide. Augures (Éditions Héros-Limite, Genève, 2011) qui fut conçu à la fois comme un hommage à tous les oiseaux (chacune des quelque 180 familles de leur ordre y est représentée) et comme un refuge pour les espèces en voie d’extinction. Hymnes – chants de louange, joie de nommer – et élégies – déploration des disparitions – y alternent, parfois sous forme de simples listes, afin de tendre vers une sorte de totalité de la réalité oiseau et faire comme si, chemin faisant, « je » , c’est-à-dire le poème, les protégeait tous. Truc de gosses, quand nous jouions au mentir-vrai, « on dirait que je serais princesse » , ce livre fut conçu comme une sorte de talisman ou de gri-gri, pour panser la douleur du ravage, perceptible de printemps en printemps. Et si le livre, au terme de sa construction, fut dédié à la mémoire de la Fauvette à tête noire, surnom que je donnais à ma mère, j’ai réalisé, une fois la parution, et la réception critique dont il a fait l’objet, que cette dédicace était polysémique sans que je l’aie consciemment voulu. Dédier tout un livre consacré aux oiseaux à la mémoire d’une espèce parmi les plus communes des campagnes – non glyphosatées – revient à pratiquer, comme dans Terminator, un flash forward sur l’extinction totale du vivant, et même si je ne me prends pas pour une John Connor de la biodiversité, j’ai eu, dans ce livre, l’ambition d’être une des archivistes témoignant, au nom des oiseaux, pour les temps futurs.
Avec Parce que l’oiseau, comme vous l’avez senti, au-delà d’une passion ornithophile, qui pourrait paraître personnelle, comme par exemple collectionner des netsukes, j’ai tenté de partager, sous forme de chroniques, qui mêlent journal d’observation, souvenirs, recherches ludiques, cette évidence-là qu’est au fond l’oiseau, sans qu’on n’en ait vraiment conscience. Car l’oiseau est – pour le moment –, une évidence, où que vous habitiez, si vous ouvrez votre fenêtre, même en ville. Et par son omniprésence, par la facilité avec laquelle on peut observer sa manière de vivre et, plus loin, de reconnaître des différences entre les espèces, voire entre les individus, et bien, l’oiseau, cette évidence non domestiquée qui apporte toute la forêt sous nos yeux, dans nos oreilles, est lui-même une fenêtre ouverte sur toutes les autres évidences inaperçues mais qui sont bien là, à portée de regard, à portée d’ouïe, et sur toutes les aventures extraordinaires qui se passent à chaque instant pourvu qu’on y prête le minimum d’attention : du comportement territorial d’un rouge-gorge, dont les coups de gueule ravissent nos oreilles, aux variations des bruissements du vent dans les arbres, selon qu’il fasse faseyer des feuilles de peuplier ou des aiguilles de pin.
L. P. : Ce concept grec de « philia » est repris dans le nom de la collection que vous avez créée chez Corti, « Biophilia ». C’est une collection très diverse, où sont réunis des essais, de la poésie, des romans… Outre des auteurs francophones, la série inclut également des œuvres classiques du nature writing anglo-saxon (John Muir et Aldo Leopold) et quelques textes signés par des « grands noms » de l’environnementalisme , comme Paul Shepard et Edward O. Wilson. C’est la curiosité pour le monde du vivant qui semble constituer le fil rouge dans cette grande variété des textes. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer cette collection et pour quelle raison ? Y avait-il selon vous une sorte de vide à combler dans le champ littéraire française ?
F. R. : Entre l’édition et l’écriture, il n’y a pas de frontière.
Se documenter pour un livre en cours de fabrication, c’est soudain découvrir que tel ou tel titre manque ou n’a pas été traduit. Car la fabrique du texte a précédé celle de la création de cette collection. Et comme la création est née, au-delà d’une curiosité pour tout ce qui vit, d’une prise de conscience d’abord assez souffrante, du ravage, à laquelle il fallait que je réponde, comme pour me rassurer, comme on se raconte des histoires, enfants, pour faire fuir les monstres qui sont sous le lit, cette collection, dédiée au vivant, s’est comme imposée d’elle-même.
Cette question essentielle qu’est, pour reprendre les termes de Jean-Christophe Cavallin (Valet noir, à paraître en avril), notre entrée dans une ère de terreur (pour notre espèce) et de pitié (pour tout ce qui vit), est non seulement par nature interdisciplinaire mais en outre, la notion de Biophilie (empruntée au livre de souvenirs éponyme de Wilson) m’a parue bien plus englobante que celle, dépassée, de « nature » ou celle, trop ambiguë, d’écologie.
Une collection est une création, elle ne comble pas tant un vide, qu’elle n’invente le vide qu’elle comblera. Il se publiait déjà, il y a dix ans, pas mal de livres sur l’écologie, l’environnement, l’éthologie, la « nature », etc. ou des récits littéraires dans lesquels ces questions étaient abordées ou sous-jacentes (voir la somme de Pierre Schoentjes, publiée dans la collection Les Essais), mais une collection qui rassemble et accueille des textes d’époques, d’horizons et de champs disciplinaires ou linguistiques aussi divers, qui puissent dialoguer avec la création littéraire en cours, il ne me semble pas. Je commence d’ailleurs, depuis quelque temps, à recevoir des textes écrits par des auteur.e.s de langue française et il me faut moins puiser dans l’immense réserve des textes anglo-saxons.
(Voir aussi la présentation de la collection : http://ecrit-cont.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique81 et un entretien accordé à ces étudiants : http://ecrit-cont.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique83)
L. P. : Pensez-vous que ce genre de livres répond à un besoin dans la société actuelle qui est tourmentée par une pandémie mondiale et par le sentiment d’alarme causé par la crise environnementale ? Nous voyons par exemple que beaucoup de gens ont retrouvé le chemin vers la nature lors du confinement. Les livres de ce genre pourraient-ils fonctionner comme un réconfort ou comme une sorte de soulagement dans ce contexte ?
F. R. : Nous prenons d’autant plus conscience de ce à quoi nous tenons que nous risquons de le perdre. Et, comme vous le soulignez, cette crise sanitaire a été / est toujours un révélateur de notre attachement viscéral au vivant. C’est vrai, il n’a jamais été autant question de printemps et de chants d’oiseaux dans ce silence de l’anthropophonie et je reçois bien plus souvent qu’avant cette crise des messages d’ami.e.s me demandant des précisions ou une aide pour identifier telle espèce, tel chant.
C’est donc évident que dans un tel contexte, une collection comme « Biophilia » permet d’accompagner cette prise de conscience, et de multiples façons, en invitant concrètement à voir et écouter ce qui passe et se passe à portée du regard et de l’ouïe (Carson, Baker) ; en réinventant une langue poétique qui soit à la hauteur du ravage (Vinclair), en montrant qu’il est possible de changer de vie (Robert), en comprenant mieux les comportements des espèces qui nous entourent (Seton, Heinrich).
L. P. : Le livre Parce que l’oiseau est difficile à catégoriser : c’est votre carnet d’été, donc une sorte de journal intime qui comporte en même temps des données biologiques, des citations littéraires et des anecdotes historiques. Est-ce qu’il a été difficile pour vous de trouver l’équilibre entre cette approche personnelle et le côté scientifique ? Cette hybridité générique me semble quelque chose qui revient dans d’autres livres de la collection « Biophilia », par exemple dans La bête a bon dos de Christine Van Acker. Pourriez-vous commenter ?
F. R. : À l’inverse des livres de poésie pour lesquels je pourrais dire comme Lorine Niedecker, qu’il me faut six mois pour écrire trois vers, ce livre s’est comme écrit de lui-même et très vite, au cours d’un été.
Cette forme s’est aussi imposée d’elle-même. Cette balade buissonnière dans le temps présent de la narration, où le souvenir (des voyages et des lectures) était réactivé par analogie avec l’irruption d’un oiseau, comme s’il était un guide, je l’ai vécue, dans le texte qui s’écrivait, avec la jubilation du pisteur, dans la forêt des livres et des souvenirs.
Et puis, de manière plus générale, l’hybridité me semble, littérairement, la plus commode pour approcher et partager cette réalité qui non seulement nous échappe dans sa totalité, mais aussi nous échappe tout court. L’hybridité est au livre, ou à la collection éditoriale, ce que le collectif est à l’action politique.
Face à l’altération profonde et irréversible du monde, ce monde-là « trop limité pour s’étendre [qui] est une terre » (Georges Oppen), nous voilà, qu’on le veuille ou non, qu’on en soit conscient ou non, confrontés de facto à une altération de notre rapport à ce monde dont la littérature se fait l’écho, et la forme hybride, cette boite à outils hétéroclites, me paraît la plus adéquate pour en rendre compte.

Fabienne Raphoz
L. P. : Vous vous intéressez à la disparition des espèces (le dodo, la colombe voyageuse, le Grand pingouin, mais aussi les passereaux de Lord Howe) et vous rêvez d’une « Cour Pénale Internationale des non-humains » pour protéger les animaux. Pensez-vous que la littérature puisse jouer un rôle dans le contexte de crise environnementale et de la « sixième extinction de masse » ? Ou la littérature est-elle seulement une sorte d’élégie sur ce qui est en train de disparaître ?
F. R. : Une posture élégiaque n’est pas, n’est plus, tenable. Une tension entre hymne et élégie, voire, mais désormais le temps manque pour déplorer la perte.
Pierre Vinclair, un poète contemporain dont Corti vient d’accueillir deux livres a trouvé une bonne formule dans ce titre « agir non agir ». Si la littérature ne peut pas agir de façon frontale sur le monde, elle est en constante interaction avec lui, elle est peut-être d’autant plus puissante que sa puissance est imprévisible, comme une formidable bête métamorphe qui non seulement s’adapte mais parfois même a quelques secondes d’avance sur lui.
L. P. : Dans le livre, vous soulignez l’importance des cinq sens dans l’expérience du monde. Vous vous intéressez particulièrement à l’ouïe et vous soulignez l’importance des sons pour déterminer l’espèce d’oiseau. « Le chant précède l’oiseau », écrivez-vous, et votre petit enregistreur de poche vous permet de revivre ce premier moment de contact. L’ouïe est-elle le sens le plus significatif pour une ornithophile ? Estimez-vous que notre société soit trop axée sur la vue ?
F. R. : Chacun profite du sens qui est chez lui le plus développé. Pour en parler jusqu’à l’obsession, oui, je suis très sensible à l’environnement sonore, et à l’inverse de ce que pouvait penser Thoreau en son temps, « tout son est musique », l’oreille est aujourd’hui à ce point pervertie par l’anthropophonie (les sons qui émanent exclusivement de l’activité humaine, chiens compris) qu’il est de plus en plus difficile de jouir d’un paysage sonore bio- ou géophonique, en gros des sons « naturels », dans lequel les bruits humains viennent s’intégrer avec harmonie. C’est vrai, je perçois la qualité d’un biotope à l’intensité de ses sons naturels. J’ai beaucoup plus de plaisir de reconnaître l’oiseau par son chant, j’ai l’impression, aussi naïf que cela puisse paraître, que nous sommes en relation. L’oreille me rapproche plus de l’environnement de la bête, qu’une paire de jumelles, même si je ne boude pas le plaisir de la longue observation.
Peu importe le sens qui prime, pourvu qu’on ait ou qu’on retrouve un usage sensible du monde, qu’on le caresse du regard et de l’écoute.
L. P. : Votre livre contient une réflexion sur l’acte de nommer et de classifier les entités naturelles. Tandis que la langue est souvent considérée comme le « propre de l’homme », donc ce qui nous sépare du reste du vivant, vous semblez affirmer le contraire et vous développez une fascination pour la nomenclature scientifique. Est-ce que la langue, l’écriture et la littérature permettent de se rapprocher de la nature ?
F. R. : Le boulot de la poésie, dans ce fameux nouveau rapport au monde qui est en train de se construire, c’est aussi, du moins pour moi, d’inventer, réinventer ou dénicher une langue qui ne soit pas en rupture mais renoue avec le lien perdu, car ce lien, même dans la langue, a existé (dans les contes mimologiques, étiologiques, dans les mythes, dans la langue elle-même – le loriot, comme la huppe, Upupa epops, disent leur nom) existe encore, chez certains peuples qui n’ont pas été aculturés. Paul Shepard et tant d’autres qui ne me reviennent pas en mémoire, ont pu émettre l’hypothèse que la musique et la danse sont nées de notre lien avec notre environnement, la rupture, sur l’échelle des temps longs est, au fond, très récente. Quel linguiste n’a pas rêvé mettre une oreille dans le concert du vivant, Homo sapiens, H. neanderthalis, compris, du temps des préhistoriques ?
Et puis, souffrir du ravage que notre espèce a opéré sur son environnement revient un peu à parler dans la langue de l’ennemi, un ennemi intérieur certes, un ennemi spécifique (notre espèce) et non particulier (notre individu) et il me semble que le créateur peut se donner les moyens de sortir de cette aporie en inventant une langue médiane, pour ne pas dire médiatrice. J’en suis loin, évidemment, mais c’est tout l’intérêt de la création poétique.
Dans le cadre de cette réflexion sur la langue, sur une écopoésie de la langue, détourner la fonction adamique hiérarchisante et clivante des nominations, en puisant au cœur même des nominations dites savantes, jouer avec elle, comme parfois certains « nominalistes » ont pu jouer avec les noms, est un geste qui peut produire du poétique. C’est une manière de détourner la hiérarchie et les généralités pour en faire, grâce à notre langue justement, une amitié particulière, une relation.
La chouette hulotte qui est dans le pin du jardin ne s’est évidemment pas « rapprochée » de moi au motif que j’en ai fait l’une des héroïnes du livre Parce que l’oiseau, mais ma relation, mon amitié envers Lady Hulotte, pour la nommer, en a été renforcée. Aussi naïve que puisse paraître cette réflexion, je la revendique comme une forme de relation.
Enfin, sur le terrain, Il y a aussi, dans ces classifications, ces nominations, un attrait tout simplement ludique, passer du grand angle – le paysage, au zoom, c’est faire l’expérience du particulier dans le foisonnement, en suivant un jeu de piste, c’est peut-être réveiller un vieux réflexe de pisteuse ou de cueilleuse qui devait choisir dans ce foisonnement sans se tromper, c’est-à-dire, classer, ceci se mange, ceci soigne, ceci est dangereux, dans un rapport trophique que sous-tendait la connaissance intime de son environnement.
Pour citer cet article :
Laura Pauwels, Fabienne Raphoz, « “L’oiseau, cette évidence non domestiquée qui apporte toute la forêt sous nos yeux, dans nos oreilles”. Entretien de Fabienne Raphoz avec autour de Parce que l’oiseau » in Literature.green, décembre 2020, URL: https://www.literature.green/entretien-fabienne-raphoz-parce-que-loiseau/, page vue le [date].
