LA SÉLECTION 2022 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (1)
« Une forme d’explosion connectée »
Entretien de Céline Minard avec Hannah Cornelus autour de Plasmas
Céline Minard est l’une des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2022. Ce prix récompensera en avril « un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes ». Les années précédentes, Emmanuelle Pagano, Serge Joncour, Vincent Villeminot et Lucie Rico ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui chacun à sa façon font résonner notre rapport à l’environnement. Pour la troisième année de suite, Literature.green a réalisé des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
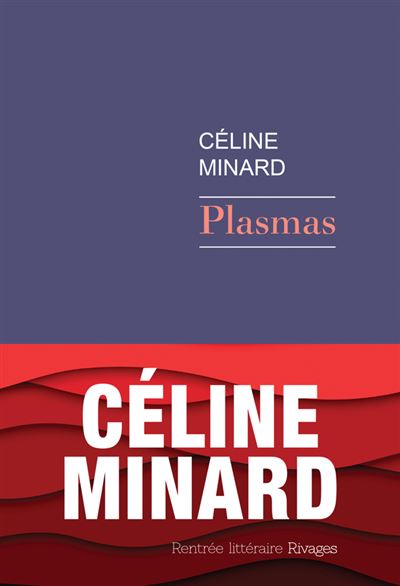
Céline Minard est née en 1969 à Rouen. Après des études de philosophie, elle se consacre à l’écriture. Elle est l’autrice de plusieurs romans, dont Le Dernier monde (Denoël, 2007), Faillir être flingué (Rivages, 2013, Prix du Livre Inter), Le Grand jeu (Rivages, 2016) et Bacchantes (Rivages, 2019). Dans Plasmas (Rivages, 2021), elle nous plonge dans un univers post-humain déstabilisant, à travers une écriture à la fois sensuelle et cérébrale.
Hannah Cornelus : Dans Le Grand Dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique (Wildproject, 2021, traduit de l’anglais), le romancier Amitav Ghosh suggère que le roman réaliste moderne, qui se concentre généralement sur le développement moral ou psychologique d’un ou de plusieurs personnages (humains), dans un cadre temporel et spatial assez restreint, s’adapte mal à la narration de la crise environnementale, qui est trop diffuse et trop complexe à concevoir. Votre texte Plasmas – je ne sais pas si on peut l’appeler « roman » – se compose de dix nouvelles ou fragments distincts qui gravitent néanmoins autour d’une même thématique, celle des rapports à la nature non-humaine dans des mondes futurs. De cette manière, le texte semble donner forme à la tension caractéristique de l’Anthropocène, entre d’une part l’éclatement déroutant, la fragmentation et l’imbroglio, et d’autre part la cohésion et l’interconnectivité du monde. Cette forme-là, s’est-elle imposée dès le début ?
Céline Minard : Cette forme s’est effectivement imposée. Ce n’est pas le résultat d’une décision, mais d’une intuition ou d’une perception du monde contemporain qui a cette forme d’explosion connectée. Nous en faisons l’expérience tous les jours, et nous l’avons particulièrement sentie durant ces derniers mois en multipliant les échanges, les réunions professionnelles ou amicales au travers des canaux numériques qui sont des signes de liens autant que des agents séparateurs des corps. Tout le monde est relié, mais tout le monde est séparé, et chaque cellule indépendante développe quelques fils minces, impalpables, presque fantomatiques, pour conserver et entretenir un semblant de contact avec d’autres. Paradoxalement, alors que nous avons envahi la planète entière, le monde humain en est au même point que le monde animal, confinés dans des territoires circonscrits, nous sommes tenus de prendre mille précautions pour circuler, d’emprunter des couloirs balisés, sécurisés, c’est-à-dire surveillés, et de montrer patte blanche à chaque frontière – et elles se sont démultipliées. Plasmas est construit par blocs, en niches, en fragments arrachés à une totalité dont la cohésion se lit encore, mais seulement dans les interstices et les échos. Ce n’est pas uniquement le futur proche, le très lointain, mais le présent, le passé géologique, et le possible qui sont évoqués, de façon simultanée. Parce qu’à mon sens, nous sommes au cœur de l’explosion et tous ces blocs flottent autour de nous, ils sont accessibles à la pensée, ils sont sous notre nez et dans notre imaginaire. Je ne suis pas sûre que le roman soit incapable de rendre compte de l’état du monde, c’est un genre très élastique, et tout peut s’y trouver exposé et questionné. Il existe beaucoup de tentatives pour sortir du roman bourgeois familial ou psychologique, encore faudrait-il que les médias aient envie de les relayer. Mais il est sans doute plus rassurant, dans une période angoissante, de rester dans ses charentaises et de se contenter de plaisirs régressifs.
H. C. : Avec de nombreux autres penseurs et écrivains, Ghosh plaide pour l’invention de nouvelles formes narratives pour raconter les histoires de l’Anthropocène. Quel rôle la littérature peut-elle jouer dans ce contexte de crise, qui nous oblige à repenser notre rapport au vivant et à la nature non-humaine ?
C. M. : Le rôle qu’elle a toujours eu selon moi, ouvrir des brèches dans une matière compacte qui serait ce qu’on nomme trop vite le réel, la nécessité, le pragmatique, voire la raison ou le destin. En proposant des voies déraisonnables, des images paradoxales, de nouvelles textures. Pour moi, la littérature est à la fois un exercice de dégagement et un habitat. Dans un moment de transition tel que celui que nous vivons maintenant, pour le moins inédit, la littérature peut constituer l’expérience immédiate d’un changement de perspective radicale. Elle peut indiquer des pistes, construire des liens différents, délirer des relations et des états d’être qui n’ont plus grand-chose à voir avec nos acquis, les règles et les usages qui nous ont constitués jusque-là, dont on pensait qu’ils nous définissaient, et qu’il va bien falloir en partie abandonner.
H. C. : Dans votre texte, vous jouez également avec les échelles temporelles et spatiales, en brouillant les frontières entre le passé, le présent et le futur et passant de l’infiniment loin aux environnements restreints. Les nouvelles se déroulent toutes dans un futur plus ou moins lointain, mais les personnages s’intéressent souvent au passé, par exemple en analysant la destruction de la Terre qui a provoqué une migration vers l’espace, en déterrant des fossiles engloutis par les lacs d’asphalte, en racontant des histoires sur les « Vieux-Ancêtres » d’une nouvelle espèce anthropoïde … De même, vous plongez vos lecteurs dans des environnements aquatiques, aériens ou bien minéraux, dans l’espace cosmique ou bien dans un petit recoin de la forêt. Est-ce pour vous une manière de tester les limites de la forme romanesque ?
C.M. : C’est une manière de passer partout plutôt, dans différentes dimensions, et différentes densités d’environnement. En variant les temporalités, les durées, la taille des espaces et la longueur des focales, je cherche surtout à secouer le lecteur, lui secouer les puces, le désorienter pour qu’il soit obligé de se repérer par lui-même, dans une lecture personnelle, active, et qu’il lise pour découvrir un monde, des mondes, plutôt que pour les reconnaître. La forme m’intéresse, mais je ne pars pas d’elle, elle advient, quand la matière et la langue sont posées, elle est un phénomène qu’on peut constater une fois le livre écrit, ou lu. Pour moi, une lecture est une immersion, de plus en plus, je cherche des textes qui fournissent une expérience, une expérience sensuelle, qui est toujours une expérience de pensée, à laquelle je n’aurais pas pensé. Placer le lecteur dans un défaut de proprioception, ou dans un trouble perceptif, au milieu d’un environnement étranger, qui se familiarise peu à peu, ou l’inverse, c’est lui donner la possibilité de se redéfinir, plus ouvert, plus riche, de se replacer, et de prendre sa propre mesure. Nous sommes très savants, nous sommes capables d’observer l’infiniment grand et l’infiniment petit, nous avons des archives énormes, des capacités projectives et prospectives impressionnantes, rien ne sera de trop pour agir et penser autrement.

Céline Minard dans la nature: « Je suis dans l’arbre disons, le pin. »
H. C. : En exergue, vous citez l’écrivaine de science-fiction américaine Ursula Le Guin. Votre texte s’inscrit en quelque sorte dans cette lignée de science-fiction, de cli-fi ou de récits post-apocalyptiques, moins présente en France que dans le monde anglophone. En ce qui concerne le rapport de l’humanité au monde naturel, est-ce qu’il y a d’autres textes qui vous ont inspiré pendant l’écriture de Plasmas?
C. M. : Durant le premier confinement, je n’arrivais à rien lire sinon Ursula Le Guin (et Les Misérables de Victor Hugo). Elle a produit une œuvre considérable, très sensitive, très intelligente, que j’admire profondément et dont j’ai saisi à ce moment-là toute la portée. Ce n’est pas un hasard si elle a pris chez ses parents des tournures d’esprit anthropologique, qu’elle a transformées en fictions concrètes, avec une rigueur et une liberté totale. Parce que l’étude d’autres humains, ou d’autres non humains provoque une capacité d’estrangement assez puissante pour nous amener à prendre conscience de nos propres impensés. Dans cet esprit, j’ai beaucoup cherché chez des auteurs comme Stépanoff, Viveiro de Castro, Vinciane Despret, Donna Haraway, Fernand Deligny, en gardant en tête des lectures plus anciennes comme Descola, en revenant à des classiques comme Lévi-Strauss, John Muir et à des livres fétiches plus échevelés comme Les Techniciens du sacré de Jérôme Rothenberg. J’ai fait une lecture hallucinée de Mousse de Klauss Modick, en plein jardin sur un fauteuil zéro gravité, qui a été une expérience physique. J’avais terminé Plasmas, mais quand même.
H.C. : Il me semble que la chute ou le « saut » constitue un motif important à travers les différents fragments (les acrobates, la trajectoire de la boule numérique, le « monolithe » tombé de l’espace, la chute de Duane). Pourtant, comme dans l’exergue de Le Guin, les personnages et les histoires « reste[nt] là, suspendu[s] » et les fragments n’ont pas de « vrais fins ». Est-ce la citation de Le Guin qui vous a inspiré ce choix d’écriture ?
C.M. : Non, mais quand je suis retombée sur cette phrase de Le Guin, par hasard, en cherchant un texte à lire pour un festival qui me l’avait demandé, je suis tombée en arrêt. Elle décrivait parfaitement ce que j’avais fait, ou voulu faire. C’est la magie des infusions littéraires.
H.C. : Votre écriture se caractérise par une grande précision et par une attention constante aux détails. La corporalité, les sens et les gestes sont également primordiaux : de cette façon, vous soulignez la matérialité des corps et du/des monde(s). Il me semble que cette dimension charnelle est souvent absente dans les récits post-apocalyptiques, qui adoptent couramment un ton plus rationnel ou distant. Pourriez-vous commenter là-dessus ?
C.M. : Peut-être parce qu’il y a assez peu de technologie dans Plasmas, ou qu’elle n’est pas, en tous cas, la grande affaire dans aucun de ces textes. Il y a une phrase de Spinoza qui m’a toujours fascinée et que je ne comprends pas, que je cherche peut-être à comprendre à chaque fois que j’écris, qui dit quelque chose comme personne ne sait de quoi le corps est capable. C’est une de mes obsessions, de quoi le corps est capable, quelles techniques il développe, quelles limites lui sont supposées qu’il dépasse sans cesse.
H. C. : Le titre du livre, Plasmas, semble indiquer une sorte d’état intermédiaire, non-fixe. De plus, vous mettez en scène de nombreuses créatures hybrides et étranges, qui défient nos catégorisations habituelles (les chevaux-loups, le lichen-plasmode, les robots androïdes, les Eips, les animons, les poulpes magiques, une sorte de paresseux-végétal …) et qui vivent souvent en symbiose entre eux ou avec leur milieu. Est-ce un appel à dépasser nos classifications trop rigides et notre anthropocentrisme nuisible ?
C. M. : C’est un appel à la métamorphose, c’est sûr. À ce qu’elle a d’inévitable, c’est la vie même, et à ce qu’elle a de désirable, de monstrueux, de perturbant, de gracieux. C’est aussi le cœur du livre, ces différents nouages entre les formes mouvantes des êtres, non plus juxtaposés mais plongés comme dans un bain total, et dans une disposition de porosité. Personne n’est étanche, tout est vivant. Les classifications se défont à force d’hybridations et de coopérations. L’humain n’est plus le référent, l’identité est labile, le contraire d’une idée fixe, le contraire même d’un fait, c’est une construction en train de se produire, instable effectivement, comme l’équilibre dynamique. Il y a parmi mes personnages des animaux non transformés, mais je me réjouis de voir qu’ils ne sont pas nécessairement reconnaissables, ou qu’on leur trouve un drôle d’air, des compétences inattendues, des extensions végétales ou minérales tout à coup étonnantes. Plus on inclura de facteurs et de sensations ou de puissances dans la saisie d’un autre, plus on enrichira notre compréhension et notre propre puissance.
H. C. : Dans les mouvements écologiques actuels, les jeunes assument souvent un rôle important, avec des figures de proue comme Greta Thunberg. Dans le dernier fragment du livre, qui en devient d’une certaine façon le récit-cadre, vous décrivez une révolution menée par de jeunes gens, inspirée par la Kuin visionnaire. De nombreux autres fragments montrent également des personnages jeunes. Pourriez-vous nous en dire plus ?
C.M. : Je crois et j’espère beaucoup dans les jeunes gens et particulièrement les jeunes femmes qui se manifestent aujourd’hui, prennent le taureau par les cornes et le secouent comme un vieux tapis. Greta Thunberg est d’un courage et d’une cohérence infaillibles, elle me souffle. Elle dit clairement le roi est nu, et personne ne peut lui opposer un fait contradictoire. Il y a un vieux monde qui en train de s’asphyxier, j’espère qu’il n’entraînera pas les autres à sa suite, et dans ce vieux monde, hors d’atteinte, irréductibles, il y a des voix, des corps, des présences comme celles de Greta Thunberg qui permettent de respirer encore. C’est clairement un portrait de Greta Thunberg avec Obama qui a déclenché le dernier chapitre du livre, je savais que ce serait le dernier et que tous les textes, toutes les chutes précédentes, devaient mener à ça, un discours non prononcé, une révolution en cours.
