LA SÉLECTION 2021 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (2)
Enquête et poésie pour nourrir l’imaginaire écologique
Entretien de Luc Bronner avec Sara Buekens autour de Chaudun, la montagne blessée
Luc Bronner est l’un des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2021. Ce prix récompensera en avril « un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes ». Les années précédentes, Emmanuelle Pagano, Serge Joncour et Vincent Villeminot ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui, chacun à sa façon, font résonner notre rapport à l’environnement. Pour la deuxième année de suite, Literature.green a réalisé des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
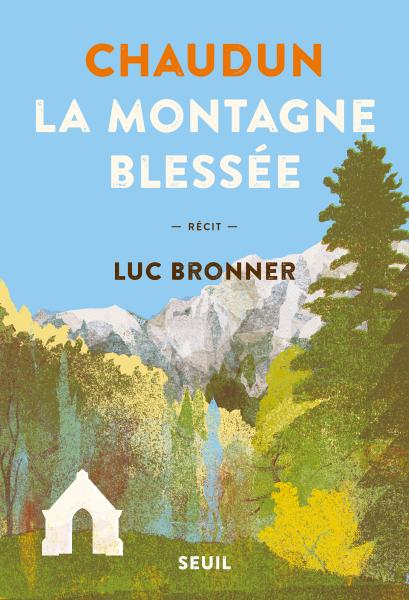
Luc Bronner est un journaliste et écrivain français. Ancien directeur des rédactions du Monde, il s’est déjà vu décerner le prix Albert-Londres de la presse écrite. Chaudun, la montagne blessée (Éditions du Seuil) est son quatrième ouvrage. Il retrace le désastre écologique et humain d’un petit village dans les Hautes-Alpes, région dont l’auteur est familier depuis son enfance.
Sara Buekens : La quatrième de couverture indique que Chaudun la montagne blessée est un récit, genre littéraire qui entretient un rapport étroit avec l’expérience du monde et découle d’une enquête. La part de fiction s’y réduit en faveur du témoignage, du documentaire et de l’expérience vécue. Il en résulte que votre livre présente de nombreuses similitudes avec Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, par exemple, ouvrage historique d’Emmanuel Le Roy Ladurie consacré à un village des Pyrénées ariègeoises. L’abandon de la structure romanesque et de ses contraintes narratives et imaginaires est-il lié au désir d’écrire une « œuvre écologique », dans laquelle une attention pour l’expérience immédiate du monde et pour le savoir scientifique devient primordiale ?
Luc Bronner : Le désir de raconter cette histoire vient de mon enfance, des longues marches dans les vallées de montagne et de la fascination que les ruines de ce village mystérieux avaient fait naître dans mon esprit. Je suis parti de la mémoire orale, celle que m’avait transmise mon père en me racontant le destin des habitants de ce village. L’enquête était indispensable parce que je voulais raconter, au plus près du réel, ce qu’avait été la vie des habitants, comment les villageois avaient détruit leur environnement et pourquoi ils avaient dû fuir ; mais Chaudun n’est pas un livre d’enquête parce que j’ai volontairement, avec un immense plaisir de surcroît, laissé s’exprimer mon imagination pour représenter des scènes, des moments, des émotions, des pensées et, plus encore, pour faire ressentir la poésie de la montagne et de la nature, les parfums, les couleurs, les lumières.
Quand je décris la neige qui vole, et ce silence extraordinaire qui suit une chute de neige, quand j’imagine l’odeur des hommes rassemblés dans une petite pièce un soir d’automne 1888, quand je représente l’enterrement de Félicie Marin morte à 17 ans, et dont la tombe est aujourd’hui le dernier témoignage de la présence humaine dans cette vallée, je prends appui sur la littérature et sur une forme de romanesque. De ce point de vue, Chaudun est sans doute difficile à classer, à la fois enquête et poésie, récit et littérature, quête personnelle et plongée dans des archives manuscrites précieusement conservées depuis plus d’un siècle.
La réflexion sur la langue était essentielle dans ma démarche. J’ai beaucoup travaillé mon écriture à l’oral. Seul, dans mon bureau, dans ma cuisine, dans mon salon, j’ai lu Chaudun à haute voix. Cinq ou six fois intégralement, patiemment, pendant des jours, jusqu’à épuisement ou presque, notamment au cours de mon dernier mois de travail ! La première fois, c’était terrible… Vous lisez votre propre texte, sur lequel vous avez déjà passé un nombre incalculable d’heures, et vous entendez votre voix buter sur des imperfections tellement évidentes et démoralisantes que la lecture silencieuse n’avait pas permis d’entendre. La lecture orale est sans pitié, c’est douloureux, c’est long, éprouvant, mais c’est, je crois, d’une très grande efficacité. La deuxième fois, c’était un peu mieux. Puis la troisième, la quatrième, et ainsi vous polissez votre texte, comme le ferait un artisan sur une pièce de bois. Dans mon esprit, c’était tout sauf accessoire : cela correspondait à mon désir profond d’être celui qui conte une histoire. La langue orale, c’est celle des histoires que l’on se raconte devant un feu de cheminée ; j’avais envie que Chaudun puisse être reçu comme une histoire orale imprimée, et plus encore comme un conte écologique où le personnage principale est une vallée de montagne.
S.B. : Dans votre récit, vous citez de nombreuses études scientifiques et sources historiques. À cela s’ajoutent aussi quelques œuvres fictionnelles, comme L’homme qui plantait des arbres de Giono, que vous décrivez comme « un des plus beaux manifestes écologiques » mais que vous opposez à l’histoire de Chaudun qui elle est « vraie ». Quel rôle accordez-vous à ces œuvres de fiction qui ont servi de source d’inspiration pour votre récit ? Quel rôle peuvent-elles encore jouer dans le contexte actuel de la crise environnementale ?
L.B. : Je crois dans la puissance extraordinaire de la littérature pour changer le monde parce qu’elle provoque l’émotion, l’imagination, le rêve, le voyage, là où les essais ne convoquent que la rationalité ! Pour vous répondre, les œuvres de fiction peuplent mon imaginaire, là où les essais ou les études finissent dans ma bibliographie. C’est très différent, et les premières sont en réalité tellement plus décisives… Dans ma longue quête sur cette montagne blessée, et sur l’écologie à la fin du XIXe siècle, j’ai lu beaucoup de textes de géographes, d’historiens, de botanistes, de forestiers, et il me semblait légitime de les citer, ne serait-ce que par honnêteté. Mais l’invisible est infiniment plus important. J’aime depuis toujours la littérature qui m’emporte sur une ligne de crête entre la fiction et le réel, quand je ne sais pas, comme lecteur, dire ce qui est inventé et ce qui est tiré du réel. La première lecture qui m’a complètement bouleversé pendant mon enfance fut Germinal de Zola : je me souviens avoir pleuré de rage face à l’injustice ressentie, si vraie et si romanesque à la fois. De sang-froid, de Truman Capote, m’a captivé pour son écriture clinique – tous ces détails incroyables. Trois soldats de Dos Passos, Les raisins de la colère, de Steinbeck, Voyage au bout de la nuit, de Céline… J’aime les livres qui disent notre humanité ou notre inhumanité, qui racontent les destins minuscules bien plus que les grands personnages, qui disent ce que sont les hommes et les femmes face aux catastrophes. Enfant, j’ai aussi rêvé des aventures contées par Frison-Roche – j’avais l’impression de gravir les montagnes avec ses héros. Giono, bien sûr. Mais je ne voulais pas d’un livre qui raconte les exploits des alpinistes – pour reprendre une métaphore, la littérature s’est beaucoup penchée sur les « premiers de cordée » beaucoup moins sur les montagnards taiseux.
S.B. : Dans votre récit, vous n’hésitez pas à assumer votre présence en tant qu’auteur. Les parabases et les adresses au lecteur sont abondamment présentes et portent souvent sur le style et le vocabulaire des documents que vous citez. Quel rôle accordez-vous à ces passages méta-textuels ?
L.B. : Comme autant de clins d’œil amusés au lecteur qui m’a suivi jusque-là ! C’est un moment, différent, où je laisse un peu plus encore s’exprimer ma subjectivité. Je reprends l’image du conte lu devant un feu de cheminée : c’est l’instant où votre grand-père ou votre grand-mère s’arrête quelques secondes pour donner un peu de suspense ou bien joue de sa voix pour dramatiser un passage – et tous vos sens se mettent en alerte parce que la voix vous indique qu’il se passe quelque chose. La variation de la voix, les secondes qui s’écoulent… Quel bonheur pour celui qui lit et pour celui qui écoute !
Modestement, je cherchais donc, à l’écrit, ces instants qui relèvent de la théâtralité d’une lecture orale. Il y avait, pour les citations de textes originaux écrits à la fin du XIXe siècle, le bonheur de souligner la beauté, impressionnante, émouvante, de la langue utilisée. Je pense par exemple à cette lettre extraordinaire écrite par les habitants de Chaudun en octobre 1888 que j’ai reprise intégralement. J’ajoute, si je veux être parfaitement honnête, que c’était aussi une façon de jouer avec la langue : il y avait une part de plaisir égoïste en écrivant ces passages méta-textuels, par exemple en conseillant au lecteur de lire à voix haute la prière du curé Vincent prononcée en 1872 au fond de la vallée de Chaudun pour réclamer à Dieu une météo plus clémente. J’imaginais alors un lecteur ou une lectrice, dans son lit, sous sa couette, avec la lampe allumée, en position semi-allongée, lisant cet extrait à voix haute à côté de sa compagne ou de son compagnon, et celle-ci ou celui-ci qui interrompait sa propre lecture, et le regardait, interloqué, amusé, en entendant prononcer cette prière si incongrue aujourd’hui !

Luc Bronner
S.B. : Dans vos descriptions du monde naturel, des végétaux qui envahissent les restes des constructions humaines, des saisons qui modifient et déterminent l’aspect des lieux, des animaux qui par leurs traces marquent le territoire, vous avez souvent recours à une écriture imagée, voire poétique, par exemple lorsque vous évoquez comment au printemps « la douceur de l’air redevient une caresse sur la peau ». En outre, la nature, les règnes animal et végétal et les éléments sont dotés d’une certaine intentionnalité, d’un dynamisme, comme le suggèrent de nombreux verbes d’action et d’intention. Ainsi, ce sont les torrents qui « autorisent » ou non la traversée des humains. Cette écriture poétique diffère fondamentalement de celle qui sert à évoquer les êtres humains, plutôt factuelle : « Une trentaine de jours après le décès […] Jozef, le veuf, 29 ans, introduit son sexe dans l’appareil génital de Sophie, la petite sœur de Mélanié, âgée de 19 ans. Au moins une fois. » Pourquoi avez-vous opté pour ces deux écritures différentes ?
L.B. : Cette poésie m’est venue naturellement, elle n’était pas pensée au début de l’aventure qu’a représentée l’écriture de ce livre. C’est l’accouchement de l’épilogue qui a marqué une forme de révélation pour moi. Je ne savais pas avant de me relire que je pouvais écrire de cette façon en laissant s’exprimer cette douceur. Je l’ai beaucoup travaillé ensuite. C’était une façon de dire la place modeste de l’homme face à la nature – l’écologie commence là, je crois. C’était aussi un hommage à la beauté des paysages. Cela ne signifie pas, pour autant, que la nature ne soit pas brutale, injuste. Les paysans sont les premiers à ressentir sa dureté, bien loin d’une vision romantique, et à Chaudun la nature a été terrible pour les hommes, elle l’est toujours pour les animaux sauvages. Dans mon esprit, dans Chaudun, les deux sont présents : la violence des torrents qui débordent et ravagent tout sur leur passage ; la douceur des sous-bois quand la lumière d’été vous conduit à chercher un peu d’ombre ; les avalanches qui détruisent, arrachent, écrasent ; la neige qui volette et atténue les bruits ; les animaux qui s’entretuent sans pitié ; les tapis de fleurs qui renaissent au printemps…
Pour les êtres humains, j’ai emprunté des sentiers différents selon les moments. Celui de l’émotion, quand j’imagine Félicie Marin adolescente, jeune femme qui meurt dans des circonstances inconnues et qui est devenue mon fil narratif. Celle de l’humour quand je décris longuement les nez des habitants de Chaudun – ceux des mâles, en tout cas, parce qu’ils figurent dans les descriptions des conscrits au service militaire. J’avais envie, aussi, d’aborder l’intimité des couples, les rapports entre les hommes et les femmes – c’est fascinant de constater que l’on sait beaucoup de choses sur les guerres, les empereurs, les peintres et si peu sur les chambres à coucher de nos ancêtres. Je cherchais donc une forme de rupture, de surprise, dans l’écriture au moment d’imaginer Joseph et Sophie faire l’amour moins d’un mois après la mort de la première femme de Joseph alors qu’elle vient de donner naissance à leur premier enfant. Pour le sexe de Joseph et « l’appareil génital » de Sophie, je voulais exprimer une forme de brutalité à travers la description clinique de la scène. Quelle avait été la liberté de cette jeune femme face au mari de sa grande sœur décédée quelques semaines plus tôt ? Pouvait-elle dire non à cet homme plus âgé ? Refuser d’avoir des relations sexuelles avec Joseph ? La sécheresse de la description me permettait de livrer mon intime conviction sans pour autant l’écrire. Et ainsi d’exprimer ce qu’était alors la place des femmes, leur moindre liberté, leur dépendance, leur absence de reconnaissance, leurs conditions de vie encore plus difficiles que celles des hommes.
S.B. : Dans des listes, très nombreuses dans votre récit, vos énumérez des noms de torrents, de champs, de lieux-dits, de sentiers… Ces listes servent-elles à susciter l’admiration du lecteur pour la richesse des paysages décrits ou répondent-elles à un désir de conservation, constituant les archives d’un monde disparu ?
L.B. : Il y avait un désir de conservation, de mémoire. Dans le premier chapitre, j’ai écrit une liste d’enfants morts, une quarantaine de filles et de garçons décédés à Chaudun dans les dernières années d’existence de ce village. Leurs conditions de vie étaient tellement difficiles qu’ils et elles mouraient en grand nombre. J’ai beaucoup hésité, j’ai enlevé cette liste, je l’ai remise, je l’ai enlevée à nouveau, et finalement je l’ai laissée parce que cette énumération des prénoms, des noms, des âges était en réalité très importante. Écrire leurs noms, c’était faire entendre les murmures de ces enfants, 120 ans plus tard, leur laisser une trace dans notre mémoire. Cette liste m’émeut toujours quand je la relis. Même chose quand je revois la tombe de Félicie.
C’était aussi, vous avez raison, le goût des mots, la mélancolie de ces lieux nommés et oubliés, le petit bonheur d’entendre ces descriptions. Écoutez les mots des « lieux dits » qui sont autant de lieux de mémoire : le clot des fossiles, le Constillon, la belle colline, le jas du font, pré la dame, mont clair, les crottes, les millets, la navette… C’est beau, non ? Tous les lieux sont ainsi nommés, y compris des vallons ou des ruisseaux minuscules. La topographie a du sens évidemment. Ce que l’homme nomme raconte aussi l’importance des choses. J’ai été aussi touché par les noms des animaux et des plantes, par le savoir accumulé par les botanistes, par la variété des dénominations : l’épipogon sans feuilles, l’astragale toujours vert, l’échinops à tête ronde, la scutellaire alpine, le rhapontique à feuilles d’aunée. Et les oiseaux ! Le circaète Jean le Blanc, la bondrée apivore, le niverole des alpes, le gobemouche noir… Je ne m’en lasse pas. C’est très beau, et cela dit aussi que l’homme n’est qu’une espèce parmi toutes ces espèces. Quelle jouissance d’observer et de partager cette nature redevenue libre et sauvage ! L’effet d’énumération de ces noms avait quelque chose de merveilleux et de poétique après le récit d’une histoire aussi triste et difficile.
S.B. : Votre récit oppose deux temporalités : d’une part, celle des constructions humaines, qui se sont révélées éphémères, d’autre part, le rythme des éléments du monde naturel, qui s’inscrit dans une répétition éternelle. À une époque où d’autres écrivains retrouvent le sens de l’épique pour dire la vitesse de notre modernité technologique pourrait-on dire que vous préférez explorer les vertus de la lenteur ?
L.B. : La lenteur est un privilège extraordinaire. J’ai écrit ce livre comme un marcheur sur un sentier. J’adore marcher, très longtemps, j’adore cette perte de temps qui est un gain de soi, j’aime sentir la déconnexion du monde et la reconnexion à la nature. Donc oui, la lenteur fait partie intégrante de ce livre. La lenteur est aussi une forme de promesse ou de pari. Face à la crise climatique, il va nous falloir apprendre à ralentir. Freiner notre consommation, repenser nos loisirs, apprendre à nous nourrir différemment… La difficulté, c’est que ralentir ne fait pas un projet politique populaire pour gagner des élections. Mais ralentir, c’est le défi de notre génération et des suivantes : si la littérature peut aider, c’est justement en nourrissant nos imaginaires autrement. Lire, c’est déjà ralentir un peu. Entendre les histoires de nos ancêtres. Observer les paysages. Marcher. Rêver. Parler. Ralentir…
S.B. : Tout au long de votre récit, vos décrivez les effets des problèmes environnementaux, dont les habitants de Chaudun sont eux-mêmes les responsables, aux niveaux économique et social. Vous vous concentrez ainsi sur la misère humaine dans toutes ces facettes, causée par le surpâturage et le déboisement, sans toutefois décrire les altérations qui touchent les animaux et les végétaux qui habitent ces mêmes endroits. D’où vient ce choix que certains écologistes radicaux qualifieraient peut-être trop facilement d’« anthropocentrique » ?
L.B. : J’adorerais écrire un livre similaire du point de vue des animaux ou des végétaux. Quel défi extraordinaire, je suis bien incapable de savoir si je saurais faire ! Pour Chaudun, je voulais raconter le destin d’une petite communauté d’hommes et de femmes, leurs vies, leurs souffrances, et ce choix, si difficile, de quitter leurs terres parce qu’ils ont eux-mêmes détruit leur environnement. Les habitants de Chaudun n’étaient pas des réfugiés climatiques au sens strict mais des réfugiés environnementaux, très certainement. Chaudun raconte l’impact négatif de l’homme sur la nature, loin d’un discours nostalgique sur des temps passés forcément meilleurs ; il témoigne aussi de la résurrection de la nature après que d’autres hommes et femmes ont planté plus de quatre millions d’arbres et que d’autres hommes et femmes encore, plus tard, ont défendu l’idée d’en faire un sanctuaire naturel. C’est ainsi l’expression d’une part d’espoir : il est toujours possible d’agir, et cette montagne blessée est devenue un lieu exceptionnel aujourd’hui. Je ne voulais pas d’un livre qui fait la morale – les écologistes se trompent, je crois, lorsqu’ils défendent une vision moraliste et religieuse du changement – j’avais plutôt envie de montrer ce que l’homme peut détruire et ce qu’il peut reconstruire ensuite. Chaudun est aujourd’hui un lieu magnifique, avec une biodiversité incroyable et fragile – la grande différence c’est que l’homme n’y vit plus.
Pour citer cet article:
Luc Bronner, Sara Buekens, « Enquête et poésie pour nourrir l’imaginaire écologique. Entretien de Luc Bronner avec Sara Buekens autour de Chaudun, la montagne blessée » in Literature.green, février 2021, URL: https://www.literature.green/bronner-chaudun/, page consultée le [date].
