Contre la carence de l’imaginaire : du Larzac aux nouvelles communes.
Entretien de Jean Rouaud avec Pierre Schoentjes autour de L’Avenir des simples
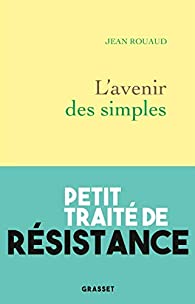
Avec L’Avenir des simples (2020) Jean Rouaud signe un pamphlet qui s’assume comme tel, avec les outrances et les raccourcis de pensée que le genre permet. Mais c’est aussi un plaidoyer généreux en faveur de la simplicité, sur arrière-plan de consumérisme généralisé et avec pour horizon le futur de la planète. « Simples », central dans le titre, fait référence simultanément aux hommes ordinaires, cette grande majorité de non-spécialistes dont la vie et l’opinion sont de moins en moins considérés, mais aussi aux plantes médicinales des anciens jardins d’abbaye qui rappellent qu’il existe un savoir-faire disponible à chacun. Ces « simples »-là ne sauraient en effet être confisqués par les grandes compagnies qui dirigent – et polluent – le monde avec pour seule ambition – estime l’auteur – de réaliser des profits. Jean Rouaud entend défendre tout particulièrement la cause animale, dans le prolongement de prises de positions fortes – et évidemment contestables – qui se donnaient déjà à lire dans un livre consacré à la préhistoire et à son art : « La pitié viendra quand il sera possible de superposer les images de châlits des camps de concentration avec les cages des élevages en batterie de poulets et de veaux. Ce même entassement, cette maltraitance extrême, et si peu de considération pour la vie » (La Splendeur escamotée de frère cheval, 2018). Aujourd’hui, Rouaud estime plus que jamais qu’en décidant d’abandonner l’alimentation carnée et lactée tout le monde possède la capacité de faire levier : « Plutôt que le grand soir, un amoncellement de petits matins ».
Pierre Schoentjes : Derrière l’indignation, l’on entend dans ton livre la voix d’un homme qui a connu les années 70, qui étaient marquées à la fois par le triomphe de la société de consommation et par le mouvement de « retour » à la nature. Une frange minoritaire de la gauche s’était à l’époque mise à penser un autre rapport à l’environnement, sur le mode contestataire, pacifique et antinucléaire. Tu cites Le Sauvage, le supplément du Nouvel Observateur qui finira par se saborder en 1981 pour donner toutes ses chances à François Mitterrand, alors même que Brice Lalonde faisait partie de l’équipe de rédaction. On pourrait aussi rappeler La Gueule ouverte, sans doute plus radicale. Ou encore mettre l’accent sur le mouvement du Larzac dont l’importance est majeure et sans doute sous-estimée. Est-ce que ces combats étaient déjà les tiens, ont-ils marqué ton imaginaire ?
Jean Rouaud : Ces combats ont non seulement marqué mon imaginaire mais ils sont mon socle formateur, de même que la théorie littéraire des mêmes années est au départ de ma réflexion sur le roman. J’étais même au Larzac lors du grand rassemblement de 73 mais n’en ai aucun souvenir, d’abord parce que les gendarmes nous ont interdit la montée sur le plateau, ensuite pour cause de coma éthylique puisqu’il n’y avait rien d’autre à faire (à vingt ans on supporte moins). Globalement les détracteurs du mouvement assimilaient les écolos aux babas-cool : shit et fromage de chèvre, cheveux longs et poil dans la main – il en reste toujours quelque chose dans la pensée dominante – mais spontanément j’ai adhéré à ce mouvement de pensée. Peut-être aussi parce que je venais de la campagne, même si mon enfance n’avait rien de rural. J’étais à peu près insensible aux mirages de la consommation (je le suis toujours) et je me retrouvais dans le côté bricolo qui était aussi mis en avant. On oublie que pendant cette période les métiers manuels étaient méprisés. Ça change aujourd’hui où les intellectuels ont fait faillite (Orwell : « Vous êtes certainement un intellectuel, aucun homme ordinaire ne tiendrait des propos aussi stupides »), mais les écolos de l’époque ont cherché à rebours de la propagande (ne vous occupez de rien, le marché se charge de tout) à se réapproprier tout un savoir-faire décrié et moqué : le pain, les sabots, les fromages, un chauffe-eau solaire, une éolienne à partir d’une dynamo de vélo, la remise en état des bicyclettes de leurs grands-mères. Le bricolage c’est toute mon enfance, les gens autour de moi, à commencer par mon père, étaient capable de tout faire de leur main.
J’étais aussi abonné au Sauvage, merveilleuse revue trimestrielle qui ne se contentait pas des questions liées à l’écologie mais s’ouvrait à d’autres centres d’intérêts qui changeaient des « humanités ». C’est par elle que j’ai découvert René Girard, qui était pratiquement inconnu. Mais aussi les philosophies orientales, la poésie chinoise et japonaise (côté amérindien on publiait Pieds nus sur la terre sacrée) et je me souviens de cet interview de Rezvani avec une photo de la mystérieuse Lula. C’est dans ces années que j’ai lu avec passion les « dissidents » de la modernité : Kerouac, Henry Miller, mais aussi Kenneth White. Tu cites Brice Lalonde qui a ensuite dérivé jusqu’à faire alliance avec Alain Madelin (droite libérale, venu d’Occident dans sa jeunesse) mais c’était alors un jeune homme cultivé, brillant, drôle qui tranchait au milieu des poids vraiment lourds de la politique, de Marchais à Giscard d’Estaing. L’affiche des Amis de la terre pour les municipales de Paris qui paraissait alors utopique correspond quarante ans plus tard au programme de l’actuelle mairie : vélo, énergie renouvelable, et ferme sur les toits.
P.S. : Ton pamphlet porte la marque d’un parcours personnel, qui t’a amené à rejeter depuis quatre ans l’alimentation carnée et lactée. « Pitié pour nos frères moutons, cochons, poulets, saumons, nos sœurs vaches, brebis, oies, truites, que nous consommons en tranches, en hachis », écris-tu, et serais heureux déjà si quelques lecteurs pouvaient suivre ton exemple. Sans doute, mais au-delà de l’importance, incontestable, du bien-être animal, la question écologique ne demande-t-elle pas une politique et pas seulement une éthique personnelle ? Que peut la littérature dans ce domaine ?
J.R. : L’idée de L’Avenir des simples est aussi de proposer un projet politique, de montrer qu’un engagement moral personnel peut être une force de frappe formidable contre les « multimonstres » sans qu’il soit besoin de « militer » au sens habituel. Les 70 milliards de têtes de bétail sont une source de profit incomparablement plus grande que nos sept milliards de vies. Par là, on peut peser politiquement, économiquement sur des organisations puissantes qui nous semblent hors d’atteinte. Cette « décarnation » a en outre le quadruple avantage d’éliminer la souffrance animale, de soulager ses propres artères, de réduire la pollution atmosphérique terrestre et maritime (tout va à la mer), et de contrarier le système mafieux (Monsanto, Bayer, Sanofi, les semenciers etc) qui ne tient que par notre alimentation carnée et lactée.
P.S. : L’Avenir des simples est écrit sur le mode de l’utopie, assumé comme tel, même si tu avances des pistes concrètes. En réalité ton livre est au moins autant une défense de l’imaginaire qu’une défense de l’environnement. J’en veux pour illustration les critiques que tu adresses aux « spécialistes », aux « experts » et de manière plus générale à la collusion entre la science et le pouvoir. Tu n’es pas tendre avec Claude Bernard…Mais dans le même temps, et comme tu l’écris : « L’imagination au pouvoir est un oxymore ».
J.R. : Je ne supporte pas les experts qu’on nous sort opportunément dès qu’il s’agit de nous faire avaler des bobards. Ils sont pour la plupart appointés par les lobbys. La science est complètement inféodée aux grands groupes. Sur quoi se penche la recherche ? Sur les grandes sources de profits : les télécoms, fusées, satellites, 5G, les vaccins, les prises quotidiennes de médicaments – la rente pharmaceutique – dont on apprend bien plus tard que certains sont pires que le mal -, le nucléaire, (EDF se lançant dans l’éolien off-shore c’est un leurre environnemental avec l’idée que les câbles sous-marins rejoindront de toute façon les compteurs, surtout pas question d’autonomisation énergétique), les OGM, les plantes transgéniques. Et quand on parle de maladies orphelines, il faut bien entendre « orphelines de chercheurs, faute d’en espérer de profits futurs pour cause d’extrême rareté des patients ». Là encore, ce sont les « gilets jaunes » via le téléthon qui viennent au secours des malades. Pas les grands groupes. Et aucune raison d’être « tendre » avec Claude Bernard. Sa « douce et tendre » l’a précisément quitté parce qu’elle avait compris que c’était un serial killer. Et pour enfoncer le clou, elle et ses deux filles devinrent végétariennes.
P.S. : Tu t’en prends volontiers à ceux que tu nommes les « multi-monstres » (Gafa, les multinationales, le monde de la finance) mais tu restes assez discret sur le comportement des états. Penses-tu qu’ils se sont montrés plus vertueux dans leur gestion de la crise environnementale actuelle ? Est-ce pour mieux rassembler que tu évites de pointer le peu d’empressement que la France a mis à embrasser la cause écologique ? Et que tu évites de désigner Paris comme lieu de pouvoir, à côté de New-York, Bruxelles ou Francfort ? Tu épargnes aussi le monde littéraire, qui dans son ensemble n’a pourtant guère été précurseur en matière de défense de l’environnement.
J.R. : Les états sont aux ordres des multi-monstres qui exigent la paix sociale pour faire leurs sales affaires. Leur idéal gouvernemental, c’est la Chine : dérèglement des marchés et poigne de fer. Les états n’ont plus aucun pouvoir financier (ils n’ont plus l’arme de la dévaluation, du protectionnisme, plus les moyens de taxer les multinationales et leurs sièges dans les paradis fiscaux etc.) Affaiblis, endettés, on exige d’eux qu’ils rognent les salaires, les retraites, vendent au privé l’espace et les services publics, et organisent sans trop de heurts la lente glissade de la population vers une « pauvreté acceptable ». En leur pouvoir demeure les questions sociétales (ça occupe les débats et c’est le meilleur dérivatif à leur impuissance : mariage pour tous, légalisation du haschisch, adoption par les couples homosexuels, et s’il le faut on remettra sur le tapis la peine de mort) mais l’essentiel de leur fonction, c’est le maintien de l’ordre. Autrement dit, moins les états ont de pouvoir plus ils se dirigent vers un état policier. Quant au monde littéraire, il suffit de voir la réaction des écrivains pendant la Commune de Paris, tous lamentables. Et la question de l’engagement au XXe siècle est un désastre chez les intellectuels : Sartre refusant le Nobel pour ne pas faire de peine aux Soviétiques, Badiou soutenant Pol Pot, Foucault Khomeiny, et Althusser étranglant sa femme.

Jean Rouaud
P.S. : Tu montres Marguerite Yourcenar sur l’île du Maine, Serge Rezvani dans les Maures, Aldo Leopold au Nouveau-Mexique, Jean Pain à Villecroze, Adrienne Cazeilles en Catalogne … mais tu sembles particulièrement attaché à Elysée Reclus, l’anarchiste-géographe que le grand public redécouvre aujourd’hui. Quand à la fin de ton livre, tu développes une réflexion autour d’un monde organisé en communes – et pas seulement en référence à la Commune, mais aussi à une France communale – c’est encore du côté de l’anarchisme que tu te tournes. Pas celui de Proudhon, évidemment, qui – pour user d’une litote – était peu féministe et que tu vas jusqu’à traiter de « gros con antisémite », mais celui de d’Eugène Varlin, libertaire et membre de la Commune. Qu’est-ce que l’héritage de l’anarchisme peut nous apporter aujourd’hui ? Clairement, ce n’est pas de l’héritage « terroriste » que tu te revendiques.
J.R. : Aujourd’hui l’anarchie renvoie pour les plus instruits à la bande à Bonnot, et « anar » désigne dans le langage courant un original un peu têtu, pas très propre, grande gueule et plutôt bon à rien. On oublie que l’anarchie a été dans la seconde moitié du 19e siècle un mouvement puissant qui s’opposait au communisme de Marx. Fallait-il pour changer l’état des choses un pouvoir fort, central, imposant sa loi et ses mesures, ou au contraire laisser les gens s’auto-déterminer. On sait que c’est l’écrasement de la Commune qui a donné à Marx la réponse. Et on a vu ce que ça a donné en URSS, Chine, Cambodge, Corée du Nord, Cuba, mais je demeure persuadé que c’est au niveau des « communes » qu’on a un vrai pouvoir immédiat de transformation du monde. On expérimente. Telle solution vaudra là, qui ne marchera pas ailleurs, ou peut-être, on essaiera. Les gens ont une vraie capacité à s’arranger entre eux, à s’auto-organiser. Pas besoin de « premier de cordée » qui entraine tout le monde dans sa chute. Coupons la corde. De plus, dans la commune, on travaille sous le regard des proches, des administrés, on se montre plus prudent au risque de la sanction aux prochaines élections. C’est pour cette raison que les cost-killers sont envoyés toujours de très loin pour tailler dans les effectifs d’un personnel local. Sans états d’âme ils tranchent dans une chair qu’ils ignorent. J’étais à Montpellier quand les riverains ont fait reculer Frèche qui voulait faire de la place de la Canourgue, une merveille entourée d’hôtels particuliers du 17e siècle autour d’un jardin à la française, un parking souterrain. Comme il tenait à sa réélection, sous la pression et la ténacité des opposants il a cédé.
Mais le préalable pour moi c’est de renoncer à un universalisme qui ne tient pas compte des cultures, des différences de comportements, des pratiques, des imaginaires, de l’histoire, et qui toujours, politiquement, économiquement, écologiquement, se révèle une catastrophe. J’ai une vraie sympathie pour tous ces gens que tu cites. Il me plait de me savoir de leurs bords. Ils sont ma famille. Rezvani : « Quand on s’aime il faut partir », Adrienne Cazeilles : « Il ne faut pas tuer tout ce qui dérange », Elysée Reclus se déclarant « légumiste ». Et Varlin est l’exemple isolé de ce que devrait être un engagement politique. Alors que Proudhon s’oppose au travail des femmes, il explique à la tribune de l’AIT à Genève que priver les femmes pauvres de travailler c’est les condamner à la prostitution. Il plaidera en vain, mais c’est lui encore, au moment où les Versaillais entrent dans Paris et que les dirigeants de la Commune décident d’instaurer un régime de « terreur » (on n’entend même plus ce que ça dit, des gens qui décident de gouverner par la « terreur », Robespierre, quoi) qui se lève, et contre la majorité déclare simplement que lui et ses amis (Lissagaray, Courbet) ne sont pas là pour ça. Il finira assassiné. On ne peut que s’incliner.
P.S. : Tu t’en prends aussi avec une certaine véhémence à la raison, ou plus exactement à la manière dont des appels à la raison deviennent de plus en plus des injonctions qui nous poussent à accepter des compromissions que tu estimes inacceptables. Ta critique des Lumières ne va pas manquer de déranger, dans une France qui appuie sur elle son universalisme.
J.R. : Le pays ne comprend pas qu’en s’accrochant à son « universalisme » il est en train de devenir le conservatoire des lumières, un musée de province vieillot, qu’il se prive des bons outils pour penser le monde à l’heure du réchauffement et de l’épuisement des ressources. L’émancipation des consciences a été évidemment la grande affaire mais quand on voit aujourd’hui à quel point elles sont phagocytées, manipulées, lobotomisées, et toujours au nom de la « liberté » et de la « gratuité », on peut remettre en question certains dogmes. Dont celui de la Raison qui est devenu l’arme fatale des pouvoirs. Je tiens vraiment que le triomphe de la raison s’est réalisé sur une carence de l’imaginaire, autrement dit elle a profité de l’effacement progressif de la pensée religieuse qui se situait évidemment ailleurs et développait un imaginaire infini, inconcevable (les peintures paléolithiques viennent de là, comme les cathédrales gothiques, proprement inimaginables par un esprit sensé). On comprend que « credo quia absurdum » ait eu de quoi perturber les petits esprits raisonneurs. C’est pourtant dans cette tension invraisemblable que se situe le germe de l’inventivité et de la création.
P.S. : J’ai été sensible aux petites scènes que tu fais surgir, ces petits tableaux avec des acteurs particuliers : la vache-bathyscaphe, autour d’Oppenheimer, un conseil d’administration, … Parce que tu estimes que des images fortes, avec une charge symbolique importante, sont les plus « efficaces », dans un texte qui cherche aussi à convaincre ? Est-ce que critiquer la « raison », comme tu le fais, oblige nécessairement à privilégier l’émotion ? La démarche n’est pas sans risque non plus : si ta cause est généreuse, d’autres, à commencer par les populistes, en jouent avec l’efficacité que l’on connaît.
J.R. : D’abord je réagis en romancier, habitué à la reconstitution du réel, « le réel, ça existe » disait Claudel pas gêné par le truisme. Et en poète aussi, c’est-à-dire par images, par associations, correspondances, comparaisons, métaphores, suggestions du vocabulaire lui-même dont le substrat étymologique est une mine de sens. Dès qu’une image se présente au détour d’une phrase je l’enrôle immédiatement jugeant qu’elle ne s’immisce pas là par hasard. Et elle est toujours éclairante. Pas forcément sur le coup. Mais plus tard elle montre toute sa pertinence, ayant entrainé dans son sillage un système référentiel différent d’une analyse classique qui reste tenu par le « raisonnement ». L’image des vaches à hublot dit plus sur la barbarie scientifique que tous les discours moralisateurs. Quant à une quelconque récupération, populiste ou autre, je ne crains pas grand chose. D’abord il faut accepter de suivre mon cheminement qui est tortueux et parfois « désarmant » (mais « pour aller où l’on ne sait pas il faut passer par où l’on ne sait pas » – saint Jean de la Croix). En outre je constate qu’à un certain niveau de manipulation des phrases, les rangs s’éclaircissent.
P.S. : Tu te défends d’avance d’accusations de « pétainisme », même si dans ton cas ce serait plutôt un « pétainisme de gauche » que certains pourraient te reprocher. La critique tombe rapidement, même si l’on sait que Pétain n’a en réalité fait que continuer dans le rapport aux régions (rurales) une politique qui était déjà largement celle de la Troisième République. Comment échapper à ces reproches depuis que, suite justement aux compromissions des « régionalistes » avec l’idéologie fasciste, la défense de la ruralité – et de sa nature – fait résonner l’infâmant « La terre ne ment pas » ? N’est-ce pas plus difficile encore aujourd’hui de faire entendre pareille voix ? Mitterrand posait encore pour ses affiches électorales de 1981 devant un village français, église à l’avant-plan … c’est difficilement envisageable aujourd’hui que les français sont devenus citadins, certainement dans leur imaginaire.
J.R. : Je pense au contraire que c’est plus facile aujourd’hui. Si je fais allusion aux accusations de pétainisme dès qu’il est question de la campagne c’est que j’en ai été victime (Le Monde me lançant « la terre ne ment pas » à la parution de Des Hommes illustres, ce qui était « infâmant », oui, avec la volonté affirmée de littérairement me tuer), mais ce genre de propos ne touche même plus. Personne n’y comprend plus rien, l’inculture gagne et le bagage intellectuel de la gauche s’est tellement appauvri, dévalorisé, que son ultime argument sent le renfermé, le rance, l’aigreur à vrai dire. De l’histoire ancienne, maintenant. Le covid a au contraire redonné aux citadins l’envie de campagne puisque la nature a profité de ce calme soudain pour s’inviter en ville : les concerts d’oiseaux, deux chevreuils marchant au milieu de la chaussée, les dauphins dans le port de Marseille. Les villes se sont développées au fil des siècles autour des foires puis de l’industrie. Internet se chargeant des échanges commerciaux et l’industrie rejoignant les friches, elles perdent de leur pouvoir d’attraction.
Les agences immobilières sont assaillies depuis le déconfinement de demandes de maisons avec jardin, ou d’appartements avec balcons. En fait le mouvement migratoire qui a vidé les campagnes au profit des villes et de l’industrie à partir de la moitié du XIXe siècle (les « ceintures rouges », c’était les banlieues ouvrières), s’est inversé en 1967. Sans que les démographes sachent trop pourquoi. Depuis cette date la campagne en Europe ne perd plus d’habitants. Elle en gagne même en France, par exemple. Et Paris se dépeuple. Comme si 68 et le retour à la campagne des années Larzac avaient déjà été anticipés, n’avaient été que la manifestation d’un désir enfoui d’un retour fantasmatique, inconscient, au « pays » (qui n’est évidemment pas la « nation »). Il est sûr aussi que le télétravail, l’intérêt pour le bio, la permaculture et la prise de conscience aigue de la question de l’oikos, de notre planète en surchauffe vont permettre une nouvelle organisation de la société où les déplacements seront moins prépondérants. Tu parlais d’Étonnants Voyageurs, mais le concept aujourd’hui serait dépassé. Étonnants Voyageurs ? Pour quel bilan carbone ?
P.S. : Même si le roman qui t’a révélé a été publié chez Minuit, tu ne t’es jamais inscrit dans les camps de ceux, formalistes ou ludiques, qui ont privilégié les jeux de l’autoréférentialité. Les Champs d’honneur montraient que dès lors que la souffrance est en jeu, l’ironie perdait de son importance, voire de sa légitimité. Tu répètes dans L’Avenir des simples ton attachement à une littérature qui pense d’abord le rapport au monde. Et tu vas même plus loin aujourd’hui, en imaginant que l’écrivain à un rôle à tenir dans la société. L’engagement est-il à nouveau légitime dès lors qu’il s’exprime en faveur de la cause écologique ? Et quelle forme peut-il prendre dans la fiction ?
J.R. : Je disais plus haut combien l’engagement des écrivains s’était discrédité tout au long du XXe siècle, au point qu’on ne trouve plus à sauver de ce naufrage idéologico-littéraire que Camus et Orwell qu’on sert à toutes les sauces. J’ajouterai Breton dont j’admire ce qu’on lui reproche : son intransigeance. Beaucoup plus difficile à manier pour les bien-pensants de l’heure. Breton qui disait que le déploiement de drapeaux rouges et noirs dans une manifestation était toujours pour lui une grande source d’émotion. Pas récupérable. On peut pourtant adopter son programme en trois points, dont il dit ne pas avoir dévié : la liberté, l’amour, la poésie. La question pour moi est moins celle de l’engagement politique que de l’engagement de la poésie, de sa présence au monde. Je crois que la poésie, pour peu qu’elle se confronte avec le monde au lieu de se réfugier dans l’abscons, est un mode de connaissance aussi pertinent que les sciences dites humaines. J’ai beaucoup lu Ronsard, Agrippa, et comment ils étaient attentifs, soucieux de capter tous les éclats de la réalité sous leurs yeux. La poésie saisit intuitivement ce qui échappe aux penseurs et journalistes. Sur ce plan, le plus formidable témoignage poétique demeure Louons maintenant les grands hommes de James Agee sur la misère des fermiers américains pendant la grande dépression. Poétiquement, historiquement, sociologiquement, je ne vois rien au-dessus.
P.S. : Tu pourrais ajouter la question que personne ne te pose, et à laquelle tu voudrais répondre !
J.R. : Comment se peut-il faire tenir dans une même vie, une éducation catholique en Loire-Inférieure, l’art d’emballer les cadeaux, un prix Goncourt, la visite de la grotte Chauvet (la vraie), la création d’un ballet sur la scène du Bolchoï, la composition d’une chanson pour une interprète yiddish, un diner à Cork avec Donovan (Mellow yellow), la rencontre avec des bisons en Oklahoma, un universitaire gantois au nom imprononçable et aux airs d’Art Garfunkel, l’adoption d’une petite chienne dans une SPA de la Drôme, une fille formidable qui sur scène est comme Bowie et une merveilleuse fiancée juive (et belge )?
Réponse : au moins une bonne étoile.
Pour citer cet article :
Jean Rouaud, Pierre Schoentjes, « Contre la carence de l’imaginaire : du Larzac aux nouvelles communes. Entretien de Jean Rouaud avec Pierre Schoentjes autour de L’Avenir des simples », Literature.green, juin 2020, URL : https://www.literature.green/contre-la-carence-de-limaginaire-du-larzac-aux-nouvelles-communes-entretien-de-jean-rouaud-avec-pierre-schoentjes/ , page vue le [date]
