« Vouloir dire le cru de la vie, la vie nue »
Entretien de Catherine Poulain avec Pauline Hachette autour du Grand Marin et du Cœur blanc
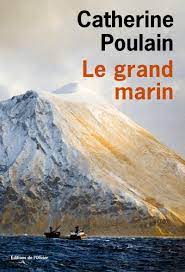
Catherine Poulain a arpenté les grands espaces et les extrêmes pendant de nombreuses années, du Canada à l’Amérique centrale, entre autres lieux. Elle a été ouvrière dans une conserverie de poissons en Islande ou encore sur les chantiers navals aux USA. Elle a aussi pêché 10 ans en Alaska, expérience au cœur de son roman Le Grand marin (L’Olivier, 2016). Depuis son retour en France, elle a travaillé en tant que bergère, ouvrière viticole ou saisonnière. C’est dans le monde des saisonniers en Provence que se situe son dernier roman, Le Cœur blanc (L’Olivier, 2018). Elle vit actuellement entre les Alpes de hautes Provence et le Médoc.
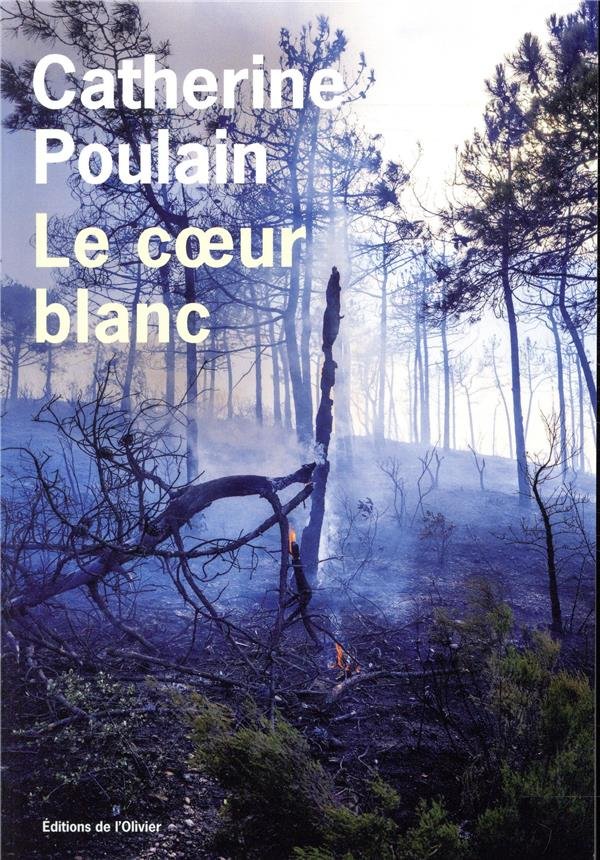
Pauline Hachette : Vos romans, Le Grand Marin et Le Cœur blanc, s’ancrent dans des lieux qui peuvent paraître à première vue opposés : une mer du bout du monde d’un côté, cet élément liquide sur lequel rien d’humain ne semble devoir s’inscrire durablement, et de l’autre la terre de Provence, son soleil, ses cultures plus que millénaires. Quels liens se tissent pour vous entre un (mi)lieu singulier et le désir d’écrire ?
Catherine Poulain : Ces lieux qui semblent contraires sont similaires au fond, ils répondent aux mêmes lois et rythmes, ce côté intemporel de la terre et ses saisons comme celui de l’océan et ses marées avec ses flux et reflux. « L’univers sensitif », comme j’aime l’appeler depuis ma jeunesse, là où naissent les mythologies et les contes, la trame, le canevas sur lequel se tisse la vie, où couve et éclate le feu et se déchainent des tempêtes. Là où nous est révélé le plus vrai de nous-mêmes, notre solitude première (et dernière sans doute), notre fureur, notre impuissance. Mes personnages sont semblables à des petits animaux cernés entre ciel et mer, ou terre, dans l’implacabilité du soleil et des éléments, cherchant une réponse à leur course, ou un sens, qu’ils ne peuvent trouver. Parce que c’est intemporel justement, non le mot n’est pas juste, parce qu’ils sont des humains « finis » qui se heurtent à un infini, autant qu’il existe, qui les écrase et les garde debout pourtant s’il ne les tue pas : le grand marin lorsqu’il embarque, autant blessé et rongé par l’alcool qu’il est, redevient cet être à la carrure quasi-mythologique, mi-homme mi-dieu quand il fait face au large et rugit de sa voix de stentor ; mes saisonniers dans leur vie immédiate et rude, obéissent aux rythmes des saisons, s’y pliant bon gré mal gré, colère, révolte, désespoir.
Les lieux, leur pouvoir, leur emprise sur nous, quels mots pour les dire… Après quelques années de pêche en Alaska, j’ai cessé d’écrire en français. Je lisais beaucoup de littérature américaine, livres que j’empruntais à la bibliothèque lors de mes retours à terre. J’aimais ce côté physique de la langue américaine, direct, brut parfois, ponctuation parfois supprimée dans les dialogues, et alors la parole se retrouve intimement mêlée au récit, à l’image. C’était la voix qui convenait au rythme de notre quotidien hommes et femmes des grands espaces, vivant l’immédiat, la mort très proche, la vie d’autant plus puissante. Mes carnets sont remplis de poèmes très courts, entremêlés de prose brève et imagée. Ecriture brève et sans fioritures. Vouloir dire le cru de la vie, la vie nue. Un jour on m’a prêté quelques livres français, du Giono et un Goncourt de l’époque : ce n’était plus ma langue. Je ne comprenais plus, ne sentais plus la beauté de cette prose qui me semblait lourde, encombrée de tournures inutiles, surfaite en quelque sorte, presque prétentieuse. J’ai compris alors que je n’étais plus de France ni de sa culture. J’étais du Far-West. Je vivais au rythme plus primaire, premier, d’un monde extrêmement physique, obéissant aux lois de la nature qui menaient nos bateaux, de celle de la petite communauté de mes proches, pêcheurs, autochtones, vétérans du Vietnam. Et ainsi quand j’étais saisonnière agricole : mes carnets d’alors relatent un temps exalté « L’été est là, qui brûle mon cœur, qui me lacère de partout avec ses langues de feu… ». L’écriture était souffle et son rythme menait le tempo. Phrases sèches et brûlantes pour tenter d’exprimer l’incandescence de l’été et le hurlement continu des cigales, s’alourdissant parfois comme le poids d’une attente pesant sur les terres assoiffées… Saccadées pour exprimer la course vers et dans le tumulte du Pacifique-Nord. D’autres phrases plus amples et qui s’étirent, à l’image de la vague qui enfle, des grands corps lisses et nus des flétans agonisant sous la lune, Mais peut-être, le ton haché dont j’aime me servir correspondrait-il au côté humain, à ce comportement chaotique de mes personnages, celui plus ample, presque trop lyrique parfois, une manière de dire la terre, le ciel, l’océan, le grand souffle du monde qui les chahute et les balaye ?
Si j’ai choisi dans mes deux livres, de placer mes personnages dans ces milieux de nature puissante, j’ai pourtant retrouvé le grand marin dans ce SDF sur le parvis de la gare Saint-Charles, ce regard absent et enfiévré qui semblait fixer Notre-Dame de la Garde et les flots lointains de la Méditerranée, tignasse et barbe hirsutes de lion déchu, les ailes de ses narines frémissantes, si j’ai reconnu Lucia la louve solitaire du « cœur blanc » dans le visage de cette femme très sombre, anguleuse, aux traits creusés à la serpe attendant devant la gare de Toulouse – sa dose peut-être ?– c’est parce qu’un lieu n’est pas tout en soi, qu’il soit naturel ou créé par l’homme, il charrie une histoire, des histoires qui en appellent d’autres et vous renvoient vers un ailleurs différent encore. Ou vous ramènent au départ. Mes personnages le savent bien, déracinés, apatrides, ceux auxquels la terre entière appartient, villes, ports, terres arides ou forêts. Des sans-tanières, sans-territoire, des errants.
P. H. : Écrire la nature peut signifier, si on pense au nature writing par exemple, vouloir se plonger dans un monde où l’homme est peu présent. Dans vos romans le rapport aux éléments naturels est très présent, mais ce n’est pas un monde de contemplation, c’est un monde que l’on transforme, où on pêche, où on fait pousser et recueille des fruits. Est-ce qu’on vit et écrit autrement le monde qu’on traverse ou dans lequel on se retire, par exemple, et celui que l’on travaille ?
C. P. : Comment habiter la nature ? la vivre ? l’écrire ? Il y a dix mille moyens pour tenter d’y arriver j’imagine…Certains se sentiront la rejoindre grâce à la méditation, la contemplation, le yoga ? Par une retraite où ils trouveront distance et détachement, nécessaires pour les mener à une certaine clairvoyance. Je fonctionnerais plutôt à l’opposé me méfiant du regard « pur » et de son interprétation uniquement cérébrale. En fait, je ne fais pas confiance au seul pouvoir de la pensée. Pour moi, parvenir à l’essence des choses, des êtres et des lieux, doit passer d’abord par une réalité physique. C’est plutôt basique comme démarche. Plus « brutal ». Vivre le monde serait d’abord sortir de soi-même pour le rencontrer, le sentir, s’y confronter, s’y blesser, tout lâcher de soi afin de lui livrer son corps et ses forces vives. « L’âme » suit. Un peu comme l’amour physique, une fusion qui ne peut-être qu’un instant de grâce. Mais j’ai besoin d’un combat sans cesse renouvelé pour parvenir au lâcher-prise de moi-même, afin d’accéder à ce sentiment de plénitude, de « communion » avec le monde. D’autres le trouveront dans une ascèse plus spirituelle ? Il en est de même pour l’écriture. Non plus : je pense donc je suis, mais je sens donc je suis. Je sens donc j’écris ? Le travail qui me menait au bout de mes forces m’amenait à un état d’exaltation qui faisait s’ouvrir des vannes en moi : les mots et images en étaient comme libérés. J’entrais enfin dans « le grand conte », la légende ? Je vivais le livre du monde. Je m’en sentais actrice peu importait le rôle, grand ou petit. Et le besoin puissant me venait de le raconter, jamais dans l’idée d’être éditée. Juste dire, parce que tout se déroulait si vite et fort, parce que je savais que je ne pourrais rien retenir de la merveille et du terrible, à part avec des mots. Ecri-vaine. J’aime ce mot. Tellement vaine.
Depuis très jeune j’ai désiré écrire, peindre, sculpter. Mais quelque chose m’appelait plus loin que des études aux Beaux-Arts ou m’enfermer entre des murs pour rédiger des textes. Il me fallait connaitre l’univers, l’étreindre. M’emplir de lui. L’univers c’était d’abord cette trinité sacrée lorsque j’étais enfant, grandissant dans un petit hameau perdu des Alpes : Dieu (mon père était pasteur…), mes parents et mes sœurs, la nature c’est à dire l’au-dehors, avec ses bêtes, la montagne, le ciel, ses hivers rudes et ses étés lumineux. Je ne me suis jamais éloignée de la nature mais j’ai découvert par la suite le monde sans tanière des errants, des nomades, celui du mouvement : Migrer tels les animaux en changeant de terres suivant les saisons. Dormir dehors. Non pas en ville mais au bord de l’océan, sur la terre chaude ou dans les forêts. « J’ai embrassé l’aube d’été, rien ne bougeait… Au réveil il était midi », ce poème de Rimbaud je me le suis murmuré souvent, m’éveillant sous des arbres !
Mais oui je voulais « créer ». Il semblait que je n’en avais pas le temps. Il me fallait choisir : Ce livre que je désirais tant écrire, je le construirais de mes mains, avec ma vie, qui serait sculpture aussi, et peinture, fauve. Quand je serais vieille et mon corps épuisé, si j’y parvenais un jour, il serait toujours temps de m’y mettre. Mais je prenais des notes, remplissais des cahiers, à la sauvette, de ce monde brûlant. Ma seule vraie liberté j’ai pensé souvent : les mots.
Lorsque j’ai arrêté le métier de bergère, et avec celui-là tous les précédents, vacuité nouvelle, n’ayant plus à devoir risquer mon corps ni à le contraindre dans des travaux physiques éprouvants, ce qui m’avait semblé miraculeux est vite devenu enfermant. J’ai pensé alors : « J’écrivais avec mon corps, avant, et maintenant on me demande de le faire avec ma tête. Cela va me tuer s’il n’y a plus un univers palpable et rude dans lequel je puisse me précipiter. C’est lui qui m’apporte tout. Le flux des mots passe par celui du monde vivant. S’enfermer dans soi c’est mourir. »

Catherine Poulain
P. H. : Vivre de la pêche ou des récoltes de fruits signifie aussi vivre avec les saisons, selon une temporalité définie par les saisons, la force du soleil et le rythme des fruits – cerise, abricots, olives, raisins-, par les pêches possibles. Les organisations humaines sont aussi rythmées par cette temporalité. Est-ce qu’elle crée des façons de vivre-ensemble singulières, dans ces « marges » de la société ?
C. P. : Oui bien sûr. Un mode de vie plus « primaire » parfois ? Et je ne mets dans ce mot aucune notion péjorative, au contraire – L’immédiat, la vie physique, une certaine manière d’être, que certains appelleront brutalité et qui pour moi n’est qu’un instinct de vie donc de mort aussi. Le désir de sécurité est une notion extrêmement restrictive. Dans ces saisons folles, on sort enfin du carcan des normes et du temps « raisonnable », divisé, régi par nos règles sociales ; le temps de sommeil, celui des loisirs, les heures comptabilisées… Une saison de travail, récoltes ou pêche, transhumance ou autre chose, c’est un tout : On entre dedans et on y est jusqu’au bout. Pas de rambardes de sécurité ni de garde-fous (ni de garde-folles oh oui, surtout !)
P. H. : Ces vies de ceux qui travaillent la mer, comme des saisonniers vont souvent de pair avec un semi-nomadisme, avec une façon « d’habiter le monde » qui est ici très concrète : ne pas s’installer de façon pérenne en un lieu, ne pas viser son appropriation. Comment s’articule pour vous l’habitation et l’environnement ?
C. P. : Je n’ai pas trouvé encore… Je ne sais pas. Je pressentais depuis longtemps que vouloir s’approprier un territoire est une chimère. Nous ne sommes que passagers de lieux qui nous reçoivent quelque temps. Aujourd’hui j’en suis persuadée. J’ai acheté et retapé une vieille petite maison rouge depuis le succès du Grand Marin, croyant pouvoir y rassembler mes morceaux de vie épars et trouver enfin une certaine sérénité grâce à un espace qui soit mien, liberté de le recréer comme je le désirais. Une place aussi pour ranger mes livres, carnets de voyage, écrits, entassés dans des sacs de supermarché, et tous mes trésors de pacotille, cailloux, os, plumes, bois polis, glanés sur les plages du monde Je pensais avoir trouvé mon port d’attache en quelque sorte après avoir longtemps erré – Ne plus avoir à craindre de finir dans la rue ou à la merci des autres. Mais un port doit-il être autre chose qu’une halte avant de reprendre le large ? Aujourd’hui, j’imagine que ses murs nouveaux pourraient se refermer sur moi, et parfois j’ai peur que la maison rouge me phagocyte, plante carnivore me digérant lentement… Vais-je m’ankyloser et m’éteindre si je reste ? J’éprouve aussi une étrange culpabilité : moi qui devais finir dans un shelter, ai-je trahi ceux du dehors, cette grande famille que j’ai connue, aimé, avec laquelle j’ai tout partagé si longtemps ? Me suis-je mise à l’abri et éloigné du risque ? Sans cesse je m’interroge : « Quand repartirai-je enfin pour connaitre à nouveau cette légèreté d’aller, la fragilité de l’oiseau sur la branche, cette appréhension et le doute affreux, et cette merveille d’exister, me sentant chaque jour à la merci du hasard ? »
P. H. : Ces milieux de travail sont à majorité masculine. Et vos personnages principaux sont des femmes parmi ces hommes. Est-ce que vous pensez que les liens qu’entretiennent femmes et hommes avec les milieux naturels sont différents ?
C. P. : Je ne pense pas que ces liens soient si différents. Tout dépend sans doute de la manière dont nous appréhendons la nature. Entre le jogging, la marche ou le bûcheronnage, il ne peut y avoir que des ressentis différents. Lorsque j’étais bergère, j’étais fascinée par l’obsession des béliers pour le rut, les combats à mort parfois avec un concurrent, testostérone à l’état pur. Cela m’a permis de réaliser la puissance des hormones. Qui est énorme. Pulsion de vie. Nous en sommes remplis et n’existerions pas sans. Mais les hormones ne font pas tout. Les rapports que chacun et chacune entretiendra avec la nature seront différents parce que nous sommes des personnes distinctes et uniques et en aucun cas je n’aimerais que l’on me définisse par rapport à la paire d’ovaires que je porte en moi ! J’ai tenté depuis l’enfance de ne pas me laisser enfermer dans mon image de fille. Je ne vais pas le faire pour d’autres. On a souvent parlé d’une capacité à préserver la vie qui serait spécifique aux femmes, de leur plus grande empathie, étant plus proches de la nature de manière innée parce qu’elles peuvent donner naissance un enfant. Que dire alors de celles qui ne peuvent pas avoir d’enfant, ou on fait ce choix ? Il y a des femmes de combat redoutables, de jeunes générales, mères, qui ont décidé l’envoi d’armes chimiques sur les civils… Il y a des hommes qui seront des Justes. Des pères qui donneront tout d’eux et seront aussi la mère absente. Des soignants extraordinaires qui sauvent des gens, des oiseaux, des chevaux, la vie quoi ! Ou simplement des poètes.
Sortir du genre. Je ne crois ni aux généralités ni aux clichés. Nous avons nos propres rapports avec le monde qui pour finir se rejoignent. Car la nature nous a créés pour être complémentaires. Certitude que j’ai ressenti très fort lorsque je travaillais avec des hommes que l’on disait issus de milieux machistes, que ce soit d’Afrique du Nord, d’Espagne, du Mexique. Nous œuvrions côte-à-côte et jamais je n’ai rencontré autant de respect à mon égard. Partager un effort et un but commun, ou le faire en parallèle en fonction de nos capacités propres, dans les deux cas, la nature a créé une complémentarité essentielle à l’équilibre du vivant. Il faudrait le retrouver, il est dans nous cet équilibre, il existe vraiment.
P. H. : Le désir qui circule entre les femmes et les hommes, entre les femmes, est un moteur puissant dans vos romans. Il ne se réduit pas au désir sexuel même si celui-ci est très fort. La sensualité des êtres est aussi celle des éléments, le soleil brûlant, les rivières glacées, les âpres mers du nord aussi à leur façon. Mais j’ai également souvent pensé en vous lisant à ce moment de l’Abécédaire où Deleuze dit qu’on ne désire jamais quelqu’un ou quelque chose de façon isolée, qu’on désire quelqu’un avec le paysage qui est enveloppé en lui, qu’on désire « dans un ensemble ». Est-ce un désir de cet ordre qui traverse vos romans, un agencement de choses diverses, un désir « dans un ensemble » ?
C. P. : Oui. Ne désire-t-on pas un être pour tout ce qu’il appelle et réveille en nous d’abord ? Quelqu’un ou quelqu’une ne serait qu’une coquille creuse si on le séparait de ce qui l’a tissé, forgé, tout ce qui l’habite et dont elle ou il est empreint. Le grand marin ne serait-il qu’un homme amoindri par l’alcool, et non pas ce lion furieux qui rugit face à la vague, Rosalinde une jeune femme « au sang un peu chaud » ? – mais Rosalinde n’est qu’une étoile filante dans Le Cœur blanc. Je lui préfère Mounia qui s’énivre de soleil, s’exaspère d’attente, à l’image de cette campagne écrasée de lumière, de chaleur. Derrière la façade de mes paumés souvent à moitié dingues et au-delà leurs contradictions et leur violence, il se cache des univers recélant chacun un bagage mystérieux, fardeau ou trésor, tragédie… cette mémoire secrète des êtres dont nos corps sont l’enveloppe. Iles à la dérive. Prisonnières en eux, nos âmes, créatures errantes. Leur désir attisé et exaspéré par cette incapacité à habiter l’autre, territoire qui restera à jamais étranger.
Le grand marin ne peut être sauvé que par sa rencontre avec l’océan « La mer m’a sauvé, il dit. J’ai bu jusqu’à vingt-huit ans. Jusqu’à vingt-huit ans j’ai été saoul. Et puis j’ai embarqué. Et j’ai aimé cela. Terriblement. » Cette confrontation avec les puissances du monde, et avec lui-même, sa faiblesse et sa réalité d’homme vivant. Mounia se dit « Mounia l’été », « Mounia le vent », avec son amant dévorant, le soleil, qui toujours la plaque lorsque bascule la saison solaire. C’est l’océan pour l’un, les terres brûlantes et leurs rythmes et saisons, leur violence, pour l’autre qui, non pas les révèle, mais dans lesquels ils retrouvent tout ce qui les habite et les maintient debout. Et les fait avancer.
J’ai voulu écrire une histoire sur l’embrasement du désir avec Le Cœur blanc. Il me fallait un milieu sauvage pour la raconter car oui, même les campagnes provençales peuvent être d’une violence extrême. Si mes personnages boivent énormément, ils ont soif de bien davantage que de simple alcool. Ce vide en eux qu’il leur faut combler. Les excès dans lesquels ils se jettent sont le seul exutoire qu’ils parviennent à trouver. Cette faim, ce manque… De liberté ? Laquelle ? Cautériser la douleur ou l’ennui… se consumer sous le soleil, tomber ivre de fatigue, flamber son âme jusqu’au bout, feu de paille pour lui, fusion des corps brûlants, la tension monte, à l’image de cette campagne incandescente qui s’embrase, de l’océan incontrôlable qui se déchaine. Jusqu’à la chute. L’automne ?
Pour citer cet article:
Pauline Hachette, Catherine Poulain, « ‘Vouloir dire le cru de la vie, la vie nue’. Entretien de Catherine Poulain avec Pauline Hachette autour du Grand Marin et du Cœur blanc » in Literature.green, mars 2022, URL: https://www.literature.green/cru-de-la-vie-entretien-avec-catherine-poulain/, page consultée le [date].
