Cultiver la convergence
Entretien d’André Bucher avec Davide Vago

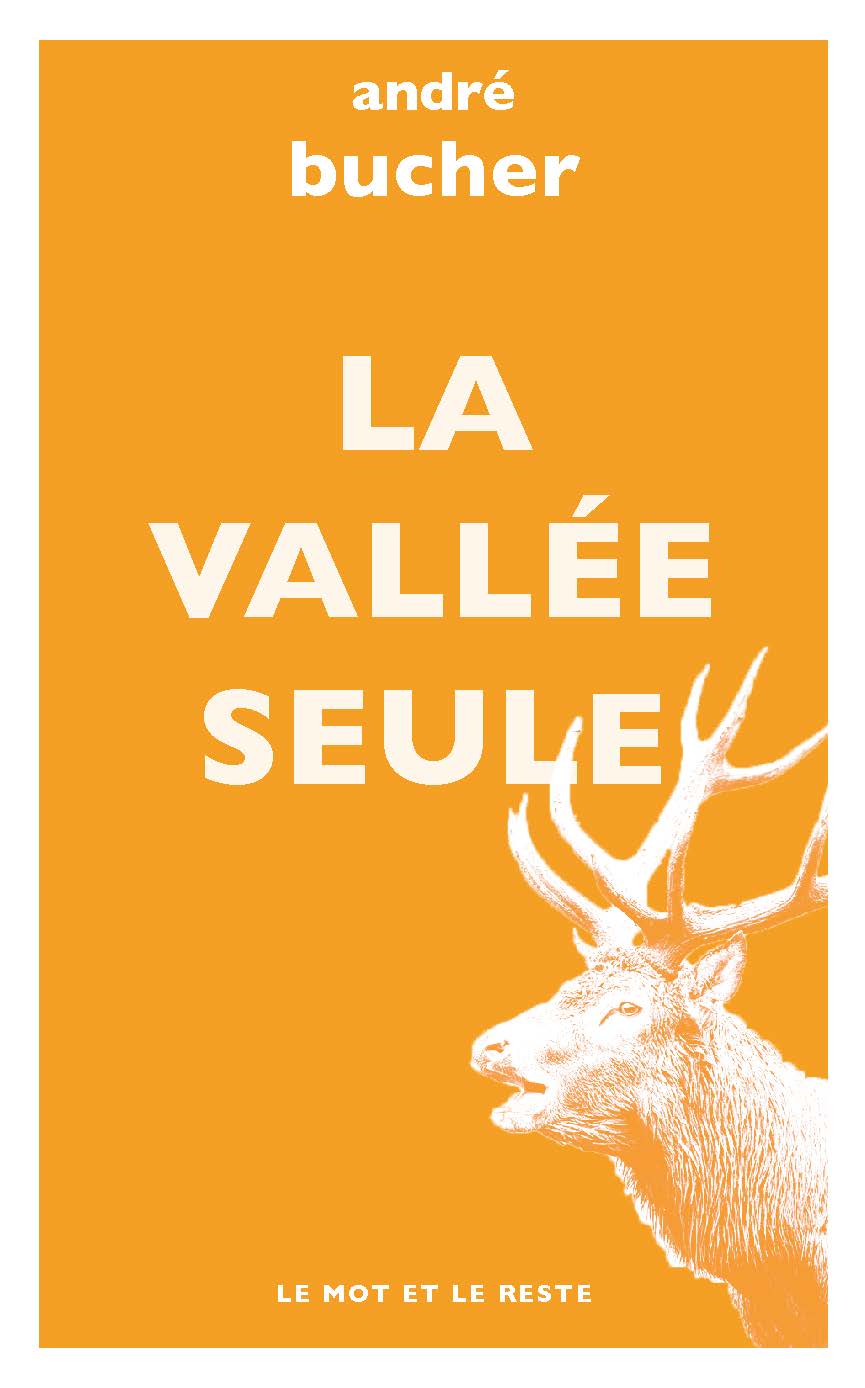
Après des métiers très variés (bûcheron, docker, berger), André Bucher s’installe au cours des années 1970 à Montfroc, au sein des Alpes sèches de la Vallée du Jabron (Drôme), dans une ferme à plus de mille mètres d’altitude. D’abord paysan-écrivain, désormais écrivain-paysan, il a dès lors publié une dizaine de livres, où il donne voix à ces montagnes au climat rude et à ses habitants « rares » et « précieux » (La Vallée seule, exergue). Par le biais d’une écriture densément imagée, il convoque hommes, femmes, animaux, plantes et forces naturelles de sa vallée dans une danse étrangement envoûtante, où l’élan vital se mêle à une subtile inquiétude. Plus proche des romanciers amérindiens que de ses confrères français, il a publié des romans et des récits chez Sabine Wespieser (de 2003 à 2007), Denoël (en 2009) et depuis 2012, chez Le Mot et le reste (Marseille).
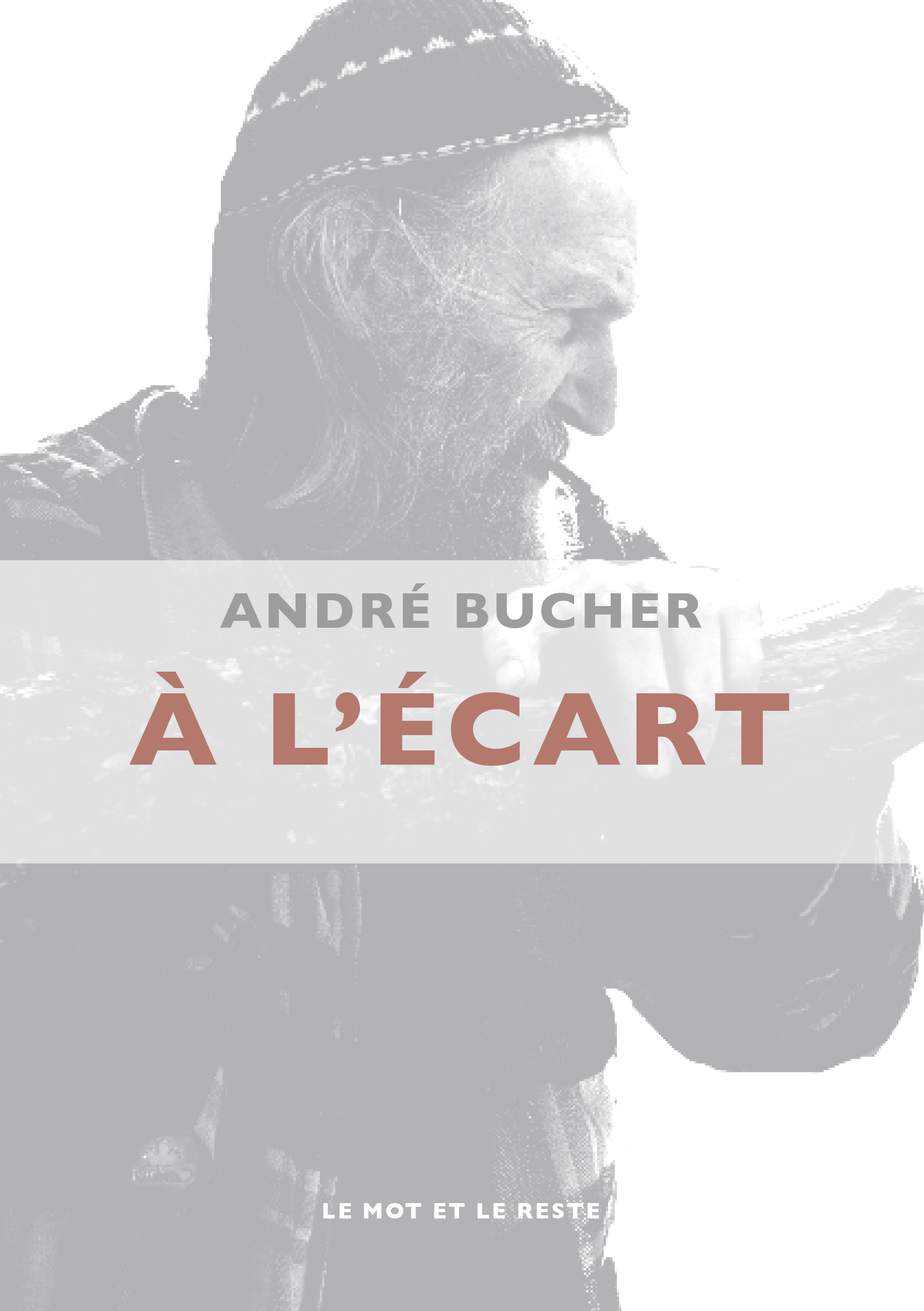
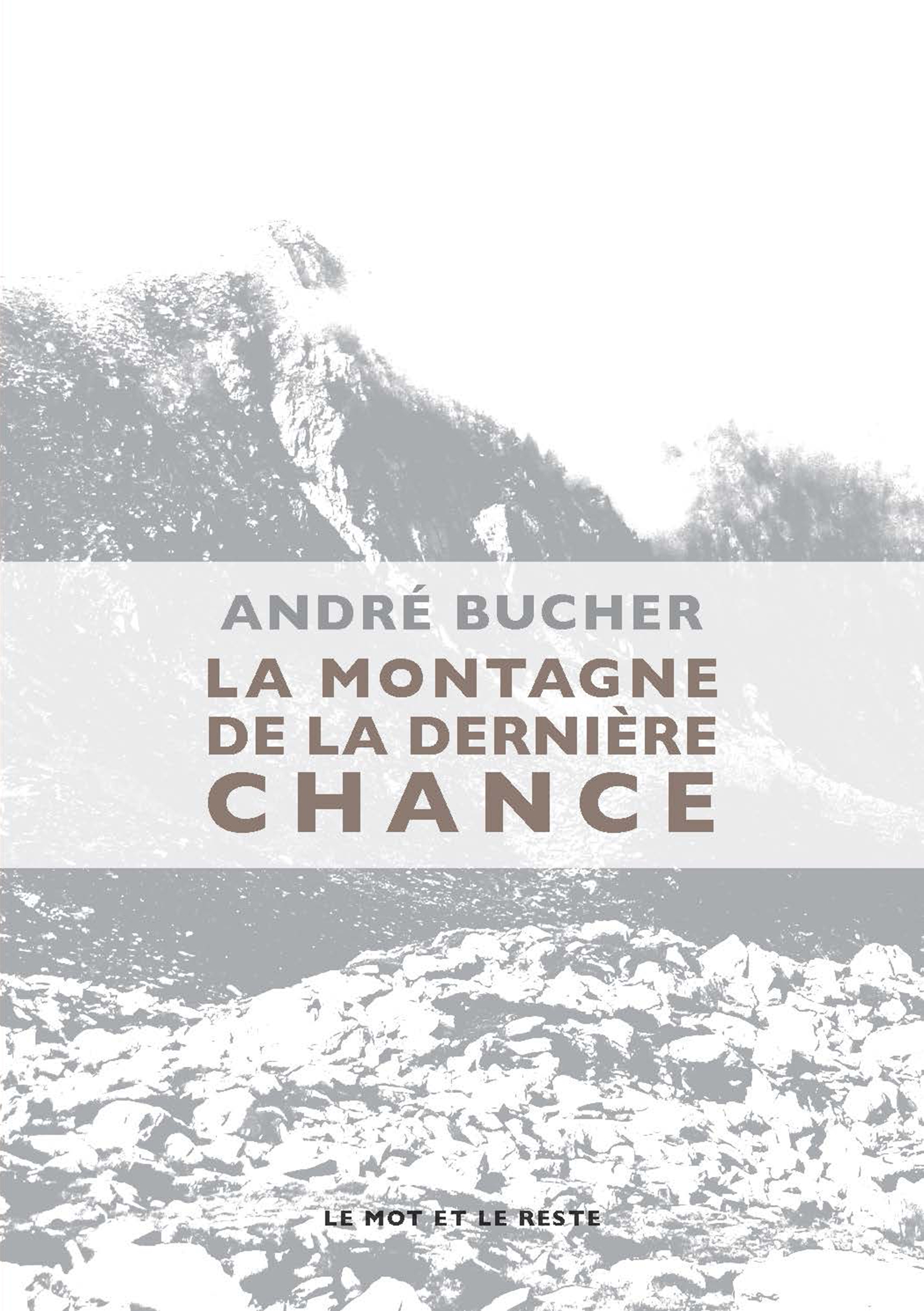
Davide Vago : André Bucher, dans À l’écart vous vous définissez comme « écrivain-paysan », écrivain dans et non sur la nature. Pourriez-vous précisez quelle définition vous donnez à ce mot ambigu et polysémique de « nature » ? Pour certains, la vallée du Jabron, où vous vivez, s’apparenterait à un wilderness – version miniature, bien évidemment – alors qu’à mon avis, c’est une certaine notion de distance qui vous mettez toujours en avant.
André Bucher : Le Petit Larousse donne une définition de nature assez pertinente. « Nature : ensemble des êtres et des choses ou éléments divers qui composent l’univers » ou encore : « qui a trait au monde physique pouvant être considéré en dehors de l’homme ». Ce qui se rapproche de ce fameux Wilderness américain auquel vous faites allusion. Même si ce n’est pas vraiment le cas dans la vallée du Jabron. Au mieux peut-on parler de vie sauvage et d’espace relativement domestiqué dans un pays, un territoire. Or il y a forcément une tension entre l’activité humaine et son environnement, son observation puis l’immersion dans un tel endroit. Dans À l’écart, ces dernières précèdent toujours sa dimension culturelle, d’où la notion de distance (ou écart) que vous évoquez.
D.V. : L’unité du lieu, vous la citez souvent comme l’un des fondements de vos romans. Il m’est arrivé de penser que c’est aussi l’image du « bassin-versant » (watershed), sur laquelle Gary Snyder[1] a beaucoup écrit, que l’on pourrait évoquer pour définir vos romans. La Vallée seule en est à mon avis une parfaite illustration ; vous révélez aussi, toujours dans À l’écart, que les lieux dans lesquels vous demeurez ont « également besoin d’un imaginaire pour [les] maintenir, [les] transporter »[2]. Pourriez-vous mieux préciser cet aspect ?
A.B. : J’ai lu le livre Le sens des lieux de Gary Snyder, ouvrage vraiment passionnant. Le lien avec mon roman La Vallée seule est évident même si celui-ci relève davantage de la parabole, l’unité de lieu venant déterminer le terme plus générique d’écriture dans la nature où effectivement, éthique et esthétique sont indissociables. C’est pourquoi l’idée selon laquelle cet endroit (la vallée où je vis) nécessite un imaginaire pour la maintenir, se justifie, si l’on désire rendre compte de sa beauté et de la fragilité des liens qu’autour d’elle on peut tisser. Ses besoins ne se limitent pas à sa démographie (faible) ni à son économie (difficile). L’imaginaire et l’œuvre du langage la portent, la sous-tendent, insufflant à ses habitants la force nécessaire, l’endurance pour y demeurer et en faire quelque chose de bien. Cette image du bassin-versant propose l’esquisse d’une géographie intime, tout comme l’unité du lieu renvoie à une architecture mentale du roman.
D.V. : L’importance que vous accordez à la saisonnalité me semble un autre principe qui souligne toujours, dans vos romans, le fait que nous sommes soumis, bon gré mal gré, à une certaine cyclicité. C’est aussi un principe de composition narrative pour un romancier, n’est-pas ?
A.B. : Oui, c’est une sorte de principe, de cycle immuable en harmonie avec celui de l’écriture, qui rassemble, définit et déploie les éléments structurants du récit. Cette circularité, mise en mouvement perpétuel, trouve dès lors à s’incarner par la rythmique de la phrase et la musique des mots, elle s’en vient borner les chapitres.
D.V. : Dans La Montagne de la dernière chance[3], et peut-être encore plus dans votre récent roman, Un court instant de grâce[4], j’ai l’impression que vous vous penchez sur les personnages en les développant davantage. Par exemple, vous définissez mieux leur situation (la maladie sénile de Pauline dans La Montagne de la dernière chance), vous insistez aussi sur leur psychologie – que l’on pense à la force de volonté d’Émilie, véritable ‘rejeton’ de la montagne de Palle où vous situez votre roman, qui va s’opposer à un projet farfelu qui prévoit le sacrifice d’une bonne partie de la forêt, même si elle vient de perdre son mari.
A.B. : Dans La Montagne de la dernière chance, j’effectue un parallèle entre la perte–persistance de la mémoire (la maladie dégénérative de Pauline) et la destruction–renaissance d’un lieu. À savoir un canyon échoué comme la baleine blanche du roman d’Herman Melville. Tous les personnages sont livrés aux jeux du hasard et de la chance. Aucun n’est vraiment sauvé mais personne n’est détruit. On découvre la magie de cette montagne, son respir, ses contorsions et, avec elle, la redoutable mesure de ce que nous sommes.
Ensuite, en ce qui concerne mon plus récent roman, Un court instant de grâce, le choix du prénom d’Émilie n’est pas fortuit. Une Émilie rocher et montagne, Émilie poème (Emily Dickinson, Lieu-dit, l’éternité). L’on note une résistance de sa part à faire le deuil de son mari face à la recrudescence d’un sursaut amoureux envers un ami d’enfance qu’elle retrouve cinquante ans plus tard à ses côtés et, aussi, dans la lutte pour la sauvegarde de la montagne menacée de déforestation. Un roman résolument féministe. Pour incarner ce beau personnage de femme, il importait de lui conférer une véritable épaisseur avec, présente en toile de fond, la lucidité, la certitude que l’on ne peut indéfiniment éprouver le sentiment du beau sans qu’il ne génère une sourde inquiétude.
D.V. : Votre fratrie littéraire, ce sont les écrivains de l’ « espace » : votre bibliothèque personnelle en est particulièrement fournie. Les auteurs publiés par les éditions Gallmeister, ceux de la collection « Terre d’Amérique », les amérindiens sont bien présents. On a rapproché souvent votre nom à celui de Jean Giono, ne fût-ce pour la proximité de la montagne de Lure à votre vallée. Néanmoins, il me semble qu’on devrait plutôt vous raccorder à un certain pan de la production romanesque de Ramuz (La Grande peur dans la montagne, Derborence, Si le soleil ne revenait pas), ou je me trompe ? Vous partagez avec lui, par exemple, une fascination pour le silence.
A.B. : À moins qu’également Ramuz, plus désenchanté, et bien sûr, Rick Bass, Louise Erdrich, Joseph Boyden, Joy Harjo, Richard Wagamese, James Welch, Kent Haruf et dernièrement Robin MacArthur, des cousins(es) de chant. Sinon, je reconnais volontiers une fascination pour le silence, du point de vue de la scansion et des temps forts de la phrase, un espace ouvert sous forme de tiret qui permet une respiration. Le silence confronté à un désir de réparation.

André Bucher
copyright photo: Benoît Pupier
D.V. : Par votre style, par vos choix d’agencement syntaxique, vous cherchez à donner voix à ceux qui n’en ont pas : les rochers, les animaux, voire les plantes. Derrière cette pratique, qui manifeste une certaine « porosité du réel », deux notions semblent se mettre en œuvre : la convergence et le partage, deux idées qui ne concernent pas que les êtres humains vivant dans un lieu déterminé. L’écriture de la « porosité », ne serait-ce aussi le rendu littéraire d’une certaine empathie à l’égard de ceux qui nous entourent ?
A.B. : Par cette pratique, en effet, se profile, derrière les notions de convergence et de partage, une tentative de mise à égalité. Individus dont on parle rarement, éléments du cosmos, animaux, plantes, arbres et rochers. Une manière de s’inscrire en faux contre cette vision anthropocentriste du monde comme quoi « notre mode de vie ne serait point négociable »… L’opposition, cette dichotomie entre nature et culture, exige à présent d’être déconstruite car qui dit mode de vie englobe mode de pensée. Il semble urgent d’imaginer d’autres récits et représentations du monde, d’autres interactions en redistribuant les rôles entre les êtres et leur milieu. C’est l’enjeu du vingt et unième siècle, la littérature doit selon moi y prendre part, tout en gardant à l’esprit que ces mêmes interactions peuvent conduire à l’affrontement.
D.V. : L’une des marques qui vous identifie en tant que romancier, c’est le soubassement organique de votre écriture. La densification et le resserrement de la syntaxe, la fulguration métaphorique et l’humour parfois cocasse, l’importance accordée au rythme… Ce sont souvent des procédés propres la poésie que vous arrivez à inscrire dans vos romans. D’ailleurs, votre entrée en littérature remonte aux années 1970, lorsque vous avez publié quelques recueils de poèmes[5]. Y aurait-il alors une continuité, ou mieux une contiguïté, entre poésie et prose ?
A.B. : En tout cas, il y a une constante qui resurgit à l’aune de l’indispensable unité du lieu dans sa nécessité descriptive avec pour volonté de mêler la féerie au réalisme. La poésie incorporée (injectée) au roman permet une réappropriation de l’histoire à raconter par le truchement d’un langage moins formel que dans sa version habituelle, que ce soit en prose ou versifiée. À commencer par le titre, la quintessence, une sorte de hasard objectif pour enchanter, inaugurer le récit, jalonner sa construction jusqu’à l’épilogue. Ce qui explique mon emploi et recours fréquent à des fins ouvertes.
D.V. : André Bucher, je voudrais terminer par deux questions d’actualité. Vous êtes l’un des pionniers de l’agriculture bio en France, et vous n’avez jamais caché vos activités militantes. Les jeunes du monde entier, sous l’égide de Greta Thunberg, semblent de plus en plus conscients de la menace qui pèse sur leur avenir. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que cela touche aussi votre activité d’écrivain ?
A.B. : J’ai déjà abordé le sujet dans l’une des réponses précédentes. On ne peut que se réjouir de la préoccupation grandissante de la jeunesse (du moins une certaine fraction). Souhaitons et tachons de faire en sorte qu’elle débouche sur un engagement concret et pas seulement sur une injonction à agir adressée à la seule classe politique. Ce qui implique individuellement de renoncer à certains privilèges et mauvaises habitudes propres à nous autres, occidentaux ! Sinon, le citoyen que je suis est solidaire, l’écrivain lui essaie juste de se montrer reconnaissant… Son engagement doit rester perceptible sans pour autant constituer une fin en soi.
D.V. : Afin de limiter le réchauffement de notre planète, on a commencé à parler du fait de réduire l’empreinte écologique à travers un quota carbone individualisé. Qu’en pensez-vous ?
A.B. : Ce qui intervient dans le droit fil de la question précédente. Serait-ce le prix à payer pour en comportement vertueux ? Je suis un peu dubitatif sur la fiabilité d’un tel dispositif et réticent également quant à son possible détournement en élément ou moyen de contrainte. (Suivez mon regard, tourné vers la Chine où l’on va jusqu’à attribuer des notes à votre comportement). Ce qui est tout sauf innocent. J’ai la faiblesse de penser que l’on ne limite pas un abus en réprimant une liberté.
D.V. : Quelques mots pour conclure ?
A.B. : Dans le livre À l’écart – pour une fois hors roman, se situant entre la confidence, l’essai et le récit, on trouve un chapitre portant sur les mythes avec, après présentation, quelques embardées poétiques.
Suite à une réaction d’incompréhension de la part d’un de mes collègues écrivains, j’en profite pour expliciter mon propos. Les mythes, tels que je les envisage, ne découlent pas d’une mentalité primitive ou empreinte religieuse qui, de fait, s’opposeraient à une logique dite civilisée et donc sociale ou politique (voire marxiste…).
Non, j’en réfère à une création plus personnelle. Tout écrivain digne de ce nom forge plus ou moins sa propre mythologie. Je les vois comme une forme d’inspiration poétique transcendant les notions de sens et de vérité chères aux philosophes. (Voir un chapitre édifiant, consacré aux mythes dans l’Encyclopédie universelle). Quelque chose comme une autre possibilité métaphorique à sens multiple entre la langue écrite et la parole.
Un exemple. La présence récurrente des animaux dans mes histoires : le héron gardien des lieux, le cerf représentant leur âme, l’ours mythe absolu de la vie sauvage, le corbeau comme conscience, enfin les oiseaux comme une possible transmutation. Et la neige, alors, me direz-vous ? L’oreille blanche, la caisse de résonance (tambour) pour propulser les mots et les sens vers d’autres cieux. (Les yeux des lecteurs…)
[1] Gary Snyder, Le sens des lieux. Éthique, esthétique et bassins-versants, trad. Christophe Roncato, Marseille, Wildproject, 2018.
[2] André Bucher, À l’écart, Marseille, Le mot et le reste, 2016, p. 20.
[3] Publié chez Le mot et le reste, en 2015.
[4] Paru en 2018.
[5] La Fin de la nuit, poèmes, Éditions Grassin, 1970; La Lueur du phare, poèmes, Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1971.
Pour citer cet article :
André Bucher, Davide Vago, «Cultiver la convergence. Entretien d’André Bucher avec Davide Vago» in Literature.green, septembre 2019, URL: https://www.literature.green/cultiver-la-convergence/, page consultée le [date].
