LA SÉLECTION 2022 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (2)
Écrire la crise climatique
Entretien de Thomas B. Reverdy avec Riccardo Barontini autour de Climax
Thomas B. Reverdy est l’un des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2022. Ce prix récompensera en avril « un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes ». Les années précédentes, Emmanuelle Pagano, Serge Joncour, Vincent Villeminot et Lucie Rico ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui chacun à sa façon font résonner notre rapport à l’environnement. Pour la troisième année de suite, Literature.green a réalisé des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
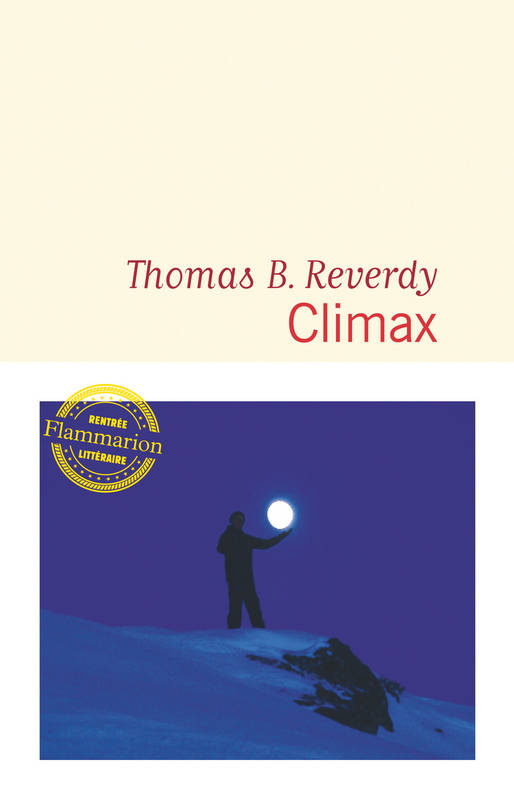
Thomas B. Reverdy est un romancier français né en 1974. Après des études de lettres modernes, il est devenu professeur de français dans un lycée de la région parisienne. Il est l’auteur de sept romans : La Montée des eaux (Seuil, 2003), Le Ciel pour mémoire (Seuil, 2005), Les Derniers Feux (Seuil, 2008 – prix Valery-Larbaud), L’Envers du monde, (Seuil, 2010 – prix François Mauriac), Les Évaporés, (Flammarion, 2013 – prix Joseph-Kessel), Il était une ville, (Flammarion, 2015 – Prix des libraires), L’Hiver du mécontentement (Flammarion, 2018 prix Interallié). Dans Climax (Flammarion 2021), il raconte l’histoire d’un village norvégien menacé par un accident sur une plateforme d’extraction pétrolière et par la fragilisation d’un glacier, sur fond de dérèglement climatique.
Riccardo Barontini : Climax est l’un des tout premiers romans dans la littérature française à aborder directement la question de la crise climatique, à la mettre au centre de l’intrigue. Il s’agit d’un phénomène qui n’est pas aisé à narrativiser – un romancier comme Amitav Ghosh l’a montré[1]– justement parce qu’il est diffus, complexe, parce qu’il a lieu à des échelles spatio-temporelles vastes. Vous choisissez de vous concentrer sur un événement désastreux qui se déroule dans un fjord norvégien et sur les aventures d’un groupe de personnages, amis d’adolescence, qui s’y retrouvent confrontés. Quelles ont été les difficultés spécifiques que vous avez rencontrées pour raconter la crise climatique avec la forme romanesque ?
Thomas B. Reverdy : En effet, ce n’est pas évident. Cela dit, les problèmes à résoudre se sont présentés à moi au fil de l’écriture, et à mesure que je plongeais dans la question climatique. Au départ, j’avais à résoudre des questions habituelles du roman : déterminer un cadre, choisir des personnages. Le cercle polaire s’est imposé comme un des endroits de la planète où, non seulement la question du changement climatique se posait avec une acuité particulière, mais aussi je retrouvais la tradition du roman d’aventure qui, de Frankenstein à Terror, avait marqué ces territoires fantasmatiques et dangereux. La Norvège me permettait de mettre la focale sur une des principales contradictions et un des principaux enjeux de ce territoire : la prospection et l’exploitation pétrolière et ses dangers y rencontrent la question du climat dans une proximité effrayante. Cela me permettait aussi d’aborder l’angle économique de la chose, qui m’est plus familier que le biologique. Enfin, le choix d’une structure de narration de type récit-catastrophe s’est imposé je crois comme le fruit d’un dialogue que j’ai eu depuis plusieurs années avec Jean-Pierre Dupuy. Il explique à propos de la notion qu’il a forgée de « catastrophisme éclairé » qu’il faudrait annoncer la catastrophe climatique à venir comme si elle avait déjà eu lieu, que c’est la condition d’être entendu, et il m’a semblé que le roman était une forme particulièrement adaptée à l’exercice. Dans un roman, tout a toujours déjà eu lieu, sinon on ne pourrait pas le raconter…
R.B. : Dans Climax, vous soulignez le fait que la crise climatique entraîne un désaxement de l’écosystème dont les conséquences vont au-delà de la somme des dégâts particuliers qu’il engendre, pour affecter l’ensemble du vivant. Vous cherchez par conséquent à raconter un système de relations multiples : « C’est le principe d’un écosystème, un peu comme dans une œuvre, une musique, un roman dont la cohérence tient de l’équilibre et de l’harmonie : une cause entraîne toujours de multiples conséquences. […]. On pourrait s’en foutre, qu’une espèce disparaisse, mais ce n’est jamais la seule conséquence. La morue polaire, c’était la nourriture principale du phoque et du béluga. Et le phoque annelé, c’est la nourriture principale de l’ours blanc. Parce que tout est lié » (C, p. 197) . Pensez-vous que la littérature soit un instrument particulièrement adapté pour nous sensibiliser à ce paradigme relationnel ?
T. B. R. : C’est quelque chose que j’ai découvert en travaillant cette notion d’écosystème, et qui m’a particulièrement frappé. Cette interdépendance de tous les éléments d’un milieu, c’est exactement ce qu’est un roman. D’une certaine manière, c’est comme si j’avais découvert qu’un roman était un écosystème. Il y a quelque chose d’organique dans l’écriture. Ce n’est pas seulement une histoire de syntaxe ou de composition. L’écriture tisse avec le réel des liens organiques. Le mot chien n’aboie peut-être pas, mais dans l’ordre du langage où nous vivons aussi, après tout, il est le chien. En créant une fiction de mots, l’écrivain crée un petit univers où tous les éléments se répondent, se complètent, se font écho ou contrepoint les uns des autres. Il crée un système de signes cohérent qui se comporte comme un écosystème, jusqu’à une relative autonomie. Les logiques du vraisemblable mais aussi du langage lui-même dans le cas par exemple des métaphores emportent le texte et son système fictionnel, vers des zones que l’écrivain n’avait peut-être pas prévu, avec lesquelles il est obligé de composer. Et bien sûr, comme dans un écosystème, une fois le roman achevé on ne peut plus retirer un élément sans que tout l’ensemble s’en trouve bouleversé.
R. B. : Votre roman se fonde sur une intrigue qui comprend de nombreuses histoires humaines, mais il me semble que le rapport qui engendre l’action fondamentale est celui qui existe entre deux éléments non humains dont vous soulignez l’agentivité, jusqu’à en faire presque des personnages : d’un côté le glacier qui se décompose, sur lequel « des crevasses larges s’ouvrent et progressent d’un bout à l’autre de la calotte visible, formant rapidement à la surface des lézardes noires qui la zèbrent en zigzag, s’élargissant comme le sourire d’un diable » (C, p. 129) ; de l’autre la plateforme d’extraction pétrolière « une grosse araignée sortie des eaux, avec ses pattes submersibles et sa toile de tubulures » (C, p. 246), prouesse technique par laquelle l’action humaine sur l’environnement est médiée. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus ?
T. B. R. : Pour moi, ces deux espaces sont d’abord deux personnages, Noah l’ingénieur pétrole et Anders le glaciologue. Ils incarnent deux rapports opposés à la nature. On pourrait dire que presque tous les personnages du roman entretiennent avec la nature un rapport singulier. Noah, c’est l’exploitation. La vision cartésienne, si vous voulez, du rapport à la nature, alors qu’Anders est un naturaliste, un rousseauiste. Ana dirige une entreprise de pèche, mais elle n’est pas dans l’exploitation brutale et irresponsable comme Noah. L’état de sa ressource – la morue polaire entre autres – l’inquiète et elle a tout intérêt à l’entretenir, parce que c’est une ressource renouvelable si on en prend soin. Quant à Knut, il incarne un rapport plus sauvage et inquiétant à la nature, avec son élevage de chiens-loups militaire. La nature est hostile, aussi. Dans le grand Nord, il fait nuit 3 ou 4 mois par ans, il fait -40°C. Ce n’est pas une nature accueillante.
S’agissant de Noah et Anders, on a vraiment un couple traditionnel d’oppositions entre la plateforme et le glacier, la technique et la science, l’exploitation et la conservation. Au-delà de ça, il me semble que ça recouvre aussi un couple fondamental dans le rapport à la vérité. Dans Histoire et vérité, Paul Ricoeur fait une métaphore. Il explique que si la vérité est une orange, il y a deux moyens de tenter de la connaître : soit on décrit toute la surface de l’orange, en la parcourant entièrement dans la paume de sa main, ressentant toutes les moindres anfractuosités de sa peau ; soit on pique au cœur de l’orange, on y plante une paille et on en goûte le jus sucré. Anders arpente le glacier pour y mesurer tous les signes du réchauffement. Noah perce la croûte terrestre pour plonger dans le réservoir de pétrole.

Thomas B. Reverdy
©️ Thomas B. Reverdy , tous droits réservés
R. B. : Le mythe a un rôle important dans Climax et vous doublez le récit principal d’un récit légendaire qui renvoie aux jeux de rôle auxquels s’adonnaient les protagonistes du roman dans leur jeunesse mais également aux mythologies scandinaves de la fin du monde. Souhaitiez-vous par là donner de la profondeur à votre ligne narrative principale, l’ancrer dans une temporalité autre ? Vous commencez d’ailleurs votre roman par une citation en exergue qui évoque la difficulté de faire naître des légendes à notre époque « privée de silence et de secret »…
T. B. R. : Les mythes sont arrivés un peu mystérieusement dans le récit. Il y a des aspects de la création qui échappent, parce qu’on essaie des choses et qu’on ne se rend pas tout de suite compte du poids que cela va prendre dans le système de la fiction. Au départ, ils étaient un écho lointain, un premier récit de fin du monde. Après tout, cette histoire de catastrophe avait déjà été écrite il y a bien longtemps. Les légendes scandinaves, réunies dans l’Edda poétique autour du Xe siècle par un évêque islandais, se terminaient par un récit de bataille (le Ragnarok) inspiré de l’Apocalypse. Mais comme j’ai redécouvert cette légende de Sigurd, que je connaissais par Wagner et la culture germanique – où il s’appelle Siegfried, dans une traduction de Tolkien, j’ai imaginé me la ré-approprier dans une version teintée de littératures de l’imaginaire, comme on dit aujourd’hui. De là dérivent les jeux de rôles qui réunissent les personnages dans leur adolescence. Évidemment, cela contribue à étoffer les personnages en leur donnant sers contrepoints imaginaires. Notamment Ana, le personnage féminin, qui n’a pas exactement réussi à être heureuse, mais qui est dans la légende la walkyrie Brynhildr, plus flamboyante. Cela dit, les échos de ce récit d’apocalypse ne servent pas qu’à étoffer l’histoire des personnages ou à créer des effets d’annonce angoissants de la catastrophe présente. Ils sont toute ma foi dans la fiction. Grâce à lui les personnages ont le souvenir inconscient d’avoir déjà vécu cette fin du monde, et de l’avoir traversée. C’est la fiction qui leur permet de s’en sortir à la fin. C’est l’amour, la beauté, l’héroïsme, c’est-à-dire tous les trucs qu’on se raconte sur nous-mêmes, notre relation au monde et aux autres. C’est une leçon profonde du roman, à mon avis.
R. B. : L’un de vos personnages, Anders, tient un journal où il décrit les espèces menacées qui peuplent l’espace arctique. Vous décrivez ainsi sa démarche : « Un bestiaire. Tout ce qui disparaissait sur la banquise se retrouvait entre ses pages. C’était, pour lui qui n’était pas un artiste, la seule façon qu’il pouvait imaginer d’écrire : il s’agissait de faire l’inventaire, de garder la trace, de consigner à la manière d’un témoin, au ras des alpages, ce qu’il savait ou qu’il avait sous les yeux et qu’il voyait disparaître » (C, p. 43). Peut-on établir un rapport entre l’écriture de votre personnage et la vôtre?
T. B. R. : Bien sûr. Anders est une figure d’écrivain. Plus exactement, c’est une figure l’écrivain aux temps des catastrophes. Une sorte de scribe, qui tient le compte de la beauté du monde, de la beauté qui reste. Quand vous écrivez, c’est comme si les choses disparaissaient. Elles ne sont plus là, devant vous, c’est une condition de l’écriture. Mais elles apparaissent sur la page, sous forme de mots. Elles se sont idéalisées. Et le lecteur ou la lectrice, par une magie inverse, va les faire réapparaître, mais sous forme d’image mentale. Anders voit le monde disparaître autour de lui. Littéralement : il le voit fondre. Et donc, très naturellement, il le couche sur les pages de ses carnets. J’ai toujours fait ça, moi aussi, depuis mon premier roman qui parlait de la mort de ma mère, sa disparition. Il me semble même que c’est le seul sujet de l’écriture. Évoquer, comme l’écrivait Mallarmé, c’est-à-dire à la fois sortir du néant et faire exister à partir de sa voix. C’est aussi quelque chose que j’ai appris en travaillant avec des historiens : à la fin, de tout cela, de tout ce que nous vivons, il ne restera que des mots.
R. B. : Afin de raconter la crise écologique que nous vivons, vous narrativisez de nombreuses connaissances scientifiques, ce qui témoigne d’un travail de documentation important : d’ailleurs, au moins deux de vos personnages (Anders et Noah) sont des scientifiques. Dans la note finale du texte, vous évoquez le rapport entre littérature et science en disant ne pas avoir « établi de hiérarchie entre les études scientifiques et les enquêtes historiques d’une part, les récits d’aventures et la fiction d’autre part », parce que « l’imaginaire fait partie de la réalité des choses » et « la fiction façonne notre monde » (C, p. 334). Pouvez-vous nous en dire plus sur le travail d’intégration des connaissances scientifiques dans le tissu fictionnel de votre roman?
T. B. R. : Le savoir fait partie de la matière romanesque, au même titre que le réel ou l’intertexte littéraire. Kundera soulignait cela dans l’Art du roman. Le roman est le genre protéiforme par excellence, qui peut se permettre de faire flèche de tout bois, d’exploiter toutes les formes, tous les contenus, et notamment le savoir qui peut être pour lui un matériau, comme aux racines du grand roman européen, au XVIe siècle, avec Rabelais ou Cervantès. Mais c’est Melville qui m’a permis de faire ça, qui m’y a autorisé en quelque sorte, puisque j’étais dans un roman et dans des paysages qui rappelaient le roman d’aventure, le Melville de Moby Dick qui mêle à la chasse du capitaine Achab des chapitres alternés au ton docte qui nous livrent en pièces détachées une véritable le encyclopédie de la baleine.
R. B. : Vous introduisez un discours politique dans votre texte, et votre narrateur dénonce par exemple le fait que la crise climatique n’est plus niée mais exploitée par un système qui court à sa perte : « Les grands méchants ne sont plus climatosceptiques. Au contraire : ils ont compris tout le profit qu’on pouvait tirer du réchauffement, et qui l’accentuera à son tour. » (C, p. 143). Les romanciers qui se penchent sur la question écologique aujourd’hui n’hésitent souvent pas à prendre parti, à réinstaller une forme d’engagement par la littérature. Votre analyse semble pourtant sombre et l’action de vos personnages frustrée par le cours des événements….
T. B. R. : Je suis un romancier. Je ne suis pas un militant qui choisirait le moyen le plus efficace de se faire entendre. Encore moins un gourou, évidemment. Cela dit, on ne peut pas se pencher sur des problèmes comme le changement climatique à l’œuvre aujourd’hui, sans ressentir une forme d’indignation. Le problème est connu, étudié, documenté, plus personne ne l’ignore, mais les climato-cyniques ont remplacé les climato-sceptiques. Dans le cercle arctique, la fonte de la banquise de mer va permettre encore plus d’exploitation d’hydrocarbures – on estime à 30% des réserves de la planètes le gaz et le pétrole de l’arctique –, encore plus de trafic maritime, par le fameux passage du Nord-Est, une sorte de Graal de la route de la soie, qui permettra d’acheminer, plus vite et pour moins cher, toujours plus de cochonneries fabriquées par des esclaves et achetées par des idiots… C’est révoltant. Non seulement nous sommes entrés dans l’Anthropocène, mais nous augmentons les dégâts. L’homme, devenu une force de la nature, fait partie des boucles de rétroactions qui la rendent inhospitalière. Et, bien sûr, le problème est économique.
[1] Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique, tr. de l’anglais, Marseille, Wildproject, 2021.
Pour citer cet article :
Riccardo Barontini, Thomas B. Reverdy, « Écrire la crise climatique. Entretien de Thomas B. Reverdy avec Riccardo Barontini autour de Climax » in Literature.green, mars 2022, URL: https://www.literature.green/ecrire-crise-climatique-entretien-reverdy, page consultée le [date].
