LA SÉLECTION 2020 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (5)
Une affaire de tissage
Entretien de Gisèle Bienne avec l’équipe Literature.green autour de La Malchimie
Gisèle Bienne est l’une des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2020. Ce prix récompensera en avril « un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes ». Les années précédentes, Emmanuelle Pagano et Serge Joncour ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui chacun à leur façon font résonner notre rapport à l’environnement. Literature.green publiera des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
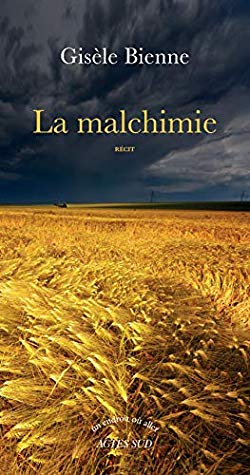
Gisèle Bienne vit et travaille à Reims, dans la Marne. Elle est écrivaine et essayiste et s’intéresse aussi fortement à la peinture. Dans son dernier récit, La Malchimie (Actes Sud, 2019), elle retrace la fin de vie d’un ouvrier agricole, mort d’un cancer consécutif à l’utilisation intensive de produits phytosanitaires. La souffrance est ici celle d’une sœur, alter-ego de l’écrivaine, que la souffrance subie par un être profondément aimé conduit à s’interroger sur la manière dont nous polluons les paysages et empoisonnons le vivant.
Pour plus de réponses relatives à La Malchimie, l’on (re)lira l’échange avec Pierre Schoentjes, publié sur literature.green lors de la parution du récit : https://www.literature.green/la-malchimie-de-la-litterature-pour-traiter-la-terre/
Est-ce que pendant l’écriture de La Malchimie vous aviez conscience de vous inscrire dans une perspective écologique au sens large et qui implique une curiosité pour le monde dont l’horizon dépasse le strict intérêt des humains ? Était-ce un choix délibéré dès le départ d’écrire un roman « écologique » ?
Gisèle Bienne : La malchimie s’écrivait, se cherchait en moi à chaque instant et en divers lieux, le jour, la nuit, et cela sans que je l’aie « prémédité », ça se passait à ma table de travail, mais aussi dans la chambre stérile où l’on soignait Sylvain. J’y observais, découvrais l’usage et les effets sur le patient d’une autre chimie où intervenait la firme Bayer, celle qui fabrique des pesticides et fabrique également le matériel médical pour les personnes que ces mêmes pesticides ont rendu malades, ça s’écrivait dans le tramway que je prenais pour me rendre à l’hôpital, pendant mes nuits de rêverie ou de réflexion quand il me fallut approfondir mes connaissances concernant l’histoire des firmes concoctant ces substances toxiques.
Car Sylvain, le petit frère ouvrier agricole atteint d’une leucémie aiguë provoquée à long terme par l’emploi de ces produits qu’il manipulait dans son métier, était comme un livre-témoin. En lui étaient inscrites les étapes d’une histoire s’étalant sur une cinquantaine d’années, celle de l’évolution de l’agriculture qui débuta avec les Trente Glorieuses.
J’avais publié aux éditions Seuil en 1983 un livre intitulé Bleu, je veux qui a rencontré de nombreux lecteurs : nous y sommes en présence, au cours d’une seule journée, de deux enfants qui gardent les bêtes dans un grand pré rond, le pré au saule. Le garçon, « Silex-des- terres », qui allait devenir « Sylvain » dans La malchimie publié en 2019, et sa sœur aînée, « Corail-des Mers », qui allait devenir « Gabrielle » dans ce même livre, connaissent ici un « univers » en soi, le peuple des petits animaux, qui ont la nature pour refuge, y grouille de vie à tout moment, les bonnes et mauvaises herbes y poussent avec vigueur. On croit rêver, non ? Dans le pré, on s’assied, s’allonge, se roule dans l’herbe, on y joue en toute innocence, et tout cela nous a été retiré.
Le pendant de Bleu je veux serait donc aujourd’hui La malchimie qui nous permet de revivre ces années-là et qui, parallèlement, nous révèle les transformations qui ont eu lieu depuis. Ces deux livres me semblent se répondre sans que j’aie voulu « montrer », « démontrer », j’ai surtout constaté que nos aires de travail, d’habitat et de jeu se sont considérablement appauvries quand elles n’ont pas totalement disparu. Ce qui a proliféré par contre, ce sont les maladies que cette réduction drastique de la diversité a engendrées chez les bêtes, les hommes, dans la nature ; un terrible et dangereux recul du vivant. Au cours des visites que la narratrice rend à son frère hospitalisé, de beaux moments ressurgissent et viennent s’imprimer en relief sur la toile des souvenirs heureux même quand le travail avait été astreignant, Gabrielle et Sylvain mêlent leurs impressions, partagent leurs savoirs.
Être proche d’un être cher victime d’une de ces maladies, proche du frère auprès de qui nous avons grandi dans la richesse des partages et l’effort du travail, nous conduit à une prise de conscience abyssale des menaces effectives qui pèsent sur l’environnement et nous convie à une écriture qui se situe nécessairement, pour une large part, dans une perspective écologique. N’ai-je pas, grâce à la ferme de mon père, connu, enfant, adolescente, une forme d’écologie qui s’ignorait ?
Il y aurait d’ailleurs, et je compte m’y employer un jour prochain, à travailler sur les notions de « sale » et de « propre ». Le « sale » d’autrefois avec toutes ces bêtes, minuscules, petites ou grosses, leur présence à nos côtés, leurs déjections, les fientes, les bouses, le crottin, les crottes, etc., – qui faisait notre joie d’enfants curieux et joueurs – et le « propre » actuel, une herbe, des blés, des champs, des vergers, uniformément lisses, vides de toutes plantes dites adventices et de presque toute présence animale, arrosés de produits nocifs – qui cause notre tristesse et contribue à servir une économie mondiale scabreuse. (Il serait justifié d’inverser à présent les termes de « sale » et de « propre ».)
Ce n’est pas sans raisons que ma mère appelait de temps en temps, pour la taquiner et la corriger, la petite fille que j’étais et qui aimait à se salir, c’est-à-dire à vivre de façon espiègle, Marie-Salope, (le titre de mon premier livre). L’enfance de Sylvain comme la mienne, je le reprécise, s’est déroulée avant que les pesticides n’apparaissent sur le marché. Il y a eu plus tard basculement d’un monde dans l’autre. En débattre avec le public est une expérience intéressante.
J’ai donc, accompagnant Sylvain tout au long de sa maladie, pu mesurer l’ampleur des dégâts que cause l’agrochimie sur terre et dans les airs. Il existe diverses sortes de pollutions, celle-ci est d’une envergure incommensurable.
J’en avais, avant d’écrire La Malchimie, une certaine conscience, et depuis longtemps. Je me souviens dans les années soixante-dix avoir voté (mon premier vote) pour René Dumont, avoir lu des revues comme « La gueule ouverte » par exemple. Mais nous ignorions alors la dangerosité réelle des produits phytosanitaires qu’employaient déjà les agriculteurs, les maraîchers, les jardiniers, que manipulaient les dockers et tant de personnes en divers pays de la planète. Notre vision des choses était plus parcellaire. Ce que nous mettions sous le mot « traitement » en agriculture restait vague. Nous nous en prenions surtout à l’emploi massif des engrais chimiques – la question de la présence des nitrates dans le sol et les eaux était à cette époque pertinemment posée. Nous manifestions contre la construction des centrales nucléaires, contre les essais nucléaires qui se faisaient dans le secret.
L’écologie apparaît aujourd’hui comme un nouvel universalisme : pour la nouvelle génération c’est un idéal –ou une utopie– qui permet une mobilisation importante. Estimez-vous que l’engagement, tenu en suspicion depuis la faillite des grandes idéologies du XXe siècle, pourrait grâce à l’écologie retrouver aujourd’hui une certaine légitimité ? Dans quelle mesure et par quels moyens ?
G. B.: Il est certain que le besoin de changement va croissant et que les revendications se multiplient. Nous voyons se dessiner des lignes de force, se créer, se développer et agir des associations responsables avec, souvent, le soutien des populations, s’ouvrir des sites d’information sur internet, des collections spécialisées chez des éditeurs. Nous voyons des citoyens, des maires de différentes communes prendre des mesures pour protéger les habitants là où l’Etat se montre déficient ou hostile. Nous voyons des jeunes se regrouper en nombre, manifester pour le climat, l’avenir de la planète et tenir ferme leur programme. Que des femmes, des hommes, journalistes, essayistes, chercheurs, conférenciers, romanciers, cinéastes prennent la parole, la caméra ou la plume, s’exposent ou se soient exposés dans leurs travaux, éclairent des zones d’ombre, tout cela aide à une prise de conscience qui ne cesse de s’étendre et qui pourrait peser fortement sur les Etats récalcitrants. Nous voyons des agriculteurs et des éleveurs s’organiser et se regrouper, après s’être convertis à la culture biologique, pour écouler leur blé, leur farine, leurs huiles, leur lait, leurs yaourts etc., autrement que par le biais des grosses coopératives, des collectifs comme « Graines de rebelles » sauver leurs propres semences. Les lobbyistes cependant, nous ne le savons que trop, sont puissants et développent en contrepartie une redoutable défense de leurs intérêts.
Cela n’ira pas ne va pas sans heurts. Faire bouger les « mentalités » et les habitudes de travail est ardu. La crainte d’aller à la faillite taraude les travailleurs du monde agricole. Par ailleurs, tout militantisme « pur et dur » me gêne. Je ne voudrais pas voir des fermes disparaître, il en reste déjà si peu… J’ai des agriculteurs pour amis, je ne suis pas « coupée » d’eux. Dans mon immeuble du centre de Reims, il s’en trouvent deux qui font chaque jour la route pour aller travailler à la ferme tandis que leur femme et leurs enfants sont très attachés à la ville. Les jeunes agriculteurs se sentent parfois isolés au sein de leur exploitation agricole. Parmi eux des célibataires, des divorcés, les jeunes femmes sont nombreuses à ne plus avoir envie de vivre à la campagne.
La fiction peut-elle jouer un rôle dans le contexte actuel de crise environnementale ? Pourriez-vous préciser lequel ? Le roman, dont le terrain d’action est l’imaginaire, dispose-t-il d’atouts spécifiques pour faire résonner les enjeux écologiques ?
G. B.: Le roman, oui, je crois.
Qui m’a le mieux parlé de la vie, la survie, quand ils survivent, des zeks dans les goulags soviétiques si ce n’est Soljenitsyne, et Evgénia Gainsbourg, et Chalamov avec ses Récits de la Kolyma qui sont des merveilles d’écriture. Je ne reviendrai pas sur de grands classiques comme Les raisins de la colère de John Steinbeck, ou encore, concernant notre sujet, Printemps silencieux de l’américaine Rachel Carson, (mais c’est un essai…) En France, sauf erreur de ma part, les textes traitant de l’écologie ne couraient pas les librairies. Ce n’est plus le cas. Le risque serait que des romans en viennent à « illustrer » une « thématique ».
Le roman, on me l’a dit au sujet de La malchimie, opère différemment d’un essai, il y a cette impression de profondeur qu’éprouve le lecteur : nous creusons autour d’un ou plusieurs personnages des problématiques qui prennent forme concrètement, s’ancrent dans des parcours de vie qui participent de la nôtre, nous travaillons à des mises en situation. A partir d’un cas particulier, quelque chose de plus universel est visé, atteint peut-être.
En tant qu’écrivaine, vous faites d’abord une œuvre de littérature : existe-t-il une difficulté à tenir en équilibre les exigences du style et un positionnement envers l’environnement ? Dans quelle mesure est-ce que la « matière de l’écologie », toujours au sens large, vous a incité à repenser la forme traditionnelle du roman ?
G. B.: Un tissage. Un métissage. Un brassage d’éléments, et de classes sociales, lesquelles sont trop séparées dans la vie quotidienne.
Oui, c’est une affaire de tissage, pour moi en tous cas.
Funambules, acrobates, nous nous faisons ? Il faut alors tenir l’équilibre…
J’ai tenté de tisser des liens, des rapports, des échanges entre hier et aujourd’hui, entre des lieux, des paysages, des textes, des études, des témoignages, des films, entre les animaux et les humains, entre l’histoire de Sylvain et celle de certains de ses collègues, la mienne aussi. J’ai invité dans le livre des auteurs, comme David Rieff, le fils de Susan Sontag atteinte d’une leucémie, comme Tchékhov, écrivain, et médecin soulageant la souffrance des démunis, comme Elisabeth de Fontenay qui s’est penchée sur le sort des animaux. J’ai mené des enquêtes de nature historique, sociale, littéraire sans perdre de vue les relations frère/sœur qui nourrissent le corps de l’histoire.
Y a-t-il, en matière de vision sur la nature, des auteurs ou des livres qui vous ont spécialement marqués ? Quel rôle ont-ils tenu dans votre parcours et dans votre écriture ?
G. B.: Il y a le grand Faulkner, il y a Rilke, il y a Katherine Mansfield (le Journal), il y a Mario Rigoni Stern qui, dans leur rapport à la nature, à ses forces obscures – pour ne citer qu’eux – m’offrent encore et toujours des lectures vraiment inépuisables.
Et c’est bizarre, je pense tout à coup à un livre paru voici quelques décennies et qui m’avait impressionnée, c’est Génie la folle, d’Inès Cagnati, l’histoire d’une femme de bonne famille qui, rejetée, se place comme domestique agricole. Sa faute est d’avoir mis au monde une petite bâtarde qui subit le mutisme de sa mère et que nous voyons grandir à ses côtés. Il faudrait que je le relise, je le relirai.
Pour plus de réponses relatives à La Malchimie, l’on (re)lira l’échange avec Pierre Schoentjes, publié sur literature.green lors de la parution du récit : https://www.literature.green/la-malchimie-de-la-litterature-pour-traiter-la-terre/
Pour citer cet article:
Literature.green, Gisèle Bienne, « Une affaire de tissage. La sélection 2020 du Prix du Roman d’Écologie: entretien de Gisèle Bienne avec l’équipe Literature.green autour de La Malchimie » in Literature.green, février 2020, URL: https://www.literature.green/une-affaire-de-tissage-entretien-avec-gisele-bienne/ , page consultée le [date].
