Jardins et relations de proximité
Entretien de Roland Buti avec Claire Jaquier, autour de Grand National et du Milieu de l’horizon
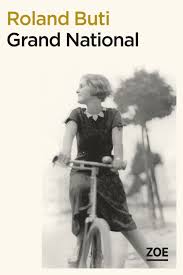

Depuis 1990, Roland Buti a publié deux recueils de nouvelles et quatre romans, tous chez Zoé à Chêne-Bourg Genève. Troubles de la filiation et désordres familiaux, crises existentielles et séismes dus aux relations de pouvoir, ses récits parlent avec une pudeur souvent pleine d’affection des cahots auxquels la vie soumet les êtres. Les deux derniers romans de Roland Buti, Le Milieu de l’horizon (2013) et Grand National (2019), font entrer dans la fiction, avec puissance, les éléments naturels, la terre et les aléas du climat, les animaux et les plantes.
Très remarqué, traduit en sept langues et couronné en Suisse par de nombreux prix, Le Milieu de l’horizon situe dans l’été de la grande sécheresse de 1976 un drame à la fois social et intime, qui conjugue deuil de l’enfance et bouleversements dus à la fin de l’économie paysanne. Grand National met en scène un homme de 45 ans, confronté simultanément à plusieurs séparations auxquelles il fait face grâce au compagnonnage de son ouvrier, Agon. Cet immigré kosovar doit une part de sa force et de son équilibre à la culture d’un jardin familial.
.
Claire Jaquier : Votre dernier roman, Grand National, développe un modèle d’intrigue auquel vous avez déjà eu recours en mettant en scène un personnage principal confronté à une sorte de mue existentielle ou de grande désorientation. Dans votre premier roman Un nuage sur l’œil (2004), Adrien est un jeune homme perturbé par le suicide de son père et par les secrets et mensonges qui pèsent sur ses origines. Dans Le Milieu de l’horizon, le narrateur, Gus, âgé de 13 ans, sort de l’enfance au moment où sa famille vit un profond bouleversement social et économique. C’est un homme troublé de 45 ans, Carlo Weiss, jardinier paysagiste de son état, que vous campez dans Grand National : sa fille a quitté le domicile familial, sa femme vient de le quitter, il se blesse au travail et le passé de sa mère en fin de vie se révèle soudain à lui. Ce roman tient du récit de filiation comme Un nuage sur l’œil, et il ne côtoie pas la tragédie comme Le Milieu de l’horizon. Tout au contraire, s’il fallait l’assigner à un genre, on pourrait le définir comme un roman de la consolatio ou, pour le dire en termes plus contemporains, un roman du care. C’est le vert qui console dans Grand National – jardins familiaux ou paradis privés, la nature végétale apaise, sécurise et prend soin des humains, elle est omniprésente et déclinée sous ses formes multiples, de l’arbre majestueux aux boulettes de hachich à la gelée de coing. Est-ce un roman vert en hommage au règne végétal et à la terre que vous avez voulu écrire, ou vous êtes-vous simplement amusé à filigraner de vert l’histoire du jardinier Carlo ?
Roland Buti : J’ai le souci d’écrire des livres qui parlent d’un lieu et d’une époque. J’ai toujours été fasciné par les jardins. Dans Grand National, il y a les grands parcs dans lesquels travaille le narrateur, mais aussi les jardins familiaux. On les aperçoit depuis l’autoroute à Lausanne, avec leurs multitudes de drapeaux de toutes nationalités (le livre est construit autour de la problématique de l’étranger, intime ou lointain). Ce qui m’a intéressé dans le roman, c’est cette idée du jardin comme refuge (et il y a aussi le jardin secret de la mère, tout ce qu’on ne dit pas, qu’on ne connaît pas des personnes). Il y a dans ces jardins familiaux une maisonnette, un maximum de choses dans un espace réduit. Cela me fait penser à une part d’enfance, à la cabane dans les arbres en forêt que les enfants construisent et où ils s’inventent une vie.
Je suis frappé par la mode actuelle des jardins. Toutes les périodes historiques où les choses vont mal développent ce fantasme de jardins (qui sont forcément des lieux clos, « cloîtrés »). Dans cet espace règne le contrôle, et en l’occurrence le contrôle sur la nature. Il n’est peut-être pas étonnant qu’à un moment où on a l’impression que celle-ci nous échappe, et très concrètement avec la disparition des milieux naturels et des espèces, il y ait ce mouvement de repli sur ces espaces fermés préservés. On peut y retrouver une relation intime avec le végétal, la terre (Agon qui mange des feuilles) et le rapport qui se noue est alors symbiotique. J’avais lu cette idée que le jardinier entretient un biotope qui, créé par lui, puis objet de soins constants, devient un psychotope : une image de soi dans la nature. C’est peut-être ce que l’homme occidental a perdu depuis Galilée avec une vision du monde scientifique qui fait de la nature un objet utile, pour ne pas dire utilitaire. Ce n’était naturellement pas la même chose dans la conception médiévale de l’unicité de la Création. Les quatre éléments de la nature, les quatre points cardinaux, les quatre humeurs, etc. Je trouve cela très fascinant et très littéraire.
Le végétal se retrouve partout en effet dans Grand National, et même dans l’Art nouveau floral du palace. J’aime construire des livres comme de la musique, avec des motifs, des rappels pour donner l’impression que tout se tient. Ce lien entre l’unité du monde et la musique est d’ailleurs un des mythes européens les plus anciens avec le dieu Pan. Dans Le Milieu de l’horizon, les animaux sont presque des personnes (comme dans les bandes dessinées…). Il y aurait encore une autre manière de voir les choses : aujourd’hui, il n’y a plus de nature naturelle ; tous les milieux, tous les paysages ont été transformés par l’homme, et même les pôles capturent dans la profondeur de leurs glaces des résidus de l’activité humaine. Microsome et macrocosme sont liés pour le meilleur et pour le pire…
C.J. : Le jardin familial que l’employé de Carlo, Agon, loue pour y cultiver des légumes, pour lire et s’y reposer, est un véritable lieu anthropologique dans votre roman. Vos lecteurs lausannois reconnaîtront avec émotion les jardins des Prés-de-Vidy, dont les cabanons ont été déménagés en 2010 sur une parcelle voisine, par hélicoptère, pour faire la place à un futur stade de football. Tous les autres lecteurs partageront avec intérêt et sympathie la réflexion subtile qu’Agon et le narrateur Carlo nourrissent tout au long du roman sur ces jardins – « Xanadu où rien ne se vend et rien ne s’achète ». Comme le fait Jean-Christophe Bailly dans un chapitre consacré aux jardins ouvriers de Saint-Etienne, intitulé « Légers jardins, à peine » dans son livre Le Dépaysement. Voyages en France (Seuil, 2011), vous donnez, entre les lignes de la fiction, une « leçon politique du jardin » pour notre temps. Vous le faites par l’intermédiaire d’Agon, né dans un pays communiste et pour qui les jardins sont des « bulles » qui permettent le « bon fonctionnement du capitalisme ». Partagez-vous le point de vue de votre personnage ?
R.B. : Je ne souhaite bien sûr pas être un donneur de leçons, mais je pense que ce retour au local, à des relations de proximité est l’avenir. On ne peut pas vivre dans un monde où il n’y a pas de cafés de quartier, de marchés où les gens se rencontrent. J’ai récemment vu le film Joker qui raconte cela. Une ville sans nature, sans lieux de sociabilité (j’avais été frappé à New York du nombre de rues qu’il fallait traverser pour espérer tomber sur un café un peu sympa par rapport à ce qui existe dans n’importe quelle ville européenne). Ils disparaissent et les gens deviennent fous dans leur coin, seuls et sans empathie. Dans ces jardins familiaux ou ouvriers, dans ces bulles, ce qui s’exprime c’est la liberté. Mon idée — transmise par les remarques d’Agon — est que les systèmes totalitaires ne le sont pas parce qu’ils reposent sur ces minuscules espaces consentis. Les isbas et datchas, la cabane au bord du Wannsee, la « culture des cuisines » dans l’URSS des appartements collectifs, etc. C’était aussi dans les régimes fascistes les vacances payées ou les camps pour la jeunesse dans la nature (les pionniers dans le monde communiste). Le système libéral capitaliste ne s’est pas construit autrement que sur l’idée d’une confédération de petits propriétaires libres. Aujourd’hui ces bulles individualistes sont si nombreuses, et même virtuelles, qu’il n’y a plus besoin d’autorité pour faire admettre la loi du plus fort et faire du commerce.
Je pense, j’espère qu’une société va se reconstruire par le bas en créant de nouvelles formes de sociabilité. Il y a les coopératives, les associations diverses et variées, les jardins collectifs au cœur des villes, etc… L’homme, mammifère social, n’a pu créer la civilisation que dans le cadre de petits groupes dans lequel régnait la bienveillance (le souci de prendre en compte le plus faible). C’est ce que dit Agon quand il parle des grands-mères…

Roland Buti
C.J. : Dans Du côté de chez Swann, Proust, botaniste amateur hors pair, fait fleurir en même temps dans le parc de Swann, au mépris du plus élémentaire savoir naturaliste, lilas et aubépines, glaïeuls et pervenches, coquelicots, bleuets et myosotis. C’est qu’il aime autant les noms de fleurs et les tableaux imaginaires qu’elles composent que les realia de la nature avec leurs rythmes propres. Comme lui, vous faites mûrir les premières fraises en même temps que les tomates, concombres et choux romanesco ! Agon est pourtant un jardinier avisé, et Carlo un paysagiste averti. Essences d’arbres de tous pays, légumes albanais ou italiens, oiseaux indigènes ou africains, votre roman est une arche accueillante, un « jardin planétaire » (Gilles Clément) : est-ce une sorte d’internationale de la nature, passant par-dessus les frontières, les latitudes et les saisons, que vous avez voulu chanter ?
R.B. : Vous aurez en effet remarqué que parmi l’immense variété de choux, j’ai choisi le plus romanesque, parce qu’en réalité ce sont des légumes et des fleurs de papier. J’ai été séduit par cette idée d’une acclimatation de légumes de tous les pays dans un petit espace et par celle de l’harmonie intérieure d’une « république potagère » qui fonctionne parce que les règles sont peu nombreuses, mais claires. Mais il faut aussi dire qu’il y a le problème aujourd’hui des espèces invasives qui font disparaître les plus faibles. Cela fait des années que je n’ai pas vu une coccinelle de mon enfance dans mon jardin. Il y a maintenant les coccinelles asiatiques, très envahissantes quand elles veulent entrer dans les maisons et que je massacre sans pitié… Les jardins peuvent, et doivent aussi être des conservatoires des espèces face à l’uniformisation liée aux intérêts du marché. C’est sûrement une explication de leur charme et de la fascination qu’ils exercent aujourd’hui sur beaucoup : la variété (le renouveau des légumes anciens) et l’originalité d’une nature qui n’est pas formatée.
Ceci dit, il y a des fraises tardives dont les premières sortent en août en même temps que les concombres ou les tomates (précoces, parce que le jardin d’Agon est à 300 mètres d’altitude au bord du lac).
C.J. : Avant la guerre civile qui l’a fait fuir du Kosovo, Agon était professeur de français dans un lycée. Il conserve dans son cabanon de jardin quelques classiques – Balzac, Ramuz, Hugo, Dumas – et Carlo, qui parfois s’y réfugie, lit Les Fleurs du mal, transformé en herbier : « C’était un livre en voie de végétalisation ». Agon relit Les Misérables de Hugo, et y trouve une sorte de « consolation » : son exemplaire dégage « une odeur de mousse et de champignon ». Au sens le plus concret et matériel du terme, par cette rencontre des pages et des feuilles, votre roman ne réinterprète-t-il pas le « livre de la nature » qu’affectionnaient les romantiques ? À quel imaginaire ces livres végétaux renvoient-ils, pour vous ?
R.B. : Lire est une consolation et un refuge. Le jardin familial d’Agon est une consolation et un refuge. Son jardin est compliqué, fait de planches, de tuteurs dressés, de carrés potagers qui sont comme les lignes, les caractères et la ponctuation d’un texte. Il circule dans son jardin comme dans un livre.
C.J. : Contrairement à Grand National, Le Milieu de l’horizon ne sent pas l’humus ni les « exhalaisons des sous-bois » : ce roman de la grande sécheresse de 1976, ce roman brûlant fait écho à plusieurs événements qui marquent l’entrée dans la littérature de Suisse romande de la préoccupation écologique. Le poète Gustave Roud meurt en 1976, lui qui a dit avec nostalgie, dans son dernier recueil, Campagne perdue (1972), la fin d’une civilisation paysanne fondée sur la pérennité du cycle des saisons. La même année, Maurice Chappaz publie Les Maquereaux des cimes blanches : il invite les prêtres valaisans à s’engager « en écologie », plutôt que de se compromettre dans le grand consensus marchand. Votre roman représente la sécheresse de 1976 comme une catastrophe totale, climatique autant qu’économique, sociale et morale. La mère de Gus abandonne la ferme familiale ; la poussinière – seul revenu substantiel de la famille – est détruite ; la mort atteint les gens, les bêtes et les plantes. S’imposant brutalement, le désastre climatique est perçu par le père comme l’irruption d’une « nature supérieure » qui, « souvent incompréhensible, en impose toujours aux hommes » : il prend à ses yeux les allures mythiques d’une punition collective. Vous avez inscrit cet événement climatique de 1976 dans une intrigue centrée par ailleurs sur la fin de l’enfance de Gus, le narrateur. Estimez-vous que la littérature, et le roman en particulier, ont des formes et des modèles nouveaux à inventer pour faire écho, à leur manière, à la préoccupation écologique ?
R.B. : Une tradition bien ancrée me semble être celle du roman d’anticipation ou de science-fiction. Les intrigues sont le plus souvent construites sur cette idée que la science issue de l’intelligence conduit à des catastrophes. Et c’est donc l’occasion d’une mise en garde sur les effets pervers du progrès. La préoccupation écologique va sans aucun doute irriguer la littérature du XXIe siècle. Le ressort de l’écroulement d’un monde (social, politique, et pourquoi pas naturel) me semble en effet sous-jacent dans beaucoup de grandes œuvres.
C.J. : Dans un compte rendu daté du 8 mai 2013, Laurence Houot, sur le site de Culture France Télévisions, saluait Le Milieu de l’horizon en ces termes : « Un roman puissant, qui rend hommage à la terre et à ses hommes, à la manière de Giono, version suisse. » Vous comparer à Giono revient à vous assigner au genre du roman de la terre. Vous reconnaissez-vous dans cette lecture ? On peut en douter lorsqu’on lit, dans un entretien de 2015 avec Pierre Fankhauser (https://kroniques.com/2015/03/23/rencontre-roland-buti/ ), que vous avez voulu éviter « l’écueil » du roman paysan, « ancré dans le terroir ». Comme tous les écrivains nés après la Deuxième Guerre, vous savez que le roman régionaliste, paysan ou rustique vaut « péché mortel », comme le dit par exemple Marie-Hélène Lafon. Fortement discrédité, le genre est assigné en effet à un canton éditorial bien particulier, fréquenté par un public – d’ailleurs nombreux – avide de stéréotypes ruraux et de nostalgie du bon vieux temps. Vous avez cependant placé dans Le Milieu de l’horizon une scène typique du roman paysan : la mise aux enchères du bétail et du chédail de la ferme, moment pathétique de la liquidation des domaines agricoles. Cette scène est-elle un passage obligé ? Ou un symbole de la fin de la civilisation paysanne ? Jean-Pierre Rochat, par exemple, lui accorde une large place dans son roman Petite brume (Éd. d’autre part, 2017).
R.B. : Cette scène était placée au début de mon texte jusqu’aux dernières relectures. L’histoire du roman devait alors être un retour en arrière pour expliquer cette fin. C’est une des premières images qui m’est venue à l’esprit au moment de commencer l’écriture du Milieu. Elle est donc centrale. La liquidation des biens de la famille fait écho à son éclatement durant l’été 76, même si en réalité la vente des biens de la ferme a lieu près de vingt ans plus tard. Je ne sais pas très bien ce que veut dire « paysannerie traditionnelle ». Je crois que le monde paysan est en constante transformation et s’adapte aux conditions politiques et économiques. La période de la Seconde Guerre mondiale (cela est suggéré dans le livre indirectement avec le remaniement parcellaire) est par exemple une révolution pour la paysannerie suisse, au même titre que les trente glorieuses et la modernisation des années 50. Le livre se situe à un moment où le productivisme associé à la baisse des coûts de production conduit à des formes industrielles aussi dans l’agriculture suisse. L’idée d’une « paysannerie traditionnelle » est peut-être un fantasme d’urbain : on voit les fermes de loin depuis le train et il nous semble qu’elles sont immuables depuis le Moyen Âge… ce qui change au milieu des années septante, ce sont les mœurs, les rapports familiaux, etc., en ville comme dans le monde rural.
J’ai en effet tout fait pour ne pas faire « un roman paysan » et donc la référence à Giono me va très bien (c’est très flatteur). Il y a chez Giono une vraie tendresse pour tous les personnages et dans Un roi sans divertissement un très beau cheval qui est une vraie personne. Je crois que chez Giono, comme chez Ramuz, il y a surtout la présence de la nature comme force au-dessus des hommes qui les influence dans leurs moindres gestes. Tout y est minéral, tout y est végétal, tout y est sensation du vent et du soleil, avant d’être à proprement humain. Giono est un des grands auteurs de la nature (qui se dérègle avec le choléra) avant d’être celui de la terre ou de la paysannerie.
C.J. : Depuis une trentaine d’années, l’écopoétique et l’écocritique s’attachent à identifier, dans la littérature contemporaine ou dans des œuvres bien antérieures à la prise de conscience des risques environnementaux, les traits d’une représentation de la vie et du monde moins conforme au modèle anthropo- et égocentré que l’Occident chrétien et humaniste a imposé depuis des siècles à notre culture. Vous écrivez des romans où l’humain, avec ses crises et ses incertitudes, occupe le centre de la fiction, même si la terre, les événements météorologiques, les animaux et la nature végétale nourrissent richement les univers romanesques que vous créez. Vous arrive-t-il d’imaginer un art du roman plus géo- ou écocentré ? Cela vous paraît-il souhaitable, ou la nature même du langage, propre à l’homme, vous paraît-elle compromettre ce genre d’ambition ?
R.B. : Il est très difficile d’imaginer un roman où il n’y aurait que la nature sans aucun personnage humain. Ce serait un défi intéressant à relever. Ou peut-être un roman de ce type existe-t-il déjà ? Si on regarde les romans de ces cinq dernières années, il y en a, il me semble, beaucoup qui parlent des préoccupations environnementales ou de notre rapport aux animaux. Nous faisons partie de la nature, mais depuis homo sapiens nous la mettons à distance et elle devient un objet que nous pensons. Je crois fondamentalement que si elle peut exister pour soi, l’homme ne peut que la considérer comme humaine. D’une autre manière, cela va très loin aujourd’hui. Une vache, un cochon, une poule, un chien, etc… sont des créations humaines. Ce ne sont pas des animaux « naturels », au même titre que la plupart des plantes que nous consommons. Et la nature dite sauvage est cantonnée à des espaces déterminés par les humains (et de toute manière aussi contaminée par les effets multiples de l’activité humaine, de la chasse pour la gestion de la faune au réchauffement climatique qui perturbe le ratio des sexes chez les reptiles…).
C.J. : Si vos deux derniers romans montrent à l’évidence votre sensibilité au sort actuel et futur de la nature et de l’habitat humain sur terre, vous touchez à ces questions en écrivain, en créateur de mondes imaginaires, et jamais en prophète d’apocalypse. Léger, parfois à peine perceptible, un humour fluide parcourt vos livres, comme un ballon d’air qui nous met à distance des drames, non pas cyniquement, mais avec un sourire tendre ou amusé. L’épigraphe du Milieu de l’horizon est à ce titre un chef d’œuvre, qu’il faut relire après avoir terminé le livre. Vous y citez un représentant de la Division fédérale de l’agriculture, qui énonça le 26 juin 1976 cette phrase impérissable : « Nous estimons que […] chaque jour de beau temps qui s’écoule est un pas vers la catastrophe. » Pouvez-vous nous parler de votre rapport à l’humour, et de la manière dont vous le faites advenir dans vos romans ?
R.B. : L’humour est une mise à distance des choses. La littérature est une mise à distance des choses. Je trouve que cela se marie très bien. Et il y a différentes formes d’humour. Un de mes auteurs fétiches, Dickens, les manie toutes à la perfection. Il est toujours « drôle » grâce à un léger décalage — qui passe aussi par une connivence avec le lecteur (un genre de pacte) —, qui lui permet de rendre le tragique et le pathétique encore plus forts dans la narration ou de faire admettre des personnages (je pense à la petite Dorrit) improbables dans leur perfection. Je pense aussi que c’est souvent une manière de poser un regard tendre sur les choses.
Entretien réalisé dans le cadre du projet La littérature environnementale en Suisse: écrire l’écologie, réalisé avec le soutien de la Mission Suisse auprès de l’Union Européenne. Une journée d’étude sur ce sujet aura lieu à l’Université de Gand le 24 février 2020.
Pour citer cet article :
Roland Buti, Claire Jaquier, «Jardins et relations de proximité. Entretien de Roland Buti avec Claire Jaquier, autour de Grand National et du Milieu de l’horizon » in Literature.green, novembre 2019, URL: https://www.literature.green/jardins-et-relations-de-proximite-entretien-de-roland-buti-avec-claire-jaquier, page vue le [date].
