La littérature au service de l’animalisme, l’animalisme au service de la littérature
Échange entre Camille Brunel et Hannah Cornelus autour de La Guérilla des animaux
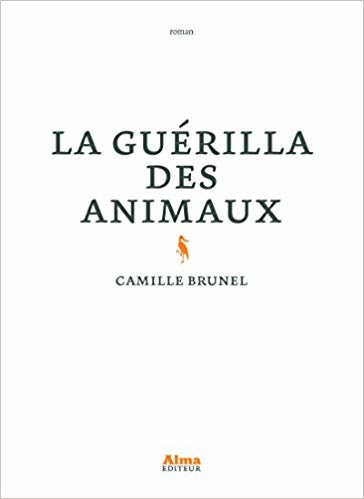
Camille Brunel (°1986) est écrivain, journaliste, critique de cinéma, militant de la cause animale et du véganisme. En 2011, il a publié l’essai Vie imaginaire de Lautréamont chez Gallimard. Il est également l’auteur de l’enquête critique Les Animaux du cinéma publiée en 2018 par les Éditions UV. La Guérilla des animaux (Alma Éditeur, 2018) est son premier roman.
Situé dans un futur proche, ce roman raconte l’histoire d’Isaac Obermann, un jeune Français qui décide de prendre les armes pour venger les animaux. Seul ou accompagné de Yumiko, « son alter-ego féminin », il parcourt le monde pour faire justice en traquant des braconniers, des chasseurs et des pêcheurs.
Hannah Cornelus : Au cours des dernières années, la cause animale a gagné en visibilité. Les militants animalistes diffusent des images d’horreur filmées dans des élevages industriels ou dans des abattoirs, les photos des ours polaires efflanqués sont désormais aussi connues que celles des oiseaux de mer englués dans le pétrole. En outre, de nombreux essais et plaidoyers pour le végétarisme ou le véganisme ont paru et la question de l’alimentation carnée suscite des débats enflammés.
Comme vous l’avez signalé à plusieurs reprises dans des interviews, la cause animale vous tient personnellement à cœur et vous avez décidé de lui consacrer votre premier roman. Considérez-vous que ce texte constitue une forme de militantisme ?
Camille Brunel : Oui, bien sûr. J’écrivais déjà de la fiction avant – mon premier livre, Vie imaginaire de Lautréamont, est vraiment à la frontière de l’essai et du récit – et j’aurais écrit des romans de toute façon, mais je n’aime pas l’idée d’une littérature qui se contente de divertir, probablement parce que c’est une posture que je trouve un peu hypocrite dans la mesure où on n’échappe jamais à sa petite propagande, même si on n’écrit que des haïkus. Alors autant l’assumer. J’aime encore moins les artistes qui revendiquent le fait de « ne pas se prononcer », de « ne pas juger » ou que sais-je encore, pour mettre en valeur une pseudo-neutralité qui a évidemment tout d’un mensonge. Revendiquer la neutralité, c’est refuser d’aider, c’est considérer que les problèmes ne nous concernent pas suffisamment pour qu’on se bouge. Cela me semble litigieux dans énormément de domaines, y compris celui qui nous intéresse.
Quand je suis devenu militant, j’ai décidé de le faire au maximum de mes possibilités plutôt qu’à moitié ; ne serait-ce que pour minimiser le risque d’avoir perdu mon temps. J’avais déjà commencé à écrire l’histoire d’un chasseur de braconniers, vieux fantasme écolo. Il s’agissait dès le début de passer ma colère en l’exprimant de la manière la plus spectaculaire et séduisante possible. Par la suite, le sentiment d’urgence s’étant accru (à juste titre, à mon humble avis), du fait de la transformation de ma conscience strictement écologiste en conscience animaliste, le texte est devenu une façon de mettre la littérature au service de ce sentiment d’urgence. Mais c’est probablement symbiotique : l’engagement est aussi au service de la littérature. La panique a toujours été très productive.
H.C. : On peut citer des cas d’écrivains qui ont résolument choisi une forme non littéraire pour traiter de la question animale, parce qu’ils la jugeaient plus convenable (pensons par exemple à Jonathan Safran Foer et à son Eating animals). Pourquoi avez-vous opté pour une œuvre de fiction et non pas pour un essai ou un pamphlet ? Estimez-vous que les images narratives sont plus aptes à sensibiliser le public qu’un texte argumentatif ? Pensez-vous, par le medium littéraire, pouvoir atteindre un public plus divers, des lecteurs qui ne s’intéresseraient pas à des œuvres plus théoriques traitant de ce sujet?
C.B. : J’avais posé la question à mes lycéens à l’époque, quand il fallait axer leurs passages à l’oral du bac. Si c’était les contes philosophiques de Voltaire, beaucoup de profs demandaient précisément si, selon les candidats, il valait mieux raconter ou argumenter. Bon, pour répondre, je pense donc qu’il faut en passer par les atours de la fiction pour concerner le plus grand nombre. L’argumentation abstraite a l’avantage d’être moins équivoque et plus précise, mais se prive du gigantesque hameçon qu’est la promesse d’une lecture divertissante. De plus, l’animalisme est d’ores et déjà saturé de textes militants, tandis que la littérature est beaucoup plus timorée – peut-être parce que les écrivains ont tendance à revendiquer une forme d’apolitisme, par honnêteté ou par crainte de passer pour des idéologues. Par souci de liberté aussi sans doute : le but étant d’être relayé par un maximum de médias, mieux vaut se montrer le plus neutre possible… De ce point de vue, l’animalisme a l’avantage de court-circuiter la distribution traditionnelle des idées sur l’échiquier politique.
Toujours est-il que dans la littérature française récente, à l’exception de Vincent Message et Jean-Baptiste Del Amo, j’ai vu très peu d’écrivains se mouiller sérieusement. Quand Wajdi Mouawad fait de l’animalisme dans Anima, c’est presque une coïncidence. En attendant, j’ai souvent entendu que mon bouquin faisait mieux passer les idées que les pamphlets qui existaient déjà ; et je pense que si les gens avaient envie de dire ça, c’est tout simplement parce que j’ai augmenté la dose de sucre autour du médicament. J’ai toujours aimé écrire des histoires d’aventure, et argumenter m’ennuie très vite ; à l’écrit en tout cas. Ce qui me plaît dans l’écriture, c’est d’être libre, de ne pas avoir à suivre la consigne ou le sujet donnés par la maîtresse – c’est vraiment pour ça que j’ai commencé : en me mettant à argumenter, j’aurais l’impression de recommencer à travailler dans les clous. Là, je savais que je pouvais dynamiter la mélodie habituelle du discours animaliste, que ce soit dans le fond – puisque je ne suis évidemment pas d’accord avec tout ce que présente le bouquin – ou dans la forme – j’ai essayé de faire ronronner le style un peu plus que si je m’étais contenté d’un essai.
L’objectif principal était de ne surtout pas être frontal. De baisser un peu l’échine, voire de tendre le bâton pour me faire battre. Pour amadouer le public, montrer patte blanche. C’est aussi une question d’honnêteté : contrairement aux gens qui écrivent des essais, je ne suis pas sûr de n’avoir que des idées claires sur le sujet dont je m’empare. Ces histoires d’action directe, c’est tellement compliqué… La moindre des choses était de ne pas prétendre avoir un cap à montrer, mais plutôt partager réflexions, doutes et sentiments. A part en écrivant un roman dont le héros se cherche et se perd à tour de rôle, difficile de se permettre tout ça. Et puis j’aime vraiment beaucoup les romans d’aventures.
H.C. : « Il faut plonger l’humanité au plus profond du malheur. Lui faire perdre la foi en sa puissance positive », déclare votre personnage principal, Isaac Obermann. Ce pessimisme et cette radicalité semblent caractériser votre livre dans son intégralité. Cela va à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle la littérature doit cultiver une certaine ambiguïté, une certaine polyphonie et doit éviter les prises de position éthiques fortes. L’urgence de la problématique écologique, incite-t-elle ou doit-elle inciter un retour de l’engagement littéraire ?
C.B. : Oui, je trouve coupables les artistes qui parlent des animaux aujourd’hui sans évoquer le martyre qui leur est réservé du fait de l’élevage industriel, de la sixième extinction de masse, ou simplement du fait qu’ils vivent dans un monde les considérant globalement comme moins que ce qu’ils sont. Il y a là une horreur, une catastrophe et une injustice telles que je ne vois pas comment on peut encore se permettre de passer à côté, de se servir des animaux pour nourrir création et visibilité artistiques, sans en contrepartie partager avec eux cette visibilité, les faire bénéficier, même très indirectement, de la création. C’est une neutralité coupable. La science a fait, ces dernières années, en matière d’éthologie et de cognition animale, des bonds immenses, des pas de géants ; mais le droit reste archaïque, et le commerce de l’exploitation animale met un point d’honneur à le contourner quand même, tout archaïque qu’il soit. On ne sera pas énormément d’artistes à travailler pendant la sixième extinction de masse, pour la bonne raison qu’elle se terminera très vite. Comme le dit Isaac à un moment donné je crois : on ne l’a pas choisi, mais c’est tombé sur nous. On ne peut pas continuer de faire comme on avait prévu.
Pour ce qui est du pessimisme et de la radicalité… Je ne sais pas si ça caractérise vraiment le livre dans son intégralité : en théorie, il y a des bulles d’air – tous les moments où les personnages sont confrontés à des animaux sauvages rencontrés par hasard. En revanche, je veux bien reconnaître que la polyphonie soit ici un pur artifice rhétorique servant à éviter l’indigestion qu’aurait représenté un texte ultra-dogmatique. On entend les voix d’en face, il y a un peu de polyphonie quand même… Mais quand les théories animalistes reviennent, c’est dans une explosion dogmatique telle qu’elle ne saurait être uniquement prise pour argent comptant (je pense au moment où Isaac fait exploser la tête du capitaine de baleinier au lieu de poursuivre le débat : une caricature de dogmatisme !).

Camille Brunel
H.C. : Isaac Obermann, qui semble sorti d’un film de Tarantino, se comporte comme une sorte d’ange exterminateur hyperviolent qui applique la loi du talion pour venger les souffrances que les hommes ont infligées aux animaux. Les opposants de cette cause, qui accusent ses militants de pratiquer un « anti-humanisme » ou même de cultiver une « haine de l’humanité », trouveront en Obermann le prototype de l’« éco-terroriste illuminé » contre lequel ils nous mettent en garde au nom du sens commun et du maintien de la civilisation humaine.
Obermann s’oppose radicalement à la violence contre les animaux, mais l’utilise lui-même contre les êtres humains dans sa lutte pour la cause animale. Dans votre épilogue, vous écrivez : « On a tendance à sacraliser la violence, au point de justifier les abattoirs. » Le comportement d’Obermann, n’est-il pas, d’une autre façon, une sacralisation de la violence ?
Considérez-vous qu’Obermann peut constituer en quelque mesure un exemple pour les militants de la cause animale ? Ou avez-vous seulement introduit le personnage afin de provoquer un sentiment de malaise chez vos lecteurs, pour susciter la réflexion ?
C.B. : La campagne hyper-violente de mon héros est un échec retentissant : en cela, je vois mal comment on pourrait m’accuser d’avoir sacralisé sa violence, au sens où il serait un ange exterminateur venu réparer les injustices. Il ne les répare pas : à l’échelle des chapitres, ce sont des victoires ; mais à l’échelle du bouquin, il fait tout empirer. Ou alors, si c’est un ange, il s’y prend vraiment très mal. Obermann n’est idéal que dans la mesure où il est à la fois très bon en argumentation et sur le terrain, ce qui se trouve assez rarement chez les activistes : à quelques flamboyantes exceptions près (citées dans les remerciements !), les personnes qui agissent sur le terrain sont rarement celles qui surmontent le mieux l’épreuve du plateau télé, par exemple. Et c’est bien normal. En dehors de ça, non, Obermann n’est pas un modèle, justement parce que sa campagne échoue.
La raison pour laquelle Isaac est aussi violent est purement littéraire : il agit moins pour appliquer la loi du Talion que par légitime défense, parce qu’il s’identifie aux animaux, et se sent agressé au même titre qu’eux. Ce qui compte dans ce livre, c’est de montrer quelqu’un de radical, et de faire l’éloge de la radicalité et de l’action, nécessaires à mon sens dans la mesure où les gens susceptibles de lire mon roman vivent dans une société ultra-confortable et ultra-nuisible. Il faut donc les sortir de ce confort (de la même manière que j’estime être sorti du mien en faisant le sacrifice d’une grande partie des aliments que j’aimais consommer), et les inciter à agir plus vite et plus fort ; chacun verra ensuite la radicalité à sa porte. Si j’arrive à susciter un peu de sympathie pour les activistes, c’est une victoire aussi : le livre montre, de l’intérieur, comment on peut en arriver à désobéir aux lois humaines, au nom des animaux (la biographie de Gandhi a été une de mes bases). Il ne s’agit évidemment pas d’accompagner Isaac jusqu’au bout de son cheminement intellectuel dans la vraie vie, mais si on peut l’accompagner pendant une partie de son chemin, avant de s’en désolidariser et de le regarder devenir fou à un moment donné, c’est déjà quelque chose, j’en suis certain.
H.C. : Obermann se dit prêt à se sacrifier pour la cause animale et dans votre épilogue personnel vous écrivez que, lorsque la Terre aura survécu à l’humanité, vous serez « poussière, mais poussière heureuse, parmi les coquillages ». D’autre part, Obermann dit que « Toutes les œuvres d’art réunies, littérature, architecture, peinture, cinéma, ne valaient pas le centième de cet instant où une seule baleine avait daigné percer la pellicule des flots et faire entendre l’écho de la vieille promesse du bonheur sur Terre ». En votre propre nom, vous écrivez que « rien ne [vous] a jamais apporté autant de bonheur que de voir des marsouins approcher [votre] zodiaque en Écosse, de voir une baleine à bosse faire surface devant mon kayak en Colombie-Britannique. » Cependant, « ce bonheur [de contempler des animaux] qui est le comble de l’existence » n’implique-t-il pas qu’il faut un être humain pour en profiter ? L’engagement pour la cause animale pour elle-même est-il possible, ou y a-t-il toujours une motivation humaine sous-jacente ?
C.B. : Ah… Non, je pense pas que ce soit possible dans la mesure où nous ne sommes pas des machines : nous tirerons toujours un peu de plaisir collatéral, que ce soit à l’idée d’avoir fait ce qu’il fallait, ou à l’idée de pouvoir jouir de la rencontre avec les animaux dont on aura assuré la survie. Le principal, c’est que ce plaisir ne soit pas l’objectif dominant, mais bel et bien un avantage collatéral de l’engagement. Pour laisser les gens respirer, j’ai fait en sorte qu’il y ait régulièrement des passages de la Guérilla où l’on était un peu heureux : si le livre avait été aussi noir que le désespoir visé par Isaac, et seulement noir comme ça, il aurait juste rendu tout le monde nihiliste ; ça n’est évidemment pas l’objectif.
De toute façon, l’engagement pour la cause animale ne peut fonctionner que d’après une motivation humaine, non ? Je veux dire, les animaux ont le sentiment de la justice, et sont capables d’intervenir pour se protéger les uns les autres (voir Battle at Kruger, dont je parle dans Le Cinéma des animaux), mais l’idée de justice, de droit, la conscience de notre responsabilité dans leur disparition et donc de notre devoir de réparer les dégâts, voire de ralentir la catastrophe… Tout ça, ce sont des notions humaines, des concepts forgés par des cerveaux d’homo sapiens. L’idée est de faire profiter les autres espèces non seulement de nos avancées technologiques (grâce à elles, nous pouvons nous passer de manger les animaux, pour commencer), mais aussi de nos avancées morales (l’antispécisme en tête).
L’idéal d’une Terre débarrassée des humains, comme je le formule de façon un peu insolente à la toute fin du tout dernier paragraphe, c’est un idéal par défaut, un idéal ayant pris en compte l’incapacité de l’humanité telle qu’elle existe aujourd’hui, et à laquelle s’adresse le livre, à se retenir de tout bouffer comme un essaim de sauterelles. L’idéal de chez l’idéal (mais ça je crois que c’est quelque part dans le livre aussi…) ce serait une Terre où il n’y aurait plus cent millions de fois plus d’humains que d’orang-outans, par exemple, une Terre où les humains qui resteraient pourraient se montrer dignes du bonheur qu’il y a à rencontrer des gens qui n’appartiennent pas à leur espèce, à les regarder. Mais ça ce sera pour le bouquin d’après, je crois.
H. C. : Vous avez également publié une enquête critique sur les animaux dans le cinéma. Il me semble que l’influence du cinéma est visible dans votre style d’écriture : le livre est une succession de chapitres courts, il y a beaucoup de ‘cuts’ abruptes et de changements de lieu, les décors défilent, vous préférez montrer les personnages en action au lieu de développer des réflexions autour de leur psychologie. Pourquoi avez-vous fait ce choix stylistique ?
C. B. : Tout simplement parce que j’ai regardé dix fois plus de films que je n’ai lu de livres ! Mais aussi parce que j’ai l’impression que les écrivains, depuis l’apparition du cinéma, ont toujours plus ou moins fonctionné par rapport à ce que proposait le cinéma en même temps. Je dis ça parce qu’en lisant La Peste de Camus j’avais vraiment l’impression de regarder un film de Jean Renoir, il faudrait creuser, ça ne marche pas forcément à tous les coups… D’ailleurs Michael Crichton écrivait pour le cinéma à venir, et quand j’ai écrit Vie imaginaire de Lautréamont, l’idée était aussi d’imaginer des choses dont le cinéma n’était pas encore capable ; ou alors qui coûteraient extrêmement cher à réaliser.
L’influence de Baudelaire et de Lautréamont explique aussi la brièveté des chapitres, pensés pour fonctionner indépendamment les uns des autres – la trame narrative est un avantage, mais elle n’est pas fondamentale. C’est donc peut-être plus lié à la structure des recueils que des films de James Bond. Chaque chapitre doit fonctionner indépendamment du reste, comme un petit poème en prose ou un chant de Maldoror. Après, mais je ne sais pas si c’est très conscient : développer la psychologie de mes personnages (outre le fait que, pour tout dire, je ne sais pas comment on fait) aurait simplement contribué à souligner ce qui nous sépare encore, faute d’outils pour l’explorer, de la psyché animale, n’est-ce-pas ? L’action, l’attaque, la joie, la course, la colère, ces choses-là sont interspécifiques ; il valait donc sans doute mieux mettre l’accent sur elles.
H.C. : « Aujourd’hui, plusieurs vaisseaux sont passés déchirer le ciel. Très vite, plusieurs de mes frères et sœurs ont disparu. L’océan devenait désert, et il sentait le sang des nôtres. En fin d’après-midi, une barre de métal m’a perforé le crâne. On m’a hissé à la surface de l’univers, où un autre harpon est venu se planter dans ma gueule ouverte. Il m’a semblé reconnaître ces animaux partiellement non comestibles, mais j’ai rapidement suffoqué. » Vous semblez pratiquer l’antispécisme dans votre écriture : même si le point de vue humain est privilégié, vous insérez également des chapitres écrits du point de vue des animaux. Est-ce que cela est pour vous une autre manière de remettre en cause l’anthropocentrisme ?
C.B. : Oui, tout à fait. Il y a deux chapitres écrits du point de vue d’un animal, pour être exact : dans un requin, et dans un éléphant. C’est une manière de montrer qu’il y a du monde dans les animaux aussi, bien sûr. Qu’eux aussi souffrent, chacun à leur manière, pour des raisons plus ou moins complexes – le requin, animal très archaïque déjà présent à l’époque des dinosaures, souffre parce qu’il a faim et que son univers se vide ; l’éléphant, très proche de nous, déplore la perte des membres de sa famille. Leur souffrance compte aussi, elle peut être montrée d’une façon qui ne soit pas de l’anthropomorphisme : c’est aussi un exercice important de montrer que ce n’est pas parce qu’on fait parler un animal en français qu’on nie forcément ce qui se passe chez lui, ou qu’on se trompe complètement sur la réalité de son monde intérieur.
Au contraire, je suis vraiment partisan de ce qu’Eric Baratay appelle l’anthropomorphisme de lecture. A la place de cet animal, est-ce que je ressentirais quelque chose de très différent dans la même situation ? Ma perception du monde, dans telle ou telle situation, est-elle si intellectualisée que ça ? C’est même le contraire de l’anthropomorphisme : quelque chose comme du zoomorphisme, appliqué à l’humain. Ce faisant, je fais descendre la cognition humaine de son piédestal arbitraire, et je réhausse la cognition animale, injustement dénigrée depuis des siècles et des siècles. Cela implique évidemment de se décentrer, de penser à partir d’autres organes, et de montrer que la perception du monde, quand elle dépend d’organes différents des nôtres, n’est pas spécialement appauvrie ou négligeable. Doser l’anthromorphisme est fondamental, et c’est la clé du discours antispéciste ; peut-être bien de la littérature antispéciste aussi, si elle finit par exister un jour (j’espère bien).
Comment citer cet article:
Camille Brunel, Hannah Cornelus, « La littérature au service de l’animalisme, l’animalisme au service de la littérature. Échange entre Camille Brunel et Hannah Cornelus autour de La Guérilla des animaux » in Literature.green, Mars 2019, URL: www.literature.green/la-litterature-au-service-de-lanimalisme-lanimalisme-au-service-de-la-litterature-2/, page consultée le [date].
