« Le bois qui pleure »
Entretien de Pascal Manoukian avec Corinne Fournier Kiss autour du Cercle des Hommes
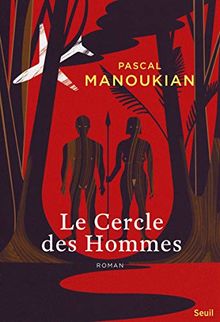
Pascal Manoukian a été reporter spécialisé dans la couverture des conflits. En 2015, à 60 ans, il quitte le journalisme pour se consacrer à l’écriture. Son premier récit, Le diable au creux de la main (2013) publié chez Don Quichotte, raconte ses 25 ans de reportage. Les Échoués (2015), son premier roman, obtient le prix « Première » en 2016. Il publie ensuite Ce que tient ta main droite t’appartient (2017), prix des lecteurs au salon de Brive, puis Le Paradoxe d’Anderson (2018). Le Cercle des Hommes (Seuil, 2020) met en scène la rencontre surprenante d’un homme d’affaire puissant, dénommé Gabriel, qui s’écrase aux commandes de son avion en pleine Amazonie, et d’une tribu d’Indiens isolés, ne connaissant du monde que le cercle dans lequel ils nomadisent.
Corinne Fournier Kiss : Le Cercle des Hommes, publié aux éditions du Seuil en 2020, est sans doute votre roman le plus écologique. Peut-on parler d’un « tournant écologique » dans votre vie et dans votre pensée ? Et si oui, est-il redevable d’un événement en particulier ?
Pascal Manoukian : Oui, de toute évidence, c’est mon roman « le plus écolo ». Les trois autres s’intéressent à des sujets où l’écologie n’est pas une priorité : la désespérance des migrants dans Les Échoués, le système d’embrigadement de Daesh dans Ce que tient ta main droite t’appartient et la violence sociale dans Le Paradoxe d’Anderson.
De fait, j’ai toujours été conscient à la fois de la beauté du monde et de sa fragilité. De sa beauté d’abord, pour avoir commencé ma vie d’adulte à l’explorer en parcourant l’Islande, l’Amazonie et le Sahara à une époque (dans les années 70) où l’on pouvait encore s’y perdre, disparaître littéralement pendant des mois, seul, sans être suivi à la trace, sans possibilité de communiquer instantanément ses émotions, en les vivant simplement. De sa fragilité ensuite, pour avoir pendant 25 ans sillonné le pire, vu la guerre détruire les hommes mais aussi leurs plus beaux paradis, les forêts du Cambodge, les vallées afghanes, enflammer des fleuves, raser des montagnes.
Comme beaucoup de personnes de ma génération, j’ai malheureusement fait le constat du pire sans jamais pour autant me remettre en cause, si ce n’est marginalement ou symboliquement. Il a fallu la naissance de ma petite-fille pour me réveiller.
C. F. K. : Pourquoi avoir choisi ce titre, Le Cercle des Hommes? Qu’avez-vous voulu signifier exactement par cette expression ?
P. M. : Le titre original était Les rescapés du bois qui pleure, mais l’éditeur n’en a finalement pas voulu. Il a donc fallu en chercher un autre. La figure du cercle (celui de la lune, du territoire, des assemblées) a beaucoup d’importance dans le roman et l’Homme est au cœur de tous ces cercles. C’est comme ça que l’idée m’est venue. J’ai demandé que le mot « homme » soit écrit avec un H majuscule, car le cercle est aussi peuplé de femmes et qu’elles jouent un rôle important dans l’histoire.
C. F. K. : Votre roman débute par deux épigraphes, l’une venant de la science moderne à travers la voix d’Albert Einstein (« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire »), l’autre venant des Indigènes, des « primitifs », à travers la voix du chef Seattle (en l’occurrence, sa lettre de 1854 au gouvernement américain contenant la fameuse déclaration selon laquelle « La terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre »). Pourquoi ce choix d’épigraphes d’origines si différentes, perçues par notre imaginaire occidental comme étant diamétralement opposées ?
P. M. : Juste pour la beauté des deux citations d’abord. C’est mon plaisir en début d’écriture que de chercher les épigraphes qui ouvriront le livre. Je connaissais depuis longtemps le discours du chef Seattle. J’ai eu la chance à 17 ans de vivre dans une réserve indienne du Dakota et un chef Crow me l’a récitée de mémoire, avec d’autres, un soir où nous dormions à la belle étoile.
La phrase d’Einstein, en revanche, je l’ai découverte pour le livre et elle m’a semblé évidente, même si je l’ai détournée de son sens premier. Elle est liée en réalité à la découverte de l’atome et au mauvais usage qui peut en être fait. Elle pose une question essentielle : peut-on être considéré comme responsable d’une catastrophe qu’on a laissé faire ? En matière de non-respect de l’environnement, je réponds oui : ma génération porte une lourde responsabilité. Mais ce qui m’intéresse le plus dans votre question c’est l’opposition que vous introduisez entre « primitifs » et « civilisés » même si ces mots ne sont pas prononcés dans le Cercle des Hommes. Je me suis amusé dans ce roman à inverser les points de vue, à faire de l’ethnologie inversée, à voir le monde avec des yeux d’Indien, à rendre les primitifs civilisés et vice versa.
C. F. K. : Oui, l’une des grandes forces de votre ouvrage est de présenter de l’intérieur une tribu d’Indigènes, la tribu des Yacou (fictive mais plausible), comme une tribu « civilisée » à part entière. Mais ne s’agit-il pour vous que d’un jeu ? Les Indigènes ne sont-ils pas des civilisés à leur façon ? Et pourquoi parler d’« ethnologie inversée » ?
P. M. : Quand je dis « je me suis amusé », je fais référence au parti pris littéraire, au choix de me mettre dans ce livre à hauteur d’Indien. Pour le reste, cela n’a rien d’un jeu, et les peuples « primitifs » n’ont rien de primitif : ils ont au contraire beaucoup à nous apprendre. Ils ont développé d’autres formes d’intelligence, et c’est ce que découvre Gabriel. Pour arriver au niveau de connaissances de nos sociétés, nous avons dû oublier des savoirs plus importants encore, comme parler aux esprits, voyager en dehors de nos corps, converser avec les autres espèces.
Quant à l’expression « ethnologie inversée », elle renvoie à la pratique de l’ethnologue et réalisateur Jean Rouch qui consistait à faire observer et étudier les Blancs par des Noirs : elle est d’ailleurs mise en scène dans son film Petit à petit (1970), dans lequel un Africain, se faisant passer pour un étudiant, arrête sur le parvis du Trocadéro à Paris des passants blancs, en costumes, cravates et attachés cases, pour mesurer au pied à coulisse l’écartement de leurs narines et vérifier leurs dentitions. Or, de même dans mon roman, c’est Gabriel qui est le « bon sauvage », c’est lui qui est observé, étudié, jugé par les Indigènes.
C. F. K. : Je sais que dans votre jeunesse, vous avez passé quelques mois dans l’Amazonie et eu des contacts avec une tribu isolée. Pourquoi avoir attendu 45 ans avant de transformer cette expérience en récit ? Cet important laps de temps doit-il être compris comme étant un temps d’assimilation et de maturation de cette expérience ? Vous a-t-il permis de faire certaines lectures pouvant vous aider à mieux raconter l’Indigène ? Avez-vous lu, en particulier, Philippe Descola, l’un des anthropologues ayant donné l’impulsion la plus puissante pour un renouvellement de la compréhension occidentale de l’Indigène ?
P.M. : J’ai toujours gardé au fond de moi toutes les émotions de cette première expérience amazonienne. J’ai passé avec deux compagnons six mois en survie totale en forêt dans le sud de l’Amazonie colombienne, avant de croiser un groupe de chasseurs cueilleurs qui connaissaient la mauvaise réputation de l’homme blanc mais n’avaient eu encore aucun contact avec lui – exception faite pour Mue, l’ancêtre du groupe qui se gardait bien d’en parler, tout comme le personnage Mue de mon roman.
Pour un jeune homme de 19 ans, cela représente une aventure inoubliable qui change définitivement sa vision du monde. C’est une autre aventure inoubliable, quarante-quatre ans plus tard, qui m’a donné l’envie d’écrire Le Cercle des Hommes : la naissance de Jade, ma première petite fille. En la voyant arriver dans le monde que ma génération lui laissait, j’ai aussitôt repensé à Mue et aux siens. Leur cercle et leurs lois avaient-ils changés autant que les miens ? L’idée m’est alors venue de faire s’écraser l’avion de Gabriel au milieu de l’Amazonie et de confronter les deux mondes.
Côté lecture, j’ai lu bien sûr Les Lances du crépuscule de Descola. À l’époque de mon expédition amazonienne, en 1976, il débutait son travail chez les Jivaros Achuar en Équateur. Avant de partir, j’ai surtout lu les ouvrages du Marquis de Wavrin ethnologue-explorateur belge, notamment Mythologie, rites et sorcelleries des Indiens de l’Amazonie et son remarquable bestiaire Bêtes sauvages d’Amazonie. J’ai dévoré aussi Le chant du Silbaco de Jacques Meunier et Anne-Marie Savarin, le récit implacable de l’agonie des Indiens d’Amérique latine.
C. F. K. : Vous nous montrez des Indiens extrêmement respectueux de la nature, leur discrétion est telle qu’ils ne laissent aucune empreinte écologique dans la forêt et dans le monde. Je vous cite : « Les hommes […] effacè[rent] les traces de leur passage. Rien ne devait trahir leur présence, par respect pour ce monde dont ils dépendaient entièrement d’abord, mais aussi envers chaque vivant avec qui ils le partageaient […]. Tous vivaient dans le même Cercle, depuis toujours. Ils n’en avaient qu’un, précieux, et se devaient de transmettre ce bonheur sans une couleur, une odeur, un chant, sans un son ni un cri manquant » (p. 43) ; ou encore : « Il fallait s’approcher pour les [les Yacou] deviner entre l’épaisseur d’un trait de feuillage et de mousse […]. Ils semblaient avoir été déposés là par un coup de vent, simples éléments parmi les éléments, juste de quoi vivre, le minimalisme absolu. Une communauté de peaux, d’os, d’armes en bois, de nattes végétales, aucune offense à la nature, nul superflu. Une vie entièrement biodégradable, zéro déchet, une empreinte carbone réduite au minimum vital : respirer, se chauffer, éliminer » (p. 66-67).
Qu’est-ce à dire ? Pensez-vous que l’Indigène soit l’écologiste par excellence ? L’Indigène a-t-il une leçon d’écologie à nous donner ?
P. M. : Bien sûr. Les quelques tribus qui vivent encore isolées dépendent entièrement de la nature, et donc elles la respectent. Elles n’en entament jamais le capital. Elles se contentent sagement de vivre de ses fruits et s’imposent des règles pour ne jamais déroger à ce principe. Pour les Indigènes, contrairement à nous, la nature n’est pas un simple décor, et eux-mêmes se perçoivent comme faisant partie intégrante de la biodiversité, à égalité avec les plantes et les animaux. Ils ont conscience que toute agression envers l’un des éléments de notre écosystème est une blessure qu’ils s’appliquent à eux-mêmes. C’est la grande leçon qu’ils ont à nous donner. En voyant s’effriter dangereusement la merveilleuse toile de fond qui nous a été donnée, nous commençons d’ailleurs à le comprendre, mais malheureusement peut-être un peu trop tard ?

Pascal Manoukian
C. F. K. : Vous êtes journaliste de profession, et vous avez également été journaliste de guerre. Vous avez donc l’habitude de communiquer certaines vérités dures ou désagréables de manière directe. Pourquoi, pour parler de thèmes de l’actualité tels que la déforestation accélérée de l’Amazonie et la maltraitance des Indiens sous l’ère Bolsonaro, avez-vous choisi, plutôt que le reportage, la littérature qui, par définition, est du côté de la fiction ? Croyez-vous au pouvoir de la littérature sur le monde et si oui, de quelle nature est-il ?
P. M. : J’ai choisi la fiction parce que, comme le dit Nancy Huston dans L’Espèce fabulatrice (2008), je crois qu’elle pénètre notre cerveau, le forme et le transforme. J’ai longtemps défendu le point de vue que la réalité était plus puissante. C’est mon métier qui me l’a fait croire. Quand on rentre du Rwanda, juste après le génocide, rien ne semble plus fort. Et puis j’ai écrit et j’ai compris le pouvoir de l’écriture. Lire (de la littérature) est un acte intime. On emporte les personnages chez soi, dans le cocon de sa chambre ou d’un salon. On vit avec eux pendant des semaines, on les trimballe dans le métro, à la campagne, en vacances sur la plage, on prend le temps de les comprendre. Le journalisme c’est l’émotion, la littérature la réflexion. On relit rarement un reportage, on rouvre souvent un livre. C’est pour cela qu’il faut écrire sur les choses importantes.
C. F. K. : Vous évoquez à plusieurs reprises dans votre fiction une figure qui n’a rien de fictif et qui est bien connue du lecteur contemporain, à savoir celle du Président brésilien Jair Bolsonaro. Vous n’hésitez pas, entre autres, à le décrire comme un raciste « chasseur d’Indiens » et un antiécologiste sans préoccupations aucunes pour l’écosystème et les espèces menacées – ce qu’aucun roman brésilien, à ma connaissance, n’a osé faire jusqu’ici. Avez-vous eu des réactions de lecteurs à ce sujet ?
P. M. : En fait, j’ai commencé par hasard l’écriture de ce roman la semaine de l’élection de Bolsonaro et de ses déclarations sur les cultures indiennes – qui selon lui n’en sont pas et qui ne méritent pas qu’on leur réserve 11% du territoire national brésilien. Il s’est donc invité lui-même dans mon roman. J’ai vécu quelques mois au Brésil en 1977 sous la dictature militaire et j’ai trouvé l’épreuve injuste pour les Brésiliens. On m’a souvent interrogé sur ce grand bond en arrière du Brésil aux cours de mes interventions. L’Amazonie est un patrimoine mondial vital pour l’humanité, et le savoir entre les mains d’un être pour le coup si « primitif » a beaucoup inquiété et ne cesse d’inquiéter mes lecteurs.
C. F. K. : Parlez-nous un peu de votre personnage principal, Gabriel, l’homme d’affaires occidental dont l’avion privé s’abîme en pleine Amazonie. Quand il est présenté pour la première fois, il toise l’Amazonie de haut – à la fois au sens propre, puisque qu’il survole en avion l’Amazonie, et au sens figuré, puisqu’il fait partie, en tant que chef d’un important consortium minier, des « nouveaux conquistadors de l’Amazonie ». Une fois prisonnier de l’Amazonie et au fur et à mesure du développement de sa relation avec les Yacou, sa conscience éthique, aussi bien écologique qu’humaine, s’éveille, et il finit par fortement s’attacher au monde de la forêt. Comment expliquer psychologiquement Gabriel ? Pourquoi avoir transformé un personnage, actif dans sa participation à l’exploitation des forêts du Brésil, en homme qui, lorsqu’il comprend toute la valeur et toute la beauté de l’Amazonie, de sa biodiversité et de ses Indigènes, hésite entre se retirer du monde ou y revenir comme activiste ?
P. M. : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire », dit l’épigraphe d’Einstein. Gabriel, comme beaucoup d’entre nous, est déchiré par le choix de l’attitude à adopter pour lutter contre la catastrophe annoncée, lui qui a la chance, dans son malheur, de redécouvrir le monde tel qu’il était avant que l’homme ne le saccage. Que convient-il de faire ? Rentrer, et s’activer pour essayer d’inverser ce qui est encore inversable ? Ou prendre sa place dans le cercle et neutraliser un des rouages de la machine infernale en apportant sa goutte d’eau comme le colibri ? Il faudra lire le roman jusqu’au bout pour le savoir.
Pour la première fois depuis l’histoire de l’humanité, un évènement scientifiquement annoncé met à égalité devant la fatalité les quelques sept milliards d’individus de la planète. Pourtant, malgré les effets déjà visibles du dérèglement climatique, chacun espère encore s’en sortir sans effort et compte sur l’autre pour faire les sacrifices.
Personnellement, j’avance l’espoir que l’ultra-libéralisme porte peut-être malgré lui la solution. Si exploiter la planète devient brusquement moins rentable que de la protéger, si les profits sont à trouver dans l’écologie, alors sans états d’âmes, les multinationales mettront la même frénésie à restaurer ce qu’elles ont détruit. Pas par conviction mais par intérêt.
Pour citer cet article :
Corinne Fournier Kiss, Pascal Manoukian, « ‘Le bois qui pleure’. Entretien de Pascal Manoukian avec Corinne Fournier Kiss autour du Cercle des Hommes » in Literature.green, février 2022, URL: https://www.literature.green/le-bois-qui-pleure-entretien-manoukian, page consultée le [date].
