L’environnement de la modernité
Entretien de Jérôme Meizoz avec Riccardo Barontini autour d’Absolument Modernes ! et de Haut Val des Loups

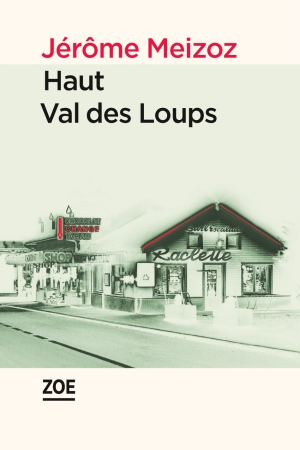
Né dans la région suisse du Valais, Jérôme Meizoz est écrivain et professeur à l’Université de Lausanne. À partir d’une narration autobiographique attentive aux dynamiques politiques et sociales, il explore de plus en plus les territoires de la fiction, dans une œuvre qui se lie à double fil à l’histoire de la Suisse, du vingtième siècle à nos jours. Son premier livre Morts ou vif (1999) a été désigné «Livre de la Fondation Schiller Suisse 2000». En 2005, il reçoit le prix Alker-Pawelke de l’Académie suisse des sciences humaines (ASSH). Parmi ses livres, Les Désemparés (2005), Père et passe (2008), Fantômes (2010, avec Zivo), Séismes (2013), Temps mort (préfacé par Annie Ernaux, 2014) et Faire le garçon (2017).
L’écologie est au centre de deux de ses ouvrages récents : le premier, Haut Val des Loups (2015), en retraçant l’enquête sur le tabassage d’un militant écologiste dans le Haut Val en 1991, dresse un tableau inédit des conflits liés à l’environnement en ces lieux. Le deuxième, Absolument modernes !, paru en 2019, se présente comme une chronique de la modernité suisse au cours des Trente Glorieuses. Le protagoniste Jérôme Fracasse s’interroge sur l’impact social et environnemental de la foi dans la croissance, dans la technologie et dans le libre marché, entre souvenirs familiaux, documents historiques et portraits individuels.
.
Riccardo Barontini : Dans votre dernier livre, Absolument modernes!, vous abordez une question centrale dans la réflexion écologique, la nécessité de déconstruire le mythe néfaste de la croissance, qui s’est imposé au siècle dernier et en particulier à partir des Trente Glorieuses. Votre narration est rythmée par le retour du calembour « Croissance, croit sens, croâ cens » qui me semble associer à la croissance une recherche de signification illusoire ; il évoque aussi un mauvais présage par le cri du corbeau uni à une allusion à la question des classes, des déséquilibres de richesse. Ce calembour synthétise-t-il pour vous une description possible des dégâts de la modernité ?
Jérôme Meizoz : J’ai ajouté ce calembour assez tard dans la rédaction du livre, parce que je cherchais deux ou trois «refrains» pour rythmer la narration. Parmi ceux-ci, il y a les phrases sur l’absence de Dieu (en congé sabbatique, en congé maladie ou aux sports d’hiver), et puis ce cri de corbeau (la sonorité s’est imposée), plutôt lugubre dans notre imaginaire, mais porté par un animal très intelligent, redoutablement habile, capable de leurrer ses congénères et l’homme, de recourir à de proto-outils, etc. Oui, c’est bien le mauvais présage contenu dans le pari total sur la croissance comme voie unique et infinie, que l’on entend là. Et l’actuelle perte de sens qui guette bien des gens. Pour autant, je ne suis ni historien spécialiste de la croissance, ni ornithologue. J’use donc de savoirs qui sont secondaires, immergés dans la parole du narrateur, Jérôme Fracasse, dont on sait qu’il est excessif, polémique, farceur jusque dans sa mission de préposé aux écritures. J’espère que le lecteur perçoit cette médiation. Fracasse est par ailleurs travaillé par le doute. Il a aimé de tout son cœur cette promesse de croissance et en a joui comme les autres. Il a aimé l’odeur de diesel des machines agricoles, qui signifiait l’allégement heureux de la peine physique. Il ne peut pas se contenter de dire avec suffisance que les autres se sont trompés. Enfin, il ne sait pas quel sens attribuer à cette période, il espère le découvrir en la décrivant…
R.B. : Absolument modernes ! est composé de treize « chroniques » qui mélangent des souvenirs personnels du narrateur Jérôme Fracasse, une analyse à la fois sociologique et polémique, documents à l’appui, de l’évolution de la modernité en Suisse, et des portraits de personnages du Haut Val en Suisse, les treize « Anges », que le narrateur appelle à l’aide « pour ne pas être celui qui éteint la lumière en partant » (AM, p. 149). Vous attribuez à cette construction complexe le label de « roman ». J’aimerais donc vous interroger sur les raisons qui vous ont poussé à adopter ce choix générique, qui ne me semble pas tout à fait évident : en quoi ce texte est-il un « roman » pour vous ?
J.M. : Je fais partie de ceux qui déplorent que la littérature actuelle, dans la presse à grand tirage, soit réduite au seul roman, et ceci pour des raisons surtout pécuniaires. D’ailleurs mes premiers ouvrages ne sont pas des romans, mais relèvent de pactes autobiographiques. J’aime écrire à partir de l’observation et du recueil de paroles. Les portraits que j’affectionne (y compris les «anges» dans Absolument modernes !) sont tous inspirés directement d’une personne réelle. Et pourtant, depuis Haut Val des loups (2015), «vrai roman» sur un sujet environnemental, la fiction m’a semblé permettre plus de liberté. Juridique déjà, car je traitais d’une affaire pénale grave qui a abouti à un non-lieu et dont les protagonistes sont vivants. Mais liberté narrative aussi, dans Absolument modernes ! : plutôt que d’être enchaîné à la mission de raconter des faits épars, une structure les organise (13 chroniques, 13 portraits), avec un fil narratif (le père au fil des Trentes Glorieuses et puis sa fin), le tout vu et ressenti par un narrateur de fiction, Jérôme Fracasse. Que ce narrateur soit très proche de moi (une sorte d’alter ego farfelu) ne fait pas mystère. Mais la fiction permet de mettre du «jeu» dans la manière de raconter et de faire des liens, des images, des suggestions que le texte factuel interdirait.
R.B. : Vous écrivez que « L’imaginaire moderne avance en détruisant. Faire place nette. Nettoyez-moi cette poussière ! » (AM, p. 25). Cela est mis en relation avec la disparition d’un autre type de représentation du monde, « la pensée sorcière », qui « bourgeonnait d’analogies et de symboles » (AM, p. 24). Pouvez-vous revenir sur le sens que recouvre pour vous cette opposition ?
J.M. : C’est une opposition issue des réflexions sur la modernité (Lefort, Rancière ou Castoriadis) : la modernité se veut franche rupture avec le passé, elle rejette dans le domaine des superstitions toute une série d’usages, de façons de parler et de penser. La modernité a disqualifié le vernaculaire, et avec lui l’improvisation, l’auto-organisation, la création sociale horizontale, etc. Elle forge un projet techno-scientifique qui homogénéise les modes de perception de la «nature» et rend celle-ci disponible à la prédation humaine. Quand je dis que la grand-mère «n’y comprenait plus rien», c’est littéralement cela. Tous le codes et dispositions dont elle avait hérité (rapport aux bêtes, type d’agriculture, herboristerie, codes religieux, patois et transmission orale, etc.) sont devenus soudain caducs de son vivant. L’Histoire a connu une accélération prodigieuse au XXe siècle. Le père, quant à lui, n’a de cesse de reléguer au passé, avec bonheur, les habitudes et croyances qui freinent les promesses modernes. Il vante la voiture, l’industrie pharmaceutique, les grands magasins. De même, le frère de Fracasse, étudiant en médecine, raille les survivances des guérisseurs vernaculaires (plantes, ventouses, etc.). Le nom «Meizoz» veut dire guérisseur, en dialecte franco-provençal, et non pas médecin au sens récent et diplômé du terme. Ma position n’est pas de revenir à la «pensée sorcière» mais de savoir ce que nous avons perdu (ce que l’on a gagné, je le reconnais) en rejetant parfois sans distinction toute une série de savoirs et de dispositions… Des anthropologues comme Philippe Descola ou James Scott se posent des questions analogues à propos de sociétés (amazoniennes ou asiatiques) en transition vers la modernité.
R.B. : Vos livres dénoncent le fait que la nature suisse, souvent idéalisée et réduite à un cliché, a grandement subi les ravages de la modernité et du progrès, de la spéculation immobilière, de la construction d’infrastructures non durables, de l’usage massif de pesticides dans l’agriculture. Le développement du tourisme a été l’un des catalyseurs de ce processus : « Dans le Haut Val le tourisme investit les sommets. On déboise à la va-vite cent hectares d’une forêt de protection, sans laisser le temps aux opposants de réagir » (AM, p. 74-75) Jérôme Fracasse fait également référence au mépris que la cause écologiste a longtemps suscité en Suisse en évoquant des formules tranchées telles que « Une giclée de Roundup et basta avec ce flower power » (AM, p. 89). Pensez-vous que votre représentation et votre dénonciation sont plus facilement compréhensibles et recevables au niveau collectif aujourd’hui ?
J.M. : Sans doute que oui, car la conscience environnementale publique, nourrie par les médias, a beaucoup progressé depuis les années 90 que je raconte dans les deux livres cités. La Suisse alémanique a fait bien plus vite, sous l’influence du voisin allemand, sa prise de conscience écologique. Mes livres parlent principalement du Valais francophone, à savoir le sud alpin de la Suisse qui a bâti sa croissance, depuis les années 1960, sur l’agriculture intensive, la spéculation immobilière et le tourisme. Avant cela, les Alpes étaient une région plutôt pauvre, avec une agriculture de montagne peu rentable. Jusque dans les années 1990, il y a eu des déboisages non autorisés pour créer des pistes de skis, des constructions illégales dans les stations, et tout cela avec la complicité ou la tolérance d’élus qui y trouvaient un intérêt. L’affaire du passage à tabac du secrétaire du WWF-Valais, en février 1991, dont traite Haut Val des loups, illustre bien le mépris railleur et violent que les milieux immobiliers, certains élus, la presse locale et une partie de la population avaient pour les militants écologistes. Des écrivains engagés pour la protection du patrimoine naturel, comme le poète Maurice Chappaz (1916-2009) ont reçu des menaces de mort sous forme de petits cercueils en carton dans leur boîte aux lettres… En Suisse, dès que l’argent est en cause (et surtout le droit de gagner beaucoup d’argent sans entraves), le rappel à l’ordre peut surgir à tout moment. La démocratie sans conflits ni grèves, la Suisse sage et médiatrice, tout cela est une vitrine proprette dissimulant un rapport de force inégal entre les élites néolibérales et une partie de la société civile.

Jérôme Meizoz
R.B. : J’ai trouvé particulièrement révélatrice la manière dont Jérôme Fracasse attaque le mythe de la nature en Suisse : « Tout le monde se fie au cliché de Victor Hugo : La Suisse trait sa vache et vit paisiblement. Eh bien non ! Sous ses dehors débonnaires, la vache a bel et bien permis le premier stade machinique » (AM, p. 40). D’une certaine manière donc, le symbole même de la nature suisse, présent dans nombre de cartes postales, est lié à l’argent, à la croissance, à la mécanisation, au progrès. Voulez-vous dire que même nos représentations de la nature à préserver sont contaminées ? Et dans ce cas, comment les décontaminer ?
J.M. : Je ne sais pas. Disons que le narrateur, Fracasse, développe une théorie cocasse sur le capitalisme suisse et sa collusion avec l’alpage. Les belles meules de fromage doré, vendues très cher à ce gourmand de Louis XIV, ont fini par devenir des monnaies d’or trébuchantes. La conservation du fromage, chez un peuple d’éleveurs de montagne, a été une formidable invention. Et puis le mot fromage vient de «forma» : c’est donc tout un style ! Fracasse y voit l’accumulation primitive du capital. Fin de la rêverie historique… Pour revenir aux choses sérieuses, il est certain que la «nature» suisse depuis le XIXe siècle est devenue la belle façade du tourisme et des affaires, destinée à poétiser les choix d’une oligarchie au pouvoir (Hans-Ulrich Jost ou Jean Ziegler l’ont décrite) dans un petit pays qui ne pouvait pas tirer richesse de ses ressources naturelles. Même la Suisse préservée de «l’écologiste» Franz Weber (ses textes sont clairs) renvoie à une imagerie doucement nationaliste et chrétienne, à une joliesse pleine de bons sentiments. Avec tout cela, on ne connaît pas grand-chose de la Suisse industrielle, discrète comme le Capital. Nous sommes aussi le pays des toutes premières centrales nucléaires en Europe : cette fois, on ne s’en vante plus.
Enfin, «décontaminer nos représentations de la nature» suppose d’abord qu’on sorte du piège de l’opposition nature/culture. Qu’on se dote d’une autre vision, plus complexe et moins prédatrice, de la «nature». Que celle-ci ne peut pas se décrire du dehors : nous en sommes. Je pense à notre rapport aux animaux, aux plantes, etc. Il ne s’agit pas seulement d’admirer la «nature», mais de réviser en profondeur nos liens avec les différents règnes. J’admire beaucoup ce qu’écrit Vinciane Despret à ce sujet.
R.B. : La critique acérée portée dans votre livre au mythe de la croissance est néanmoins problématisée lorsque vous mettez en scène « un théâtre » dans la tête du narrateur : « Tu ne vas quand même pas nier tous les progrès réalisés en médecine, en agriculture, dans l’industrie et j’en passe… tu en bénéficies, non ? » (AM, p. 62)
J.M. : Jérôme Fracasse, comme moi, sait qu’il a aimé ce progrès. Il a intégré ses principales valeurs et en a profité largement dans sa vie quotidienne. En racontant, il peut bien inventer des hypothèses et critiquer des choix, reste qu’il est lui-même pris dans la contradiction de ses comportements et de ses croyances. Contradiction commune, aujourd’hui, chez tous les citoyens-consommateurs des pays riches, quand ils développent une conscience écologique. Très difficile à dépasser. Wittgenstein disait à ses étudiants : «Toutes les bonnes théories ne servent à rien, vous devez changer votre vie».
R.B. : Si je ne me trompe pas, vous n’abordez pas directement la notion de « décroissance » dans Absolument modernes !, mais vous l’évoquez à travers une sorte d’allégorie platonicienne, un rêve qui a pour protagoniste la « Fée Minimum, adepte de la modération et de la vie lente » qui « a pris la tête d’un mouvement de résistance ». À son service, elle a « deux sœurs folaches, Vertige et Frisson » « qui font surgir l’amour et le désir de paresser sur la terre […] sillonnant le pays pour inviter les gens à changer de vie » et les réveillant finalement « d’une hébétude de sept générations » (AM, p. 118-119). Pourquoi avez-vous donc choisi ce détour par le langage figuré, qui peut sembler une mise à distance du concept dans le contexte de votre ouvrage ?
J.M. : Je suis intéressé par la «décroissance» même si je ne mesure pas tous les enjeux de ce terme qu’on ne peut pas se contenter d’agiter comme un slogan vertueux. Décroissance, cela signifie aussi concrètement que la vie de tous va changer, et que nous allons renoncer à pas mal de commodités. Sommes-nous prêts ? Savons-nous encore faire certains gestes vitaux de base ? Sommes-nous prêts à avoir moins chaud, moins de nourritures variées, moins de mobilité, même si c’est pour avoir plus de temps, plus de liens, plus de contacts avec notre environnement ? Cela va-t-il creuser ou réparer les inégalités ? Vaste et cruelle question. Donc je ne voulais pas, dans un roman, poser théoriquement des problèmes aussi complexes. La Fée Minimum et ses belles adjointes (leurs noms sont ceux de variétés d’abricots : Vertige et Frisson). militent comme Fracasse pour l’auto-limitation et le droit à ralentir. Cela me plaît, et chacun peut y exercer sa responsabilité. Pour moi, cette fable était donc plus parlante : elle convoque l’imaginaire, n’éveille pas d’emblée un soupçon défensif ou un rejet idéologique. Et puis, dans ce cas, elle est drôle et tendre. Ces vertus passives, quand même, ce n’est pas rien !
R.B. : Les références ironiques à un Dieu muet et en retrait face aux ravages de la modernité sur sa création constituent un leitmotiv frappant dans Absolument modernes ! : « Dieu regardait toujours de loin, et n’avait aucun avis sur la question » (AM, p. 50). Cela m’a fait penser à un passage dans Haut Val des loups, où vous racontez le parcours d’un jeune militant écologiste en Suisse, qui, parlant à la première personne, dit : « À la fin de l’enfance le dénommé Dieu s’était éclipsé […] Des années durant, la nature avait occupé cette place vide. Parée de toutes les vertus, comme un amour imaginaire. Et puis tu t’étais accoutumé à son mutisme. Maintenant, il t’apaise » (HVL, p. 120). Quel est donc ce rapport, ce Dieu sive Natura, ce mutisme partagé ?
J.M. : Oui, c’est un peu Spinoza pour les nuls, et ici, le nul n’est autre que moi. Je me méfie des idées générales, en général. Une enquête de sociologie historique est plus instructive et précise que bien des formules philosophiques, du moins est-ce ma conviction. Bref, l’absence de Dieu est une donnée de base de mon expérience générationnelle, et elle contraste avec l’omniprésence de la religion catholique la plus formelle et la plus triste dans le Valais de ma jeunesse. Le parti majoritaire (lié à l’Eglise) tenait toute la population, la presse, l’école, sous sa férule vacillante et bornée. J’ai vu et vécu de réels abus idéologiques, ayant passé sept ans en collège catholique sans subir pour autant de viol physique. Mais cette mascarade théologico-politique, pour en revenir à Spinoza, était parfois aussi très drôle, transfigurée ou émulsifiée par le Carnaval. Voilà une contradiction qui devient vivante. Les personnages du livre vivent sans Dieu et doivent se débrouiller pour façonner le monde qui leur convient, avec l’«imaginaire radical» (Castoriadis) dont ils disposent. Autonomes et libres, mais inquiets. C’est plutôt exaltant…
R.B. : La figure de Maurice Chappaz, « poète des cimes blanches », engagé dans le combat écologiste en Suisse, est présente dans Absolument modernes ! et se trouve au centre de Haut Val des loups. Quelle est l’importance de son œuvre et de son engagement pour vous ? Comment l’avez-vous transformé en un personnage littéraire ?
J.M. : Chappaz, comme Jean-Marc Lovay, fait partie de ces gens par qui j’ai pu accéder à l’écriture, oser ce geste. Simplement parce qu’ils étaient réels, vivants, proches géographiquement et qu’ils avaient pris ce risque avant moi. J’ai lu et admiré (indépendamment de différences sociales, idéologiques, et de références littéraires autres) certains de leurs écrits pour cette liberté marquée par les contre-cultures des années 60. J’ai pas mal fréquenté Chappaz et connu aussi ses côtés moins reluisants, mais c’est sans importance. Son rapport à la «nature» était la synthèse de son milieu social (des notaires ruraux, observant la «nature» sans y être asservis physiquement), de sa foi catholique atypique (avec des échappées bouddhistes) et de la littérature (Gustave Roud et Charles-Albert Cingria, par exemple : contemplation immanente et déambulation gourmande). Dès 1948, Chappaz s’est engagé pour la préservation des paysages (le bois de Finges), avec le Heimatschuz. C’était un environnementalisme à l’origine esthète et bourgeoise. Puis, quand Chappaz a vu les dégâts de l’immobilier touristique dans les années 60, le ton est devenu plus militant, libertaire, avec une admiration pour la jeunesse hippie qui disait non à cette société du fric. Les gens s’étaient énormément enrichis en vingt ans. Il y avait une obscénité de la consommation et un mépris de toutes les limites matérielles. Lorsque le secrétaire du WWF-Valais a été tabassé, en février 1991, Maurice Chappaz a prononcé un discours improvisé devant des centaines de jeunes à l’hôpital de Sierre où il a dénoncé «les nazis de l’économie». J’y étais, et ce genre de moments vous marque pour longtemps.
R.B. : Dans Haut Val des loups, vous abordez à la fois la question du militantisme écologiste et du rôle de la littérature dans celui-ci. En particulier, le narrateur exprime souvent ses doutes quant à l’efficacité de la contribution de la littérature : « Et tu pensais vraiment que la poésie suffirait à leur résister ? » (HVL, p. 97), et encore : « Jusqu’où croyais-tu à la vertu du beau langage ? » (HVL, p. 46) Quelle est votre position aujourd’hui sur cette question ?
J.M. : Je ne crois pas vraiment au pouvoir social direct de la littérature. Ce n’est pas Rousseau ou Voltaire qui ont déclenché 1789 ! Ils ont mis en mots les transformations sociales profondes qui s’y jouaient. Mais ce sont des corps vivants qui ont pris la Bastille et créé une première assemblée nationale. Certes, un livre peut changer les perceptions du monde, mais ce sera toujours sectoriel, hasardeux, atomisé, imprévisible et tant mieux. A moins de diffuser à tous une littérature de propagande ! ;=) Perec ou Le Clézio ont très bien décrit les apories de la consommation de masse, mais ils n’y ont pas mis fin. Les écrivains ne peuvent pas se gargariser de mots. Et puis, le livre est aujourd’hui avant tout un marché supplémentaire. Alors écrivons malgré l’état des choses, donnons à réfléchir et à douter, écoutons d’autres voix que celles qui couvrent tout, espérons aussi des lecteurs ouverts et viraux. Et à côté, chacun peut agir comme citoyen. J’ai espoir en les formes qu’invente chaque jour la société civile, et que les artistes peuvent relayer.
Pour citer cet article :
Riccardo Barontini, Jérôme Meizoz, «L’environnement de la modernité. Entretien de Jérôme Meizoz avec Riccardo Barontini autour d’Absolument Modernes et de Haut Val des Loups» in Literature.green, janvier 2019, URL: https://www.literature.green/lenvironnement-de-la-modernite-entretien-de-jerome-meizoz-avec-riccardo-barontini/, page vue le [date].
—
Entretien réalisé dans le cadre du projet La littérature environnementale en Suisse: écrire l’écologie, réalisé avec le soutien de la Mission Suisse auprès de l’Union Européenne. Une journée d’étude sur ce sujet aura lieu à l’Université de Gand le 24 février 2020: https://www.literature.green/je-ecrire-ecologie-suisse/
